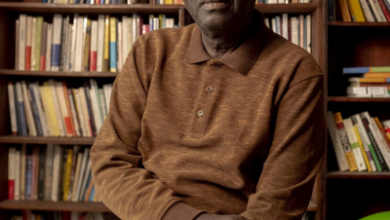« La tenue ne justifie pas le viol », « Ras le viol », « Stop à l’impunité »… Pancartes brandies à bout de bras, quelques dizaines de femmes habillées de blanc et violet se sont réunies, samedi 3 juillet, sur la place de la Nation, à Dakar, pour dire leur colère. « Nous devons nous justifier quand nous sommes victimes », s’insurge Fatou Diop, militante au sein de Yeewu Yewi, l’un des plus anciens mouvements féministes du Sénégal.
Ce sit-in, organisé par le Collectif des féministes du Sénégal (CFS), a eu lieu à la suite d’une nouvelle affaire de viol présumé qui, depuis le 27 juin, agite le pays et les réseaux sociaux autour du hashtag #JusticePourLouise et ravive le débat sur la loi de criminalisation du viol et de la pédophilie, un an et demi après sa promulgation. « Ce texte ne suffit pas, il faut maintenant que la société change », poursuit Fatou Diop.
Une jeune fille de 15 ans – surnommée « Louise » pour conserver son anonymat – a accusé un jeune homme de 19 ans de l’avoir violée, en mai, à la sortie du lycée français de Saly, ville balnéaire au sud de Dakar, où ils sont tous les deux scolarisés. Il aurait aussi filmé les faits puis partagé les vidéos du viol. Le jeune homme – qui « nie avec véhémence » une relation sexuelle non consentie, selon son avocat – a été placé sous mandat de dépôt. L’affaire a pris de l’ampleur, car l’accusé est le fils d’un journaliste sénégalais renommé qui avait lui-même été condamné à deux ans de prison pour viol, en 2013, mais qui avait bénéficié d’une liberté conditionnelle au bout de quinze mois.
De dix à vingt ans de prison
En février, c’est l’affaire Adji Sarr qui créait la polémique. Cette employée d’un salon de massage avait accusé de viol l’opposant politique Ousmane Sonko, un scandale rapidement politisé qui avait provoqué des manifestations violentes et meurtrières à travers le pays. À l’époque, le CFS avait diffusé un communiqué pour appeler à respecter le statut de victime d’Adji Sarr.
Dans ce contexte, le cas de la jeune Louise est celui de trop pour les militantes. « Une fois de plus, une affaire fait polémique du fait de la position sociale de l’accusé, alors que des viols ont lieu tous les jours sans que cela n’indigne personne quand leur auteur est inconnu », s’indigne Maïmouna Astou Yade, une des porte-parole du CFS.
Le sit-in organisé samedi – qui a peu mobilisé – avait pour objectif de rendre visibles les femmes victimes de violences sexuelles, dont la parole n’est pratiquement jamais écoutée. « On cherche toujours des circonstances atténuantes aux violeurs, pour mettre la responsabilité sur les épaules des victimes », se révolte Aïssatou Sene, une autre porte-parole du CFS. « Qu’est-ce qu’elle portait ? Où était sa mère ? Pourquoi est-elle sortie à cette heure-ci ? Ces questions sont encore trop souvent posées », continue la jeune femme, habillée d’un tee-shirt violet barré du slogan « Justice pour toutes les Louise ».
Les féministes demandent une meilleure application de la loi qui, depuis son adoption en janvier 2020, a fait du viol et de la pédophilie des crimes, alors qu’ils n’étaient jusque-là que des délits. Les peines d’emprisonnement sont maintenant de dix à vingt ans, contre cinq à dix ans précédemment, et le délai de prescription a été rallongé de sept ans. « L’esprit de la loi est de dissuader les éventuels agresseurs », éclaire Alassane Ndiaye, directeur adjoint des affaires criminelles au ministère de la justice.
Une attente parfois douloureuse
Au total, 512 affaires de viol et de pédophilie ont été enregistrées par le ministère de la justice depuis janvier 2020. « Il y a eu peu de jugements pour le moment, car la loi est récente. La majorité des affaires sont encore en cours d’instruction », explique Alassane Ndiaye, qui assure qu’un processus d’évaluation sera mené sur plusieurs années pour identifier les améliorations possibles.
De son côté, l’Association des juristes du Sénégal (AJS) a compté 270 cas de violences sexuelles (dont certaines seront peut-être requalifiées en viols) en 2020 (contre 472 cas de viols en 2019) dans leurs huit « boutiques de droit », des permanences où les victimes peuvent bénéficier d’un accompagnement juridique, social et médical.
« Sur ces 270 cas, nous n’avons encore reçu aucune décision sous le coup de la nouvelle loi. Nous ne savons pas si l’instruction continue, si le dossier sera classé sans suite ou si les accusations de viol seront requalifiées en détournement de mineur ou de pédophilie », constate Nafi Seck, coordinatrice des boutiques de droit de l’AJS. Elle souligne aussi la lenteur de la prise en charge des dossiers, qui nécessitent une enquête plus approfondie depuis que le viol a été criminalisé, « alors qu’avant ce n’était qu’une simple procédure de flagrant délit ».
L’attente est parfois douloureuse pour les victimes. Adji, 23 ans, a été violée par un homme de son village de la Petite Côte, au sud de Dakar, en mai. Elle a porté plainte il y a plus d’un mois mais n’a plus de nouvelles de la procédure depuis que son agresseur a été placé sous mandat de dépôt. Elle attend d’être convoquée par le juge d’instruction afin de laisser cette histoire derrière elle. « Je suis fatiguée, j’essaie d’oublier mais les souvenirs reviennent, comme si ça se passait aujourd’hui », dit-elle.
La culture du « sutura »
Avant la loi, porter plainte était « inimaginable » pour la féministe Fernanda Ramos de Almeida. Pour la première fois lors du sit-in du 3 juillet, elle a osé parler publiquement de son viol, subi à l’âge de 17 ans. « Je suis encore victime jusqu’à présent, car cet événement a détruit ma vie et mes études… Et même aujourd’hui, les gens de mon entourage me disent de ne pas en parler », raconte-t-elle, dénonçant la culture du « sutura » – le silence et la discrétion, en wolof.
Face à cette pression sociale, de nombreuses femmes se désistent au cours de la procédure judiciaire. « Souvent, le violeur fait partie du cercle proche et des arrangements sont trouvés, explique Nafi Seck, de l’AJS. Certaines femmes ne sont pas prises au sérieux et sont culpabilisées par les forces de défense et de sécurité. Il faut vraiment continuer de les former pour renforcer leurs capacités d’accueil et de prise en charge des victimes. »
Tous les intervenants le reconnaissent : une loi qui criminalise le viol ne sert pas à grand-chose si les victimes n’osent pas dénoncer leurs agresseurs. En outre, un travail de vulgarisation doit être mené pour que le contenu de la loi soit connu dans toutes les familles.
Si de la sensibilisation est déjà faite auprès des femmes et des familles pour savoir comment réagir afin de préserver les preuves en cas d’agression, Alassane Ndiaye concède qu’une meilleure prise en charge des victimes de viol serait souhaitable, avec la création d’une structure d’accueil et d’accompagnement jusqu’au procès. Un projet qui a pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19, regrette le directeur adjoint des affaires criminelles, qui y voit un outil essentiel pour une bonne application de la loi.
Théa Ollivier
(Dakar, correspondance)
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com