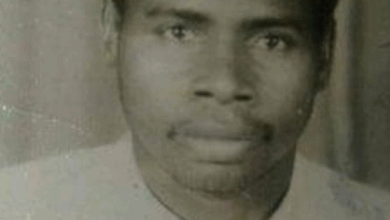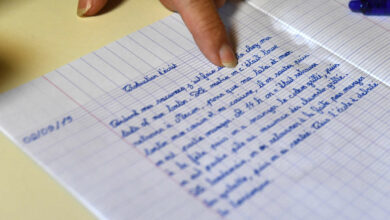Si Yakouba Issifi est venu ce jour-là à l’« école des maris », ce n’est pas pour prendre des cours d’algèbre. Sa présence dans cet établissement pas comme les autres est pourtant une question de chiffres : deux, comme le nombre de ses femmes, et neuf, celui de ses enfants. En cette fin février, ils sont une dizaine, comme lui, assis en tailleur sur une natte ombragée par le feuillage d’un margousier. Des « maris modèles », réunis dans la cour du centre de santé de Sona, petite ville rurale au bord du fleuve Niger située à 85 km de la capitale, Niamey, sur la nationale conduisant au Mali.
Pas de cours d’algèbre ni de géométrie, donc, mais une histoire de courbes follement ascendantes formées par les indicateurs démographiques étourdissants du Niger. Des courbes que ces agriculteurs illettrés tentent – avec bien d’autres – de dompter en promouvant dans les villages environnants les règles élémentaires de la santé maternelle, dans l’objectif d’épargner des vies et de limiter les naissances.
Vaste entreprise et question vitale pour le Niger. Outre le plus mauvais indice de développement humain (IDH) au monde, ce pays détient d’autres records que les autorités s’efforcent d’effacer des tablettes. Il y a ainsi cette moyenne de sept enfants par femme. La pente est descendante. En 2000, elle était de 7,7. Mais un tel « indice synthétique de fécondité » alimente un taux de croissance démographique de 3,3 % par an. Autrement dit, le nombre de Nigériens est passé de 3,5 millions en 1960 à 22,5 millions actuellement. Et ils seront 79 millions en 2050, puis 209 millions en 2100 si rien ne change, alors qu’aujourd’hui ce pays sahélien gagné par la désertification ne parvient déjà pas à nourrir toutes ses bouches.
Il y a un autre record, celui des mariages précoces et donc des grossesses. « 30 % des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans, 76 % avant 18 ans, 42 % des femmes sont mères avant 17 ans, 75 % avant 19 ans », énumère Abdoulkarim Hachimou, secrétaire général au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant. Or, dans ce pays sous-équipé en structures sanitaires, accoucher n’est pas sans risque. Toutes les deux heures, une femme meurt en couches ou de leurs suites. Dans le même intervalle, six nouveau-nés perdent la vie. « La situation est intenable et, quoi qu’on fasse, l’économie ne peut pas suivre de tels taux de croissance. Agir est une obligation », explique M. Hachimou.
Sans les hommes, « il n’y aura pas de solution »
L’école des maris est l’une des actions centrées sur la promotion de la santé maternelle et du planning familial. L’idée est venue en 2007, tirée d’une étude réalisée par les sociologues nigériens du Laboratoire d’études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local (Lasdel), à la demande du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap). « Il en est ressorti que les hommes constituent un obstacle majeur à l’amélioration de la santé de leurs épouses mais que, sans eux, il n’y aura pas non plus de solution », explique Issa Sadou, chargé du programme genre au Fnuap-Niger : « Pourtant, en poussant la porte de la santé, on débouche sur le développement. »
Assise avec d’autres femmes sous un autre arbre à l’écart de leurs maris, Mariama Soulé, l’une des deux épouses de Yakouba Issifi, décrit simplement la nature de ces obstacles. « Avant, il y avait l’ignorance. La sage-femme était un homme, nos maris ne voulaient pas qu’on aille le voir, alors on accouchait chez nous. Ils ne voulaient pas non plus sortir l’argent de leurs poches », explique-t-elle en fendant d’un sourire éclatant son visage au front légèrement tatoué. Les hommes acquiescent et en rient aussi, comme on le ferait en se rappelant une bêtise passée, une croyance ancienne devenue désuète.
Dans les locaux sommaires du centre de santé de Sona – le seul pour les quinze villages des environs et leurs 16 000 habitants –, une affiche clouée au mur expose les courbes qu’Abdou Dijigarey, son président, a tracées de sa main. « En 2013, il y avait seulement 14 % d’accouchements assistés. Aujourd’hui, 55 % des femmes viennent accoucher ici. Quasiment toutes viennent en consultation prénatale et les enfants sont vaccinés du BCG [contre la tuberculose]. Tout ça, c’est grâce à l’école des maris », se félicite-t-il.
« Espacer les naissances préserve la santé des femmes »
Les hommes de Sona sont les pionniers de cette expérience qui a essaimé, depuis, dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Depuis le début de l’expérience, deux fois par mois, les « maris modèles » viennent ainsi faire « fada » sous le margousier. Le « fada », terme haoussa, désignait initialement les conseillers des chefs traditionnels – la cour, en quelque sorte.
« Par extension et avec la démocratisation dans les années 1990, les fada sont devenus des groupes de parole où tout le monde s’exprime librement, sans jugement, sur tous les sujets. On a repris ce modèle, mais sous la direction d’un coach et sur des sujets traitant de la santé maternelle. Comme au foot, ce sont les joueurs sur le terrain qui décident. Là c’est pareil, ce sont les hommes qui décident, d’autant qu’on touche à l’intimité de chacun », explique Mohamed Haidara, coordinateur de l’ONG SongES.
Comme en sport, où tout le monde ne peut pas faire partie de l’équipe, tous les hommes ne sont pas éligibles à l’école des maris. Ils doivent répondre à neuf critères basiques tels qu’être marié, disponible pour les autres, avoir une bonne moralité, soutenir sa famille… et accepter de participer sur la base du volontariat, sans rémunération.
Chef de projet à SongES, Boureima est l’un des coachs de ces « fada ». Ce colosse fan de football, que la plupart ne connaissent que par son surnom de « Coach l’homme », a patiemment amené ses « joueurs » à aborder ensemble des questions intimes et à changer d’attitude vis-à-vis de leurs épouses. « Ici, les hommes détiennent l’autorité, toute l’autorité. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ont raison, explique-t-il. Par exemple, refuser de payer une consultation prénatale peut conduire à débourser cent fois plus s’il faut ensuite une évacuation sanitaire. Et espacer les naissances préserve la santé de leurs femmes. »
« Au début, on nous lançait des noms d’oiseaux »
Une fois convaincus, les maris sont envoyés sur les pistes de latérite pour porter la bonne parole dans les villages environnants. C’est le principe de cette école, qui fonctionne comme un centre de formation pour formateurs. « On fait parfois 15 km à pied pour aller sensibiliser les autres. Au début, on nous lançait des noms d’oiseaux, on nous traitait de chrétiens. Maintenant, ça va mieux », raconte Yakouba Hamani, un de ces « maris modèles ».
Ainsi, doucement, la parole est portée de pré en pré, de père en père. Le réseau compte dorénavant plus de 1 000 écoles réparties dans le pays. Le dispositif doit être complété par des « écoles des futurs maris », destinées aux adolescents célibataires, et par un réseau dit « des espaces sûrs », pour les jeunes filles vulnérables déscolarisées. « Les filles qui ne sont pas occupées à l’école se marient plus jeunes », explique Abdoulkarim Hachimou, du ministère de la promotion des femmes.
Mais le chemin est encore long avant que les mentalités ne changent radicalement. Pourquoi pas, ainsi, une « école des épouses » ? Sous l’autre arbre, l’idée plaît aux femmes. Yakouba Hamani coupe court : « Nous sommes musulmans, ce serait une fuite de nos responsabilités d’homme. Mais notre rôle est de parler à nos enfants pour qu’ils ne fassent pas comme nous », ajoute ce modeste riziculteur de Sona, où l’argent est si rare qu’on dit que c’est le même billet qui tourne dans le village. Des enfants, il en compte déjà huit, avec deux épouses. « Ce sont eux qui me nourriront plus tard, affirme-t-il. Mais ils naîtront au centre de santé. »
Christophe Châtelot
(Sona, Niger, envoyé spécial)
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com