
« Toute la nation rassemblée » Que ce soit dans les moments d’allégresse sportive ou dans un deuil national, comme lors du naufrage du bateau « Le Joola », c’est une métaphore souvent brandie comme étendard. Dans un monde globalisé, la nature de l’identité sénégalaise, au singulier ou au pluriel, est questionnée. Mamadou Diouf et Mohamed Mbodj, deux historiens, apportent, dans des entretiens « croisés », des éclairages sur les origines et les fondements de ce qu’est être sénégalais.
Le Sénégal ne fait pas exception. Dans l’espace de la Sénégambie, le processus est à peu près le même. La constitution des États s’est faite en plusieurs étapes. Entre le passage des royaumes traditionnels à l’État sénégalais, il y a eu la formation de la colonie du Sénégal puis la fédération de l’Afrique occidentale française en 1895, dissoute en 1958 ; celle-ci est remplacée d’abord par l’Union française (1946-1958) et ensuite par la Communauté française (1958) ; elle est constituée par des territoires devenus des Républiques autonomes, sauf la Guinée qui devient indépendante en 1958.
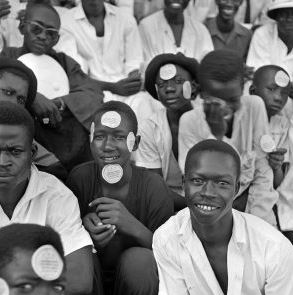
Dès 1960, les pères de l’indépendance, comme le président Léopold Sédar Senghor, avaient l’ambition de construire un « État-Nation » : il s’agit d’une ambition politique et historique de juxtaposer un État, en tant qu’organisation politique, à une Nation, c’est-à-dire des individus qui se considèrent comme liés et appartenant à un même groupe. Là également, le Sénégal n’est pas un cas isolé. « Les États africains qui revendiquent un statut d’État-Nation sont les héritiers directs des colonies autant en termes d’espace que de populations. Une territorialisation validée par le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation adoptée par la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernements de l’Organisation de l’unité africaine (Oua) réunie au Caire, le 21 juillet 1964 », explique Mamadou Diouf, Professeur d’Histoire à l’université de Columbia, aux États-Unis.
Du projet « État-Nation » au « Sénégal des profondeurs »
Pour l’historien sénégalais, à l’accession à l’indépendance, deux projets de clôture des empires coloniaux et de construction de nouvelles souverainetés convergent dans la mise en place d’État-nations inspirés des trois modèles, français, britanniques et de certains éléments soviétiques. «Ce modèle de la République, une et indivisible, centralisée, dotée d’une langue et d’un père fondateur, s’est imposé contre la longue histoire précoloniale et coloniale d’une gouvernance plurielle ; il a élevé la lutte sans merci contre « le tribalisme » et des traditions inventés et manipulés pour établir une communauté nationale fictive. La construction de celle-ci a convoqué exclusivement les paramètres de l’histoire des nationalités et du nationalisme européen, celle d’une unité qui assimile et rassemble les fragments d’une histoire commune, d’une communauté imaginée, pour reprendre Benedict Anderson, et non une unité qui est construite sur la différence et un projet discuté communément adopté. Certains politiciens sénégalais, Senghor mais surtout Mamadou Dia notamment dans son livre « Nations africaines et solidarité mondiale » paru en 1960, se sont mobilisés contre la balkanisation pour signaler que le modèle national européen était inadapté à l’Afrique et aux nations à venir », développe le professeur Diouf. « L’État-Nation n’est ni moderne, ni désirable. Des communautés humaines, larges, inclusives et diversifiées, constituent la vague de l’avenir ; les institutions politiques devaient refléter ce fait », écrivait Mamadou Dia, dans le journal de son parti, « La Condition humaine », le 29 août 1955. L’animation rurale, la régionalisation et la production d’une sociologie contre le savoir ethnologique coloniale illustraient la volonté du Président du Conseil, Mamadou Dia, à imaginer une autre trajectoire, de nouvelles institutions et des savoirs qui respectent la dynamique plurielle des sociétés africaines.
Géographie coloniale
Le territoire qui porte aujourd’hui le nom de Sénégal renverrait donc d’abord à une géographie coloniale. « Il se limitait à la seule île de Saint-Louis, de la fondation du comptoir en 1659 à la conquête du Waloo (1855), à l’intégration du Gandiole dans l’espace colonial – Gorée et le pays « lebu » relevaient de Gorée et Dépendances, au 19ème siècle – et finalement à la création de la fédération des colonies ouest-africaines de l’empire français », rappelle le Professeur Diouf. Ce processus a eu des conséquences sur le rapport établi par les Sénégalais contemporains avec leur État et ses représentants.
Mais quid de la revendication d’une existence historique et des traditions précoloniales ? « Le Sénégal est une invention coloniale, insiste Mamadou Diouf. Ce n’est pas le cas de la Sénégambie : un espace historique qui déborde la République du Sénégal, empiète au Nord sur la Mauritanie, à l’Est sur le Mali, au Sud sur le Fouta Jallon et les rivières du Sud ». L’historien Boubacar Barry explique que cet émiettement politique et social est consécutif aux conquêtes coloniales (portugaise, française et anglaise). Elles façonnent fortement l’histoire du Sénégal. Ce processus consacre une forte dispersion des mémoires et identités des communautés « sénégalaises ». Plus de soixante ans après les indépendances, le projet d’État-Nation a laissé la place à une territorialisation voire une provincialisation du pays. Cette configuration a une histoire plus ancienne.
Perte du pouvoir coercitif

« Les terroirs souvent autonomes mais regroupés dans les États précoloniaux ont été obligés de se dissoudre dans une territorialisation centralisée à Dakar et ses points relais (capitales régionales). Ce fonctionnement a créé une distance entre administration physique et administration psychologique », explique Mohamed Mbodj, Directeur du département d’histoire et Chaire d’études africaines et afro-américaines à l’Université de Manhattanville (États-Unis). De projet d’État-Nation, le Sénégal est donc passé à « une résurgence de terroirs et de leur culture ». C’est ce qu’on a appelé « le Sénégal des profondeurs ». « La centralisation était appuyée par une coercition conduite par l’État central jusqu’à la fin des années 1960-début 1970 », éclaire le Professeur Mbodj. En effet, il s’agit d’une césure historique car cette période est marquée par des prises de position des chefs de confréries qui commencèrent comme lors de l’épisode des campagnes de recouvrement forcé des dettes agricoles. Le cas le plus célèbre est celui de Serigne Fallou Mbacké au début des années 1970. Alors que la sécheresse avait rudement malmené leurs récoltes au point de ne pouvoir payer les impôts ou rembourser les dettes agricoles à l’État, des paysans du Baol ont eu l’appui du Khalife général des Mourides afin d’éviter certaines formes de brimades et de vexations comme le fait d’être obligés de passer toute une journée au soleil. À ces épisodes, il faut ajouter les débordements politiques et estudiantins dans les villes entre 1968 et 1971 : les évènements de mai 68 et ses secousses politiques. Ces différents éléments ont achevé de réduire la capacité de l’État centralisé. Depuis lors, l’État a perdu cette capacité coercitive et d’initiative incontestée qui faisait sa force avant. L’ambition de l’État-Nation avait pour but de faire passer le Sénégal du multiple à l’un. Dans l’entendement occidental, elle n’a pas abouti. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de mettre en place un récit commun comme celui du modèle français.
Récit national
En Europe, présentée par certains comme le « vieux continent », la constitution de certaines « Nations » s’est faite au courant du 19ème siècle. C’est cas de l’Italie avec le « resorgimento ». La France revendique une Nation beaucoup plus ancienne. Elle remonterait aux croisements des affluents provenant des Gaulois, des Visigoths, des Francs… Cette histoire diverse a été théorisée en unité par des historiens comme Michelet à travers le concept de roman nation puis celui de récit national, plus proche des considérations scientifiques. Au Sénégal, cette tendance a existé au début pour le Professeur Mohamed Mbodj. « Jusqu’aux années 1990, l’idée de faire de Lat Dior le héros national si chère à Senghor a été brandie. Elle avait braqué à la fois les non-Wolofs, mais aussi une bonne partie des Wolof (les Walo-Walo) », avance M. Mbodj. C’est une manière d’écrire une histoire commune. Pour Mamadou Diouf, la mise en place d’un récit national est difficile. « La crise sénégalo-mauritanienne et le conflit casamançais sont des signaux de l’existence de récits historiques communautaires d’une très grande diversité, rectifie-t-il. Ils sont ethniques, religieux ou régionaux. Ils animent des sensibilités identitaires différentes qui ne sont pas nécessairement irrédentistes ou nationalistes ». Dans le désordre, les cas soulevés sont Nasr Al Din, Abdul Bocar, El Hajj Oumar, Lat Dior, Alboury, Aline Sitoé, Mamadou Lamine Dramé, Ndaté Yalla, Maba Diakhou, Coumba Ndoffène, Kagn Cissé, El Hajj Malick Sy, Ahmadou Bamba Mbacké, El Hajj Abdoulaye Niass… Ils portent des récits de terroir, d’ethnies ou de confréries. « La nation sénégalaise n’existait pas. Existe-t-elle soixante années après les indépendantes ? A-t-elle été capable de produire, doit-elle nécessairement produire un récit national unique ? Ne faudrait-il pas en produire plusieurs, dans une polyphonie qui reflète la mosaïque ethnique et religieuse de la communauté nationale sénégalaise ? », fait mine de s’interroger Mamadou Diouf.

Religion : de vernis à structure
Les Professeurs Diouf et Mbodj font le même constat : « L’apport de la religion dans la constitution des identités sénégalaises est très fort, prédominant même ». Selon une étude des fondations Pew et Templeton en 2010, avec 98% de croyants, le Sénégal est le pays le plus religieux au monde. « Donc la religion définit et informe une très grande partie de nos attitudes, Musulmans comme Chrétiens ou autres. Beaucoup d’auteurs des 19e et 20e siècles ont insisté sur le caractère « superficiel » de l’Islam au Sénégalais (qu’ils baptisent alors « Islam Noir »). Mais de vernis, l’islam est devenu une structure de l’identité sénégalaise, et cela s’est répercuté sur la composante chrétienne de la population », édifie Mohamed Mbodj. La référence à Dieu, au prophète et aux « grands-pères (saints hommes, fondateurs de confréries, etc.) est devenue une norme, et son absence dérange. Le port vestimentaire (l’apparence extérieure), surtout chez les musulmans, est aussi une déclaration d’identité manifeste. « La réception de l’islam par les communautés sénégalaises souligne la pluralité de ses expressions culturelles, sociales et politiques.
L’apport des confréries
Elle inscrit l’islam dans une géographie et une anthropologie propres à chaque communauté et en signalent les singularités et aspérités. En attestent le timbre « arabe » (Tijane), la rugosité Wolof (Mouride) ou chantonnée (Halpulaar) de la récitation du Coran », précise Mamadou Diouf. Avec l’avènement des confréries, l’islam et les marabouts ont proposé une idéologie et des formules communautaires, économiques et politiques pour soit protéger les communautés paysannes, soit offrir des alternatives politiques contre les aristocraties traditionnelles et ensuite contre les colonnes expéditionnaires coloniales. Ils recouraient à la violence ou au retrait stratégique.
Dans un contexte marqué par la consolidation de l’occupation administrative, de la configuration de l’espace colonial et du produit qui lui est associé, l’arachide, l’établissement des confréries constitue un second moment dans la stratégie des marabouts sénégambiens. En effet, il y a eu une conjoncture qui clôt la séquence des djihads et ouvre une nouvelle séquence. Elle est caractérisée, selon Mamadou Diouf, par l’établissement de communautés spirituelles, culturelles, sociales et économiques, qui, tout en transigeant économiquement et administrativement avec le pouvoir colonial, préservent jalousement une forte autonomie. « Les confréries édifient des barrières qui associent spiritualité et sauvegarde d’une architecture administrative propre. Et les marabouts en ont la charge. Une fois encore, toutes ces manifestations qui se revendiquent de l’Islam sont les indices du degré de reconditionnement vernaculaire entre un Islam doctrinal et un Islam des images et des miracles ; le premier prescriptif et réfractaire à toute transaction ; le second, ouvert aux langues et formules spirituelles vernaculaires », poursuit le Professeur Diouf.
Christianisme
Le christianisme a aussi participé différemment à la configuration des identités de certaines communautés sénégalaises. Les multiples raisons et les conséquences de la conversation au christianisme des différentes communautés Joola, Sereer (Cangin du Nord-Ouest er Siin Siin), des originaires des 4 Communes ont dessiné des appropriations et des formules transactionnelles différentes de la doctrine et des images/représentations du Christianisme « occidental ». « A Saint Louis par exemple, l’abbé David Boilat qui fait partie de la première cohorte de prêtres sénégalais (Jean-Pierre Moussa et Arsène Fridoil), ordonnée au début des années 1840, n’a cessé de se pester contre la très forte participation des catholiques dans la culture émérite largement musulmane des doomi-ndar dont l’index est, l’habillement, les amulettes, les cérémonies sociales ». Mamadou Diouf soulève un autre aspect de la participation du Christianisme dans la construction des identités sénégalaises : « A la différence de Boilat, qui affirmait avec force que la langue Wolof ne pouvait porter le message du Christ, Moussa considérait que le recours cantiques traduit dans cette langue, était la meilleure stratégie de recrutement d’ouailles pour l’Église catholique. Le double mouvement de l’indigénisation des enseignements et pratiques de l’Église et de la christianisation des coutumes, ont entretenu une tension forte qui continue d’alimenter les singulières identités catholiques sénégalaises. Les prélats (Monseigneur Thiandoum) et les abbés Pierre Sock et Alfred-Amédée Dodds) et les intellectuels catholiques sénégalais (Alioune Diop en particulier, qui était un confident des papes, Jean XXIII et Paul VI), ont fortement contribué à façonner cette Chrétienté plongée dans les cultures africaines, découplée de la culture occidentale et radicalement universelle », rappelle M. Diouf.
Pour Mohamed Mbodj les chrétiens du Sénégal sont devenus un peu le miroir réfléchissant la stabilité idéale de l’image de l’autre. Ils deviennent ainsi arbitres d’un jeu ou certains pensent (faussement) qu’ils n’ont pas d’enjeu à perdre. Ainsi, on fait appel à l’image du chrétien dans la modération, sinon le désengagement politique, on fait appel à leur image de « minorité exemplaire » pour donner le bon exemple, leur nationalisme sans fracas pour un pays qu’ils ne dirigent pas est mis en exergue, leur apparente moindre implication dans les scandales politico-financiers est érigée en exemple à a suivre, etc. »
Moussa DIOP
Source : Le Soleil (Sénégal) – Le 26 octobre 2020
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com






