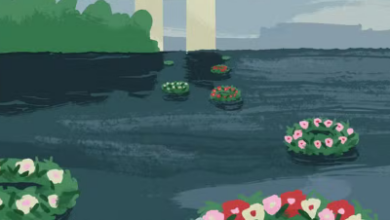La discussion s’est nouée au MacDo autour d’une glace, par une chaude journée d’été dans leur petite ville désindustrialisée de Bourgogne. Après des années de silence, d’omissions et de mensonges, Nedjma* a finalement annoncé à son père qu’elle était en couple depuis cinq ans avec Nicolas et qu’ils aimeraient se marier. La jeune femme redoutait plus que tout sa réaction. Ce Marocain immigré en France dans les années 1990, employé de mairie, avait déjà fait part de son rêve à ses filles : qu’elles épousent un Marocain comme lui. Alors l’étudiante de 23 ans avait préparé son argumentaire pendant des mois, « tel un plan de dissert’ en trois parties », prête à déconstruire tous les préjugés de son père.
Mais même le fait que Nicolas se soit converti à l’islam avant sa rencontre avec Nedjma ne fut d’aucune aide. « Converti ou pas, quel chaos ! a rétorqué son père. Avec une mère marocaine et un père français, vos futurs enfants n’auront ni repères ni culture, ils deviendront fous. Et que vont dire les gens ? » La conclusion du patriarche, calme et laconique, résonne encore dans la tête de la jeune femme : « Je n’accepterai jamais que tu te maries avec un Français. » Depuis un an et demi, Nedjma n’a plus eu de contacts avec lui.
« Sans fatalisme ni tristesse », elle a « renoncé à changer » son père, « qui ne partage pas le même monde » que le sien. Future diplômée d’une grande école parisienne, elle a quitté sa Bourgogne natale pour se plonger dans les études, unique clé vers l’indépendance. Mais son choix à un coût : « Un jour, je sais que je me marierai sans mes parents. »
Éviter de se brouiller
Comme Nedjma, de nombreuses jeunes femmes françaises d’origine maghrébine sont en rupture familiale. Leur tort ? Être en couple avec des personnes d’une origine différente de la leur, avoir perdu leur virginité… Bref, s’affranchir du modèle qu’on souhaitait leur imposer. Pour éviter de se brouiller avec leurs proches, certaines préfèrent cacher leurs relations amoureuses et mener des vies clandestines.
À 20 ans, Inès* ment continuellement. « Quand je dors chez mon copain, je dis à ma mère que je vais chez une amie. Je me sens comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. » Cette étudiante en lettres est la fille d’une Française d’origine algéro-marocaine, manageuse dans un supermarché, et d’un père égyptien qui ne l’a pas élevée. Elle habite encore chez sa mère en Seine-et-Marne, dans un petit immeuble d’un « quartier populaire et mixte aux allures de cité endormie ».
C’est ici que ses grands-parents maternels sont arrivés après avoir immigré dans les années 1960, et la famille y est installée depuis plus de quarante ans. Son ami, Alexandre, vit dans le même quartier. Cette proximité, qui pourrait faire rêver bon nombre de couples à distance, se révèle problématique. « Chez moi, c’est le temple du “qu’en-dira-t-on”, les rumeurs vont très vite. » Alors les promenades main dans la main en amoureux sont proscrites : le couple pourrait croiser un voisin, un cousin ou un oncle.
Mensonges et trahison
Pour Lila*, 20 ans, d’origine marocaine, le mensonge est aussi devenu un deuxième langage. Étudiante à Sciences Po et en couple depuis deux ans avec Romain, elle fait la navette entre son petit studio parisien et la maison de ses parents dans les Yvelines. « J’ai cultivé l’image d’une fille scolaire et docile. Mes parents ne peuvent pas me voir comme quelqu’un qui pourrait les décevoir. »
« Ça me fait de la peine de mentir à mes parents en permanence. » Lila, 20 ans
Une bonne réputation qui sert de couverture à ses innombrables mensonges. Devenue « mythomane professionnelle », elle organise des week-ends avec son amoureux en se servant de son alibi préféré : « dormir chez une copine ». Quand ce mensonge s’épuise, elle utilise celui de l’école ou des révisions. « Ça me fait de la peine de mentir à mes parents en permanence », déplore-t-elle.
Pour ces femmes, souvent issues de la deuxième ou troisième génération, ayant grandi dans des milieux populaires et des villes où « tout le monde se connaît », mentir est un choix « douloureux » mais nécessaire : il ne leur permet pas seulement de se protéger elles-mêmes mais aussi d’épargner leurs proches. Toutes insistent sur leur désir de « ne pas leur faire de mal ». Ces mensonges qui commencent dès l’adolescence perdurent parfois très longtemps.
Surtout lorsque ces jeunes femmes ont accédé à un statut privilégié au sein de familles qui ne maîtrisent pas les codes culturels et linguistiques de la France. Leur réussite scolaire est un motif de fierté pour leurs proches, et toute entorse aux normes familiales risque d’être vécue comme une « trahison ». La plupart de ces jeunes femmes ont été éduquées dans la religion musulmane. Certaines s’en sont détachées tandis que d’autres sont encore très pieuses.
L’interdit de l’amour et de la sexualité
Chez Lila, dont les deux parents musulmans pratiquants ont émigré du Maroc, « les relations hors mariage » sont taboues. La sexualité lui a toujours été présentée comme étant « sale et honteuse ». « Avoir un copain, c’est déjà difficile à assumer auprès de ma famille, mais, s’ils savaient que je dors avec lui, ce serait pire encore. » Ses parents ont emporté dans leur bagage la culture de la hshouma – « la honte », en arabe –, terme très présent dans l’éducation des jeunes femmes.
« La religion est souvent utilisée comme un prétexte pour se plier à ces normes, les parents disent que c’est haram (“illicite”, en arabe) d’être dans des relations non endogames, alors que nul texte ne les interdit. C’est l’héritage d’une tradition méditerranéenne patriarcale. » Salima Amari, sociologue
Ce mot, qui sonne comme une sentence, pose les interdits : la sexualité, le corps dénudé, l’amour. Un terme qui relève du champ culturel, et non du religieux, même si les deux notions se confondent souvent pour ces descendants d’immigrés, selon la sociologue Salima Amari : « La religion est souvent utilisée comme un prétexte pour se plier à ces normes, les parents disent que c’est haram (“illicite”, en arabe) d’être dans des relations non endogames, alors que nul texte ne les interdit. C’est l’héritage d’une tradition méditerranéenne patriarcale. » La chercheuse compare ces dynamiques à celles des premiers immigrés espagnols ou italiens « tout aussi stricts avec les femmes de la famille ».
La sociologue Emmanuelle Santelli rappelle que toutes les religions sont fondées sur une doctrine patriarcale, dans laquelle les hommes qui ont le pouvoir tentent de contrôler le corps des femmes. « Ces familles viennent souvent de pays où il n’y a pas eu le même processus de sécularisation qu’en France, elles viennent de régions du monde où l’islam est parfois religion d’État et imprègne la société. Il peut être difficile de s’extraire de ces principes », poursuit la directrice de recherche au CNRS membre du Centre Max-Weber (Lyon), coautrice (avec Beatte Collet) de Couples d’ici, parents d’ailleurs (PUF, 2012), un livre sur les parcours de descendants d’immigrés du Sahel, du Maghreb et de Turquie. Dans certaines familles de première ou deuxième génération, la femme porte « le poids de l’honneur familial ». Le regard des autres, proches, voisins, famille restée au pays, est braqué sur elle.
Les femmes, porteuses de l’honneur familial
Cette histoire qui est aussi la sienne, Fatima Daas la raconte dans La Petite Dernière (Notabilia), récit marquant de la rentrée littéraire. Elle y retrace la quête identitaire d’une jeune Française d’origine algérienne musulmane et lesbienne. Pour ne pas « brusquer sa mère », elle jongle entre les mensonges et son sentiment de honte dans un environnement familial où l’amour et la sexualité sont tabous.
« Les femmes sont gardiennes de la réputation familiale et des traditions, cela se cristallise autour de la virginité, enjeu qui n’est pas le même que pour les hommes. » Salima Amari, sociologue
« Les femmes sont gardiennes de la réputation familiale et des traditions, cela se cristallise autour de la virginité, enjeu qui n’est pas le même que pour les hommes », ajoute Salima Amari. « C’est à la mère que revient la charge de transmettre – de manière tacite – ce tabou de la virginité, explique de son côté Zohra Guerraoui, maîtresse de conférences en psychologie interculturelle. Petites filles puis adolescentes, les femmes intègrent qu’il est nécessaire de se préserver et de ne pas mettre les parents en difficulté vis-à-vis de la famille et de leur communauté, eux qui ont souvent beaucoup sacrifié pour leur offrir une vie meilleure. »
Inès a assimilé ce schéma. Sa hantise est d’« entacher » l’image de sa famille si respectée dans le quartier. Dissimuler la perte de sa virginité est donc devenu une obsession. « Un jour, je me faisais épiler le maillot avec ma mère chez l’esthéticienne. On était dans la même pièce, et j’ai été prise de panique. Je lui ai dit que j’étais pudique et que je ne voulais pas qu’elle me voie nue. En réalité, j’avais peur qu’elle se rende compte que je n’étais plus vierge. Comme si cela pouvait se voir à l’extérieur de mon corps », s’amuse-t-elle aujourd’hui.
Source de souffrance
Nour*, 24 ans, est née et a grandi en banlieue parisienne, dans un lotissement HLM « aux murs austères où l’intimité était inexistante ». Pour ses parents, tous deux arrivés d’Algérie pendant la décennie noire (guerre civile entre 1991 et 2002), le projet migratoire a été synonyme de délivrance mais aussi de déclassement. Sa mère, dentiste de formation, travaille désormais dans le social, son père, ingénieur, dans l’informatique. Ses parents, qui ne sont pas pratiquants et se montrent très critiques envers la religion, veulent que leur fille épouse un Kabyle. Nour a toujours rejeté ce modèle du mariage endogame et hétérosexuel qui la « dégoûte ».
Dès l’adolescence, ses affaires personnelles étaient régulièrement « fouillées » par sa famille. Épiée, elle cachait sa pilule contraceptive et lavait ses strings à la nuit tombée. Mais, un jour d’inattention, sa mère découvre un pot de cire à épiler et des tampons. « Elle a été si heurtée, pour elle, cela signifiait que quelqu’un d’autre voyait mon corps, et que mon hymen avait été rompu par ces tampons », raconte la jeune femme de 24 ans, qui affirme pourtant que la question de la virginité n’a jamais été clairement abordée et que sa mère a toujours tenu une posture féministe.
« J’étais en détresse émotionnelle. On ne m’avait jamais parlé de contraception ni de maladie sexuellement transmissible. » Nour, 24 ans
Attirée par toutes les personnes sans distinction de genre, Nour se définit comme « pansexuelle ». Lorsqu’elle était plus jeune, privée du soutien familial, ces tabous ont été source de souffrance : « J’étais en détresse émotionnelle, on ne m’avait jamais parlé de contraception ni de maladie sexuellement transmissible. » Nour a alors attendu impatiemment ses 18 ans pour partir à Paris et quitter un « endroit qui [l’]étouffait et entravait [sa] liberté ».
Comme pour compenser une « enfance enfermée », la jeune femme, devenue musicienne, a développé une « boulimie de rencontres » : « Je couchais avec plein de gens, je sors encore beaucoup, je rentre tard… Avoir un appartement rien qu’à moi a été une liberté géante. » Mais, par peur du « déshonneur et du rejet », Nour continue de cacher sa vie personnelle. Ses relations amoureuses de longue durée en pâtissent aussi. Ne pouvant rencontrer sa famille, de nombreux copains peinent à comprendre et à accepter cette clandestinité. « Je dois jongler entre mon droit de vivre et la sensibilité de ma mère. La pression de mes parents me pèse, et en tant que féministe je m’en veux de ne pas avoir la force de tout avouer. »
De nouveaux modèles culturels
Ces jeunes femmes se construisent en développant une image négative d’elles-mêmes, se considérant comme de « mauvaises filles, déloyales envers leurs parents », analyse Zohra Guerraoui. Cela peut entraîner « des troubles psychiques, et installer un mal-être et une souffrance », continue la psychologue. Pour pouvoir mener la vie qu’elles désirent tout en « respectant les parents qui sont un soutien face à un extérieur parfois hostile envers les descendants d’immigrés », elles apprennent au fil du temps à « développer des stratégies, en créant un équilibre fragile qui peut durer, mais la question est : jusqu’à quand ? », ajoute Salima Amari qui, pour sa thèse, a rencontré des femmes maghrébines lesbiennes qui ont fondé une famille sans l’avouer à leurs parents.
« Ces jeunes femmes sont traversées par les débats qui animent la société française actuelle, tels que le féminisme, la place des communautés LGBTQ+. Ces générations veulent s’émanciper davantage et s’affirmer. » Emmanuelle Santelli, sociologue
Mener une double vie n’est pas un phénomène nouveau pour les descendants d’immigrés. Dès les années 1980-1990, les premières générations de femmes, ces grandes sœurs que Salima Amari surnomment les « essuyeuses de plâtres », ont fait bouger les mentalités de leurs parents. En faisant accepter qu’elles étudient, quittent le domicile familial, voyagent seule. Ce qui change aujourd’hui, c’est la nature de cette double vie.
« Les transgressions des nouvelles générations ne sont pas les mêmes, résume Emmanuelle Santelli. Ces jeunes femmes sont traversées, comme les autres, par les débats qui animent la société française actuelle, tels que le féminisme, la place des communautés LGBTQ+. Ces générations veulent s’émanciper davantage et s’affirmer. » Le fossé entre les parents et les enfants s’accentue alors.
Lorsqu’elles seront mères à leur tour, ces femmes entendent libérer leurs enfants du carcan dans lequel elles ont grandi, sans rien imposer. « J’essaierai au maximum d’être ouverte avec ma fille, affirme ainsi Lila. Mais je lui transmettrai la culture de ses grands-parents et, si elle souhaite être religieuse, ne pas avoir de copain, je respecterai aussi son choix. »
« Du fait des discriminations, du racisme, du rejet qu’elles subissent de la part de la population majoritaire, on observe un phénomène de repli. Pour faire face, leurs valeurs deviennent un élément identitaire. » Emmanuelle Santelli, sociologue
Les choses sont parfois plus compliquées. Si nombre de familles de troisième ou quatrième génération prennent leur distance avec les valeurs traditionnelles, certaines perpétuent les tabous. « Du fait des discriminations, du racisme, du rejet qu’elles subissent de la part de la population majoritaire, on observe un phénomène de repli. Pour faire face, leurs valeurs deviennent un élément identitaire », explique Emmanuelle Santelli.
La psychologue Zohra Guerraoui renchérit : « Plus elles se sentent stigmatisées, plus elles développent du ressentiment et une réserve vis-à-vis de la culture du pays d’accueil. De fait, voir leur fille adhérer aux valeurs d’une société qui ne veut pas d’eux leur est insupportable. » Après en avoir voulu à sa mère d’être « fermée d’esprit », Inès nuance son propos. « Au début je diabolisais son discours, maintenant je me rends compte que c’est plus compliqué car, pour elle, j’abandonne mon arabité, tout ce qu’elle a essayé de me transmettre. »
Reste à trouver une troisième voie. « Ces femmes développent des nouveaux modèles culturels, analyse Zohra Guerraoui, qui a fait des phénomènes d’interculturation son objet d’étude : Elles ne se référeront ni complètement à la culture de leurs parents ni totalement à celle de la France. » Une liberté dont elles auront dû payer le prix.
* Les prénoms ont été modifiés.
Source : M Le Magazine – Le Monde ( Le 25 septembre 2020)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com