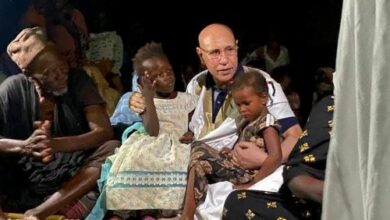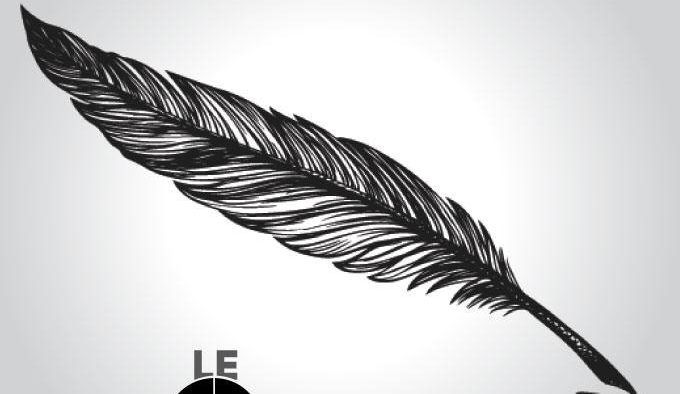
Après l’accident d’hélicoptères qui a coûté la vie à 13 soldats français au Mali, le Président français, Emmanuel Macron, avait déclaré attendre de ses homologues du G5 Sahel, une clarification du cadre et des conditions politiques de l’intervention française au Sahel, l’assumation politique de leur choix et une explication sur le sentiment anti-français dans la population. La rencontre initialement prévue à Pau le 16 décembre, a été reportée en début 2020 suite à une attaque djihadiste qui a causé la mort de 71 militaires nigériens à Inatès, près de la frontière avec le Mali.
Le Sahel, attaqué par des terroristes islamistes, est devenu le théâtre d’un déploiement d’armées étrangères et des forces de l’Onu depuis 2013, venues à la rescousse des pays agressés. Cependant, face à la persistance d’un terrorisme toujours plus meurtrier, les populations veulent également des clarifications sur beaucoup de points qui seront abordés ici sans ordre de priorité.
En premier lieu, l’opinion publique sous-régionale et africaine ne comprend pas pourquoi, depuis son intervention militaire au Mali en janvier 2013, la France ne permet pas à l’armée malienne d’accéder à Kidal, la capitale de la région de l’Azawad et des rebelles touaregs. Ce temps d’isolement de l’Azawad du reste du Mali qui lui a permis de vivre en totale autonomie, n’est-il pas une incubation suffisante pour qu’il ne veuille plus réintégrer l’Etat unitaire malien ? D’ailleurs, dans le discours de certains cercles politiques étrangers qui apparemment parrainent ce scénario, on parle maintenant de la «nécessaire» forme fédérale du Mali pour régler le problème de l’Azawad. La bourde diplomatique du chef de la Minusma, le français Christophe Sivillon qui, lors du congrès du Mouvement national de libération de l’Azawad (Mnla) le 30 novembre à Kidal, a souhaité «la bienvenue à Kidal aux délégations «venues du Mali et de l’étranger», est-elle un simple lapsus linguae ou traduit-elle ce que les Maliens soupçonnent de se tramer contre leur pays à savoir la partition. Aussi, à cause cet «impair», M. Sivillon a-t-il été expulsé du Mali.
Sur un deuxième point profitant de la crise, plusieurs pays ont construit des bases militaires au Sahel et pourtant, on ne voit pas leur impact positif sur la sécurité collective de la région, ni sur la diminution des attaques terroristes qui pourtant justifieraient leur implantation. A-t-on vraiment besoin de ces bases qui, au fond, aliènent la souveraineté des pays et ne cherchent qu’à préserver des intérêts économiques ? Au nombre des pays qui entretiennent des bases militaires au Niger surtout, on peut citer la France, les Etats-Unis, l’Allemagne et les Emirats arabes unis, alors que le Canada et l’Italie sont également militairement présents. A Agadez, se trouve la plus grande base américaine de drones en Afrique. Au Mali, au Burkina Faso des forces françaises sont également présentes. Sans parler d’une implantation militaire plus ancienne à Dakar et à Abidjan pour ne parler que de la sous-région.
Risques de partition du Mali
Sans chercher à asseoir une quelconque thèse complotiste, on peut se demander également pourquoi ne voit-on pas les drones attaquer les colonnes de djihadistes, alors qu’ils constituent un des outils militaires les plus aptes et les plus souples d’utilisation pour ce faire. Pourtant, sur d’autres théâtres d’opérations à travers le monde, les drones ont été si précis jusqu’à pouvoir éliminer sélectivement des chefs terroristes. L’honneur des armées du Sahel serait bafoué pour longtemps si elles ne parviennent pas à vaincre des terroristes trafiquants qui cherchent à protéger les routes de leur lucratif commerce. En effet, on estime que 30 à 40% de la drogue destinée à l’Europe passe par le Sahel.
Compte tenu des moyens de surveillance sophistiqués (écoute et surveillance aérienne) dont disposent les pays qui sont venus combattre le terrorisme au Sahel, on pouvait s’attendre à ce que certaines attaques-surprise des terroristes soient détectées à temps et les armées nationales informées, même si cela ne peut être une excuse à leurs défaites cuisantes. Les djihadistes de l’Etat islamique qui ont attaqué les soldats nigériens à Inatès avaient du matériel lourd dont des blindés apprend-on. Ce qui normalement ne devrait pas passer inaperçu dans un terrain à découvert comme le désert. Et pendant les trois heures qu’a duré la bataille, aucun secours n’a pu être porté aux assiégés même si l’on dit que leurs moyens de transmission ont été détruits dès le début de l’engagement.
La lutte anti-terroriste absorbe maintenant 20% du Pib des Etats du G5 Sahel. Ce qui constitue beaucoup de ressources pour des économies assaillies par les priorités. C’est pourquoi ils ont demandé de l’aide à la communauté internationale. Cependant, sur les 414 millions de dollars promis à titre d’aide militaire, peu de décaissements ont été effectués. Voudrait-on cantonner les terroristes du Sahara et ceux venus du Moyen-Orient dans le Sahel, on ne s’y serait pas pris autrement. Pourtant, si les armées du G5 Sahel avaient reçu l’appui matériel demandé à temps, bénéficié d’une formation et d’un soutien aérien, il ne serait pas nécessaire de déplacer tous ces soldats étrangers vers le Sahel, a fortiori vouloir y associer d’autres pays interventionnistes occidentaux tout en cherchant à exclure la Russie, la Chine ou la Turquie. Si tant est que la lutte anti-terroriste menée au Sahel est aussi un élément de notre sécurité collective, y compris celle de l’Europe comme le clament certains leaders de ce continent, pourquoi alors ces lenteurs dans l’aide promise ? Toutefois, il faut se réjouir de l’aide des Emirats arabes unis qui viennent d’accorder au Mali 251 millions de dollars et 30 véhicules blindés.
Qui plus est pourquoi refuse-t-on de placer le G5 Sahel sous le chapitre 7 de la charte des Nations-Unies, ce qui lui permettrait d’obtenir du soutien de l’organisation internationale ? Cette interrogation ne manque pas de pertinence si l’on sait que le désordre que connaît le Sahel a pour origine la destruction de la Libye à la suite d’une opération militaire occidentale autorisée par l’Onu.
Comme on le constate donc, les interrogations (non exhaustives) qui ne trouvent pas de réponse satisfaisante sont nombreuses et il appartient aux pays intervenants au Sahel de donner des clarifications.
Par Ibrahima MBODJ
Source : Le Soleil (Sénégal)
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com