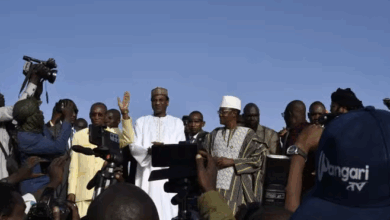« Le Monde Afrique » a décidé de publier l’un des articles de la revue « Afrique contemporaine » consacrée au Mali qui ne verra pas le jour. La publication du dossier a été suspendue par l’AFD, son organisme de tutelle.
Sur les conflits maliens et l’intervention militaire française démarrée en 2013, la revue Afrique contemporaine a voulu décentrer le regard. C’est ainsi qu’elle a confié un dossier sur ces questions sensibles à des chercheurs nord-américains, sous la direction de Bruno Charbonneau. Cet universitaire canadien est directeur du Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix (Université du Québec, Montréal). Ses travaux ont notamment porté sur la politique sécuritaire de la France en Afrique, considérée comme un « nouvel impérialisme » (Routledge, 2008), et plus largement sur les questions de conflits et leurs résolutions en Afrique de l’Ouest.
Ce texte fait partie d’un dossier préparé depuis près d’un an pour la revue scientifique Afrique contemporaine éditée par l’Agence française de développement (AFD, ancien partenaire du Monde Afrique). Le conseil scientifique de la revue s’est montré intransigeant dans le processus d’évaluation de ce dossier. Deux textes ont été rejetés. D’autres ont du être significativement modifiés avant d’être validés. Mais l’AFD a finalement décidé de suspendre la publication du dossier, provoquant la démission du rédacteur en chef de la revue et celle de plusieurs chercheurs membres du conseil scientifique.
Tous dénoncent des « interférences d’ordre politique » dans la ligne éditoriale. Pour Bruno Charbonneau, il s’agit de « censure ». L’ancien « Monsieur Afrique » de François Hollande, Thomas Melonio, désormais directeur du département « Innovation, recherche et savoirs » à l’AFD est aussi directeur de la rédaction d’Afrique contemporaine. « Il n’y a eu aucune censure, précise-t-il. Une demande a été émise pour introduire de nouveaux articles scientifiques avec des points de vue contradictoires. » Les auteurs de ce dossier, détenteurs des droits sur leurs textes, refusent catégoriquement leur publication par Afrique contemporaine. Bruno Charbonneau a accepté que son texte soit publié en version réduite en exclusivité par Le Monde Afrique, partenaire privilégié de la revue, pour que ce travail scientifique puisse être lu, débattu, critiqué.
Analyse. Depuis 2013, le Mali a fait l’objet de nombreuses interventions militaires internationales. Celles-ci ont depuis dépassé les frontières maliennes pour couvrir le « Sahel », se combinant dans un dispositif militaire important : 12 213 casques bleus et 1 737 policiers déployés au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), 4 500 soldats français au sein de l’opération « Barkhane », 5 000 à 10 000 soldats prévus pour la Force conjointe du G5 Sahel (FC-G5S), 580 soldats au sein de l’EUTM Mali (European Union Training Mission) et un nombre significatif, quoique difficile à préciser, de forces américaines et européennes dans les pays du G5 Sahel, au Niger notamment, positionnées en appui plus ou moins direct aux efforts contre-terroristes. Cela sans compter la forte mobilisation internationale pour le développement, l’aide humanitaire ou l’agenda P/CVE (Prévenir ou contrer l’extrémisme violent), où organisations internationales et acteurs bilatéraux déploient chacun leur propre « stratégie Sahel ».
Malgré toutes ces dispositions, à en croire les multiples rapports du Représentant spécial du Secrétaire-général des Nations Unies sur la situation au Mali, les conditions de sécurité n’ont pas cessé de se détériorer depuis 2015. Alors que le processus de paix n’avance presque pas, l’efficacité des actions contre-terroristes est remise en doute par plusieurs, surtout dans un contexte de régionalisation de l’insécurité.
Quels sont les effets de ces interventions internationales sur les possibilités pour la paix et la réconciliation au Mali ? Quel impact ont-elles sur le processus de paix et sur la situation sécuritaire ? Nous soutenons que l’accent mis sur la lutte contre le terrorisme par les partenaires internationaux des Nations unies impose une logique sécuritaire aux possibilités pour la paix et produit des contradictions et des effets contre-productifs non négligeables. Face aux critiques concernant les limites du contre-terrorisme, la réponse a été de redoubler d’efforts via la création de la FC-G5S et une présence militaire étrangère en croissance au Sahel-Sahara, particulièrement au Niger. Cet acharnement contre-terroriste est perçu par plusieurs Etats comme nécessaire – une précondition même – à toute résolution politique au conflit. Une telle logique ne semble pas reconnaître, par contre, les tensions et les compromis inévitables entre les stratégies pragmatiques et à court terme du contre-terrorisme (comme la coopération avec les groupes armés) et les objectifs et les stratégies à long terme du maintien de la paix.
Conceptualiser l’intervention
Au Mali, la manière dont l’intervention militaire a été conçue justifie légalement et moralement la pratique. L’opération française Serval de janvier 2013 donnait le ton : selon le gouvernement français, il s’agissait de sauver le Mali des groupes terroristes qui menaçaient Bamako et, à terme, d’assurer la sécurité des pays voisins et même celle de l’Europe. Cette intervention militaire française fut avalisée post facto par le Conseil de sécurité des Nations unies, lorsque celui-ci créa la Minusma, en avril 2013. La Résolution 2100 (25 avril 2013), qui créait la mission, autorisait « l’armée française (…) à user de tous moyens nécessaires (…) d’intervenir en soutien d’éléments de la Mission en cas de danger grave et imminent à la demande du Secrétaire général » (article 18). Ainsi naissait une « division du travail » entre les forces de maintien de la paix de l’ONU et les forces contre-terroristes françaises. D’un côté, la mission onusienne devenait responsable du travail concernant les acteurs, les processus et les dynamiques légitimes liés aux efforts pour la paix et la réconciliation. De l’autre, les troupes françaises (et leurs soutiens alliés) devenaient responsables du travail concernant les activités et les actions de guerre contre-terroristes.
Les doctrines respectives du maintien de la paix et du contre-terrorisme permettent cette division du travail, tant d’un point de vue légal que normatif. Au sens étroit du concept, le maintien de la paix onusien fait référence à un cadre moral et éthique qui définit et limite les conditions légitimes de l’usage de la force militaire. Le maintien de la paix onusien est notamment considéré comme légitime parce qu’il est « moralement distinct » de la guerre, de la contre-insurrection et du contre-terrorisme. Ses principes fondateurs (le consentement de l’Etat hôte, l’impartialité et le recours minimal à la force dans le cadre des termes et objectifs du mandat de la mission) sont des guides et des paramètres sur les limites tolérables de la violence. Aussi, par définition, les casques bleus n’ont pas d’ennemi à tuer ou à détruire. Ce qui ne signifie pas que la coercition soit interdite ou impossible, seulement, toute utilisation de la force doit être autorisée selon le principe d’impartialité et à l’intérieur des paramètres du mandat de la mission. C’est ce qui distingue le maintien de la paix onusien des autres types d’opérations militaires.
Contrairement au maintien de la paix onusien, le contre-terrorisme repose sur l’identification d’un ennemi. Et contrairement, aussi, à la contre-insurrection, où l’insurgé est accepté comme un être rationnel et politique, l’ennemi terroriste est perçu ou jugé comme étant politiquement illégitime.
En 2012, le président français nouvellement élu, François Hollande, cherchait à éviter un engagement militaire français qui aurait inclus des troupes au sol. Il éprouvait en même temps plusieurs difficultés à convaincre le Conseil de sécurité de l’ONU de l’urgence d’une intervention militaire, malgré la montée en puissance des groupes armés islamistes pendant l’été 2012. L’insistance française quant à la menace globalisée d’un islam radical au Sahel, « à la porte de l’Europe » disait-on, était basée sur une analyse « largement orientée par des présupposés idéologiques qui ont souvent pris un tour patriotique et gaullien pour défendre la place d’une puissance moyenne sur la scène mondiale » (Montclos). La diplomatie française à l’ONU était surtout confrontée aux hésitations américaines. A l’automne 2012, encore, les Etats-Unis soutenaient la thèse d’une crise constitutionnelle – une affaire interne, concernant l’Etat malien – qui ne justifiait donc pas une intervention autre qu’africaine. Le déclenchement de l’opération « Serval », en janvier 2013, aurait ainsi surpris le secrétaire à la défense des Etats-Unis, Leon Panetta, lorsque son homologue français, Jean-Yves Le Drian, lui annonça le début des opérations. Alors que les deux gouvernements luttaient depuis plusieurs mois pour mettre au point une solution africaine au problème du nord du Mali, du point de vue américain, la décision française constituait un revirement presque total.
Fruit de ce « revirement », « Serval » allait ainsi transformer les enjeux et les perceptions. Avec « Serval », le gouvernement français recevait un soutien quasi immédiat, assorti d’éloges pour son intervention. Soudainement, le Mali devint le « nouveau » foyer de terroristes djihadistes, et un point névralgique pour les experts de la sécurité internationale affirmant la nécessité d’une action militaire. Depuis, « Serval » a ouvert la porte à la création d’une mission de maintien de la paix de l’ONU (Minusma) en 2013, à la création d’une nouvelle organisation régionale (G5 Sahel) ainsi qu’à la transformation de « Serval » en opération régionale « Barkhane » en 2014, et à la production de douzaines de stratégies « Sahel ».
Contexte international
Le Mali est ainsi rapidement devenu un terrain utile pour de nombreux acteurs de l’intervention et un enjeu politique pour des revendications concurrentes sur l’utilisation de la force et le futur du maintien de la paix. Premièrement, la justification la plus récente de la restructuration de la posture militaire et de l’engagement français en Afrique francophone est fondée sur la nécessité de la « guerre contre le terrorisme » pour « sauver » le Mali et le Sahel et, ainsi, défendre les frontières de l’Europe. Les dirigeants français et européens ne s’en cachent pas. De fait, l’intervention au Mali est devenue le terrain d’un vaste engagement international visant à transformer la gouvernance malienne dans le cadre d’une restructuration régionale des mécanismes de gestion des conflits au Sahel. Les approches non sécuritaires ou de développement tardent en effet à émerger, ce qui n’est pas pour surprendre dans un contexte où la logique sécuritaire de la « guerre contre le terrorisme » se présente comme une précondition au développement.
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com