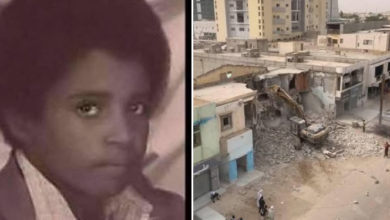En choisissant la langue française, les auteures revendiquent leur individualité.
En choisissant la langue française, les auteures revendiquent leur individualité.
Dans la littérature maghrébine d'expression française, l'œuvre des auteurs femmes est moins bien connue que celle des hommes. Quand, dans les années 1945-1950, cette littérature apparaît au Maghreb, elle est principalement masculine : Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Mohammed Dib et Kateb Yacine pour l'Algérie ; Ahmed Sefrioui et Driss Chraïbi pour le Maroc ; Albert Memmi pour la Tunisie. Devenus des classiques, ceux-ci trouveront des con-ti-nuateurs dans de nombreux auteurs contemporains de notoriété internationale.
Au cours de ces mêmes années, deux -Algériennes commencent à se faire un nom. Taos Amrouche (1913-1976), issue d'une famille kabyle chrétienne, publie en 1946 son premier roman, Jacinthe noire (Charlot). Après avoir été admise à l'Ecole normale supérieure de jeunes filles de -Sèvres, Fatima-Zohra Imalayène (1936-2015) publie – sous son nom de plume Assia Djebar – La Soif (Julliard) en 1957, -prémices d'une importante production littéraire et cinématographique qui fera d'elle, en juin 2006, le premier auteur nord-africain élu à l'Académie française.
" Dire le silence des femmes "
Mais il faudra attendre les indépendances du Maghreb et les décennies 1970 et 1980 pour que d'autres voix féminines se fassent entendre : l'époque est aux valeurs émancipatrices, promues par un mouvement associatif défenseur des droits de l'homme et de l'égalité des sexes. L'espace public s'ouvre aux femmes : elles se font une place sur le marché du travail, en politique et dans la création littéraire et artistique. Prenant la plume, elles s'approprient le français, reçu en héritage, comme langue libératrice : " Mon enfance et mon adolescence n'auraient été qu'une infernale et interminable réclusion sans la merveilleuse connivence de cette langue ", affirme la romancière algérienne Malika Mokeddem. En 1991, quand le gouver-nement algérien décide de généraliser l'arabisation pour en finir avec la langue du -colonisateur, elle s'indigne : " Si des -tyrans, des esprits rétrogrades veulent la frapper d'interdit, c'est parce qu'ils la savent nimbée de lumière et toujours en -gésine de liberté. "
Le français est le moyen pour elles de s'affirmer et de se libérer des carcans qui ont maintenu leurs mères en état d'infériorité. Venu d'ailleurs, il leur offre la possibilité de prendre de la distance par rapport à leur culture d'origine voire de s'y opposer en revendiquant leur individualité. En 1987, Myriam Ben, poétesse algérienne d'origine juive en témoigne : " J'écris, parce que je suis femme. J'écris, parce que je dois dire le silence des femmes. "
Non pas que la langue arabe, en soi, ne permette pas de s'affranchir des convenances. Mais le fait est qu'au Maghreb elle a longtemps été mise au service, par ceux-là mêmes qui la promeuvent, des traditions sociales et religieuses rigoristes : patriarcat, interdits frappant le corps et la sexualité, enfermement, polygamie, répudiation, etc. C'est du poids de ces traditions que ces femmes entreprennent de se délivrer. En 1985, dans Le Voile mis à nu – (Arcantères), de la Marocaine Badia Hadj Nasser, l'héroïne lance ce cri : " Terres d'islam ! Je suis claustrophobe. Chaque fois qu'il s'agit de mettre le voile, ma respiration se perd, je suffoque. " Au même moment, paraît Sexe, idéologie, islam (Editions Tierce, 1983) de sa compatriote, la socio-logue Fatima Mernissi. Suivront d'autres titres qui lui attireront les foudres des oulémas : Le Harem politique. Le Prophète et les femmes (Albin Michel, 1987), et sous le pseudonyme de Fatna Aït Sabbah, La Femme dans l'inconscient musulman – (Albin Michel, 1986). Dans une veine différente, une autre Marocaine, Soumaya -Naamane Guessous, publie en 1988 sa célèbre étude de terrain : Au-delà de toute -pudeur, la sexualité féminine au Maroc – (Eddif), devenue un best-seller. De son côté, la psychiatre Ghita El Khayat élargit cette approche critique avec Le Monde arabe au féminin (L'Harmattan, 1985) et Le Maghreb des femmes (Eddif). A Casablanca, d'autres initiatives voient le jour : la maison d'édition Le Fennec, fondée par Layla Chaouni, lance plusieurs collections dédiées aux études féminines ; Hinde Taarji dirige l'audacieux mensuel féministe francophone Kalima qui, disparu en 1989, fut le précurseur indéniable d'une presse marocaine contestataire à venir.
Cette période foisonnante a ouvert la voie à de nouvelles œuvres féminines et francophones au Maghreb, qu'il s'agisse de fictions ou d'essais. Ces écrits, pour la plupart édités localement, sont encore méconnus en France, même si certains salons s'efforcent de les faire découvrir. C'est le cas du " Maghreb des Livres " qui se tient chaque année à Paris.
Les politiques d'arabisation au Maghreb ne sont pas parvenues à éliminer le français qui est aujourd'hui, n'en déplaise à certains, admis comme partie intégrante du patrimoine linguistique de ces pays. L'antagonisme entre langue française et langue arabe, prévalant dans la période post-coloniale, a certes contribué à établir une dichotomie entre " modernistes " et " traditionalistes ". Celle-ci n'a pas complètement disparu. Cependant, aujourd'hui, les frontières sont moins hermétiques. Des publications arabophones – universitaires, journalistiques et littéraires – émergent. Informés de ce qui se publie en français, leurs auteurs s'en inspirent. S'ils osent bousculer à leur tour les tabous, c'est aussi à ces femmes qu'ils le doivent.
Ruth Grosrichard
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com