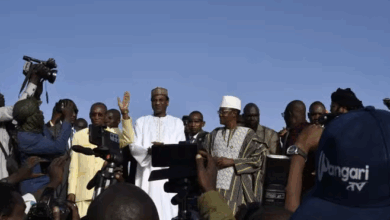C’est une idée de l’ancien président Abdoulaye Wade, l’une des rares rescapées de son faramineux projet des « sept merveilles du Sénégal » qui devaient former le parc culturel de Dakar.
C’est une idée de l’ancien président Abdoulaye Wade, l’une des rares rescapées de son faramineux projet des « sept merveilles du Sénégal » qui devaient former le parc culturel de Dakar.
Le musée des civilisations noires ouvrira en novembre dans la capitale sénégalaise, à mi-chemin entre la gare routière Dakar-Niger et le Grand Théâtre national, l’autre « folie » de Wade.
Le nom du président déchu du pouvoir en 2012 a soigneusement été gommé de la communication officielle. Pour bâtir le pitch, on lui préfère celui plus consensuel de Léopold Sédar Senghor. « C’est un très vieux projet, qui date du premier festival mondial des arts nègres de 1966 à Dakar, raconte Hamady Bocoum, directeur de ce nouvel établissement. Senghor avait alors porté le projet d’un musée et travaillé en étroite collaboration avec l’Unesco qui avait financé l’avant-projet. » Le projet ne survit pas à la démission de Senghor en 1980 ni aux différentes crises que traversera le pays.
Circularité du bâtiment
L’idée renaît en 2009. Pour en financer la construction, le Sénégal se tourne alors vers la Chine, qui met environ 20 millions de dollars sur la table. Conçue par l’Institut d’architecture de Pékin, la silhouette du bâtiment privilégie la circularité, à l’opposé de l’angle droit occidental. L’édifice d’une superficie de 14 500 m2 dispose de 3 500 m2 de surface d’exposition et d’un amphithéâtre.
Reste à voir quel en sera le contenu. Selon Hamady Bocoum, ce ne sera pas un musée « chromatique », à savoir dédié aux seules cultures noires. « On ne veut pas faire un musée d’ethnographie ou d’anthropologie, s’enfermer dans un ghetto, prévient-t-il. On veut montrer de manière vivante les civilisations noires mais aussi s’ouvrir sur un dialogue des cultures, créer des ponts. Le rôle d’un musée n’est pas de créer un sentiment d’altérité, mais de porter un message de partage. On veut que les Africains soient fiers de leurs racines, qu’ils cultivent à nouveau l’estime de soi, mais qu’ils soient aussi ouverts au dialogue. »
Lire aussi : Paris lance sa première foire d’art et de design africains
Mais que mettre dans ce musée quand on sait que 80 à 90 % des pièces majeures d’art africain classique se trouvent hors d’Afrique ? « On ne peut pas être prisonnier de ce que nous n’avons pas, admet Hamady Bocoum. On aimerait que d’autres pays africains contribuent par des prêts. On voudrait aussi se rapprocher du musée de Tervuren, du Smithsonian et du British Museum. »
L’institution avait pris contact voilà quelque temps avec le Musée du quai Branly, à Paris, en vue d’un éventuel partenariat. Stéphane Martin, président du musée parisien et ancien président de la commission de vérification des comptes et de contrôle des établissements publics du Sénégal de 1986 à 1989, reconnaît avoir rencontré Malik Ndiaye, chercheur et historien d’art à l’université Cheikh Anta Diop. Mais pour l’heure rien de concret n’a été mis en place.
« J’ai travaillé cinq ans au Sénégal, je suis optimiste à moyen terme, confie Stéphane Martin. Je suis convaincu qu’il y aura un mouvement de retour du patrimoine. Quand ? Comment ? Je ne sais pas. Je serai le premier à y participer à partir du moment où il y aura des interlocuteurs loyaux, fiables, honnêtes. Si ce musée de Dakar se révèle une institution à la hauteur de la Fondation Zinsou, je ne demande pas mieux que de contribuer, si le gouvernement me suit, à ce qu’il y ait des dépôts importants. »
Faire vivre le musée
Mais d’ici là, le nouveau musée devra compter avec l’existant, c’est-à-dire la collection du musée de l’IFAN. « Tous les musées européens sont centrés sur l’objet, remarque Hamady Bocoum. Nous, on sera sur le vivant. » Comprenez sur le patrimoine immatériel, l’oralité, mais aussi l’art contemporain.
Quid du rôle des Chinois une fois le bâtiment livré ? « Ils avaient tendance à considérer le Grand Théâtre national, qu’ils ont aussi construit, comme leur antichambre, confie un observateur sénégalais avisé. J’espère qu’ils ne voudront pas non plus vampiriser le musée. » Hamady Bocoum, lui, est catégorique : « Ils ne vont pas nous imposer d’expositions. »
Reste une dernière inconnue, le budget de fonctionnement. « L’Etat mettra à disposition ce qu’il faut pour faire autre chose qu’un élément de divertissement », affirme le directeur de l’établissement, sans donner de détails chiffrés. Espérons qu’après les promesses, ce nouvel équipement ne se transformera pas en coquille vide. On le sait, il est facile d’ériger un musée, mais bien plus compliqué de le faire vivre…
Roxana Azimi contributrice Le Monde Afrique
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com