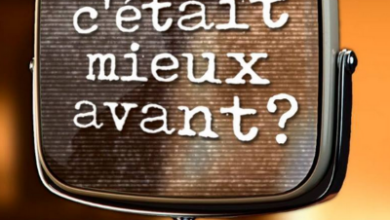A qui la faute ? Face à la catastrophe syrienne, la tentation de désigner les coupables devient irrésistible.
A qui la faute ? Face à la catastrophe syrienne, la tentation de désigner les coupables devient irrésistible.
D’Ankara à Washington en passant par les capitales arabes et européennes, depuis quelques jours, le « blame game », comme disent joliment les anglophones, bat son plein. Et c’est vers le président des Etats-Unis que pointe le même doigt accusateur.
L’amertume à l’égard de la passivité présumée du chef de la Maison Blanche n’a d’égal que le désespoir qui commence à s’exprimer ouvertement, comme si l’on prenait subitement conscience d’une faillite collective. Les conséquences de ce drame sont pourtant là, béantes, visibles aux yeux du monde entier depuis quelque temps déjà : la destruction humaine et matérielle d’un pays, l’exode de millions de réfugiés, la Méditerranée fossoyeuse, le terrorisme exporté en Europe où le populisme sort renforcé de ce chaos. Ce qui est nouveau, c’est la victoire de la Russie.
En imposant, par un degré de force militaire que les Occidentaux n’ont pas osé employer, un renversement du rapport des force en Syrie, le président Vladimir Poutine a créé un choc politique que les diplomates ont encore du mal à absorber. Le cynisme de la Russie qui, entrée en guerre en Syrie le 30 septembre 2015 sous prétexte de se joindre à la lutte contre l’organisation Etat islamique (EI), a en réalité essentiellement œuvré pour renforcer le régime de Bachar Al-Assad et laminer l’opposition des rebelles, a produit une étonnante sidération. La violence de l’offensive sur Alep, menée par le régime syrien avec l’appui des forces russes, au moment où les Américains s’évertuaient gentiment à réunir des négociateurs à Genève, semble même avoir ouvert les yeux du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, sur les véritables intentions de Moscou. Un peu tard.
« Zéro solution »
Nulle part ce choc politique n’est aussi violemment ressenti qu’en Turquie. Des entretiens avec plusieurs hauts responsables turcs et diplomates occidentaux à Ankara, organisés cette semaine par le think tank European Council on Foreign Relations et auxquels Le Monde a été associé, ont révélé un profond pessimisme et, du coup, l’ampleur du ressentiment des dirigeants turcs à l’égard de Washington.
Pour Ankara, qui espérait la chute de M. Assad, ce n’est pas seulement la victoire de la Russie qui est accablante, c’est l’effondrement d’une politique étrangère optimiste bâtie sur le principe « zéro problème ». Par sa position géographique, la Turquie est aujourd’hui au cœur d’une crise historique du bassin méditerranéen sur laquelle elle n’a pas de prise, et voit la question kurde s’amplifier. « Au sud, nous avons deux pays brisés, la Syrie et l’Irak, explique un responsable. A l’ouest, les Balkans, qui requièrent encore l’attention de l’Union européenne et de l’OTAN. Au nord, la Russie qui exploite le vide politique avec une politique expansionniste. » De « zéro problème », la Turquie d’Erdogan est passée en quelques années à « zéro solution ».
Sa décision d’abattre un avion de chasse russe en novembre 2015 a rendu le président Poutine furieux, bien plus, à en juger par la virulence de ses commentaires, que la destruction d’un avion de touristes russes par l’EI. Aussi ombrageux l’un que l’autre, le tsar et le sultan ne se parlent plus. Plus grave, le déploiement, dans le nord de la Syrie, de missiles sol-air russes S-400 a créé de facto une zone de non-survol d’un rayon de 400 km, qui ruine les velléités de la Turquie de créer une zone tampon près de sa frontière avec la Syrie, par laquelle transite un flux ininterrompu de réfugiés. En prenant l’avantage sur le terrain, la Russie a évincé la Turquie.
Membre de l’OTAN, la Turquie ne peut guère agir seule. Ankara ne se gêne donc pas pour dire que « le problème, c’est le commander in chief ». En renonçant, le 31 août 2013, à intervenir contre le régime syrien qui avait eu recours à l’arme chimique, le président américain, Barack Obama, « a pris la mauvaise décision, et ça a renversé les tables », dit un haut fonctionnaire turc. « Et aujourd’hui, nous sommes de nouveau entre ses mains. » « Tout l’ordre mondial reposait sur l’idée que c’était les Etats-Unis qui menaient, s’étrangle un autre. Mais s’ils ne veulent pas, qu’est-ce qui se passe ? Sans l’Amérique, il est impossible de neutraliser la Russie ! »
« La Syrie, c’est le problème du successeur »
Le ministre français des affaires étrangères, Laurent Fabius, n’a pas dit autre chose en dénonçant, mercredi 10 février, « les ambiguïtés » du « principal pilote de la coalition ». Plus d’un diplomate occidental s’alarme aussi de l’évolution d’une situation qui, selon l’expression de l’un d’eux, « dépend de décisions prises à Moscou et, de plus en plus, à Téhéran, plutôt que dans les capitales occidentales ». L’influence grandissante de l’Iran sur le terrain en Syrie n’est pas pour les rassurer. Voire au-delà : « A présent, avance un dirigeant turc, l’Iran contrôle quatre capitales : Bagdad, Damas, Sanaa et Beyrouth. »
Dans la presse américaine, les critiques redoublent. Un éditorial du Washington Post accusait mercredi l’administration Obama d’avoir été « un modèle de passivité et de confusion morale » dans l’affaire syrienne et John Kerry, le secrétaire d’Etat, de naïveté. Même sévérité chez les alliés arabes des Etats-Unis : dans The Cairo Review, Hicham Melhem, chroniqueur de la chaîne Al-Arabiya, attribue le désastre actuel à « l’indécision d’Obama et à ses volte-face ». « Rarement un président américain a réussi à se mettre à dos simultanément, et avec autant d’amertume, les Arabes, les Israéliens et les Turcs », relève-t-il.
Certains se souviennent qu’un autre président américain, Bill Clinton, avait fini par intervenir en Bosnie, en 1995. Après 100 000 morts. « Combien de Srebrenica faudra-t-il en Syrie ? », demande un dirigeant turc. « Mais l’administration Obama fait ses cartons, répond un autre. La Syrie, c’est le problème du successeur. » Les seuls, finalement, à ne pas en vouloir à M. Obama sont les Russes.
Sylvie Kauffmann (Ankara, envoyée spéciale)
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com