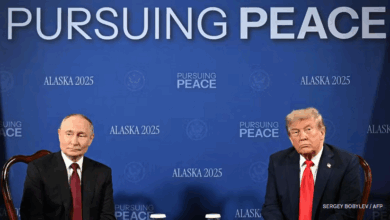Le débat s’est ouvert, en interne, parmi les responsables français de la défense : faut-il basculer des forces vers la Syrie et l’Irak, face à l’Etat islamique (EI), ou continuer à consacrer l’essentiel des moyens militaires à la lutte contre Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ?
Le débat s’est ouvert, en interne, parmi les responsables français de la défense : faut-il basculer des forces vers la Syrie et l’Irak, face à l’Etat islamique (EI), ou continuer à consacrer l’essentiel des moyens militaires à la lutte contre Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ?
L’attentat de Bamako vient donner raison aux partisans de la seconde option. Paris a dépêché, vendredi 20 novembre, 50 gendarmes et un détachement de forces spéciales, présent dès le début d’après-midi, sur la prise d’otages de l’hôtel Radisson Blu. La force Barkhane, basée à Gao et dans plusieurs autres villes du nord du pays, n’a pas été déployée dans la capitale malienne.
L’équilibre des opérations extérieures n’a pas changé depuis les attentats de janvier, qui ont justifié une évolution radicale de la posture sécuritaire française. Mais, sous la pression des attentats du 13 novembre à Paris, le débat pourrait se montrer plus ouvert dans les semaines à venir. « Nous ne disons pas que la question d’un rééquilibrage des moyens ne se posera pas », répondait-on dans l’entourage du ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, au lendemain des attaques. « Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre l’EI demandée par le président, il se peut qu’à un moment ou à un autre, on ait besoin d’alléger notre présence sur un de nos deux autres théâtres, Sahel ou Centrafrique. »

Début novembre, devant les députés de la commission de la défense, M. Le Drian avait rappelé qu’il n’était « pas favorable à la diminution du nombre de militaires engagés dans l’opération “Barkhane” pour l’instant ». Il avançait deux raisons : la nécessité de contenir les « actions de harcèlement » des groupes armés liés à AQMI – attentats et bombes artisanales –, mais aussi les risques d’une contagion de l’instabilité en Libye, où l’EI s’enracine autour de Syrte, dans le nord. Cette position a été réaffirmée après les attentats du 13 novembre par de hauts responsables : « Il n’y a pas, pour l’heure, de redistribution des moyens. »
Lire aussi : Comment Paris s’est converti à l’interventionnisme
« Concentration des moyens »
Derrière les discours combatifs de François Hollande sur la Syrie, la priorité opérationnelle reste « Barkhane », au Sahel. Elle mobilise 3 500 à 3 800 hommes, selon les opérations, des moyens de renseignement significatifs, et des forces spéciales, lancées dans de durs combats. La dernière opération importante, « Vignemale », s’achève dimanche. Au Mali, 600 soldats ont été envoyés dans ce cadre, durant un mois, dans le nord du pays, pour « un ratissage » des caches d’armes, sans cesse réapprovisionnées, des katibas de la région de Tessalit. Paris vient, en outre, d’annoncer avoir contribué au renforcement de l’état-major de la force de l’Organisation des Nations unies au Mali, la Minusma, à la demande du département des opérations de maintien la paix.
De quoi satisfaire l’état-major. « Si nous nous retirons du Sahel, la région sera immédiatement réinvestie dans son entier par les groupes armés, c’est une certitude », dit-on de façon officieuse. Au Mali, la menace d’AQMI est jugée réduite, même s’il est « nécessaire de continuer à mettre la pression ». Un responsable du renseignement confiait récemment : « Les groupes armés utilisent des modes d’action militaires sauf quand ils sont en position de faiblesse. Ils passent alors, ce qui est le cas aujourd’hui, à des modes terroristes. »
Lire aussi : Face à l’EI, l’armée française dans les « zones grises » du droit
Le haut commandement fait passer un message : « La concentration des moyens » est l’une des lois essentielles de la guerre. Car, avec des moyens limités, et des lacunes persistantes – sur le ravitaillement en vol, les avions de transport, les drones, capacités que la France doit solliciter de ses alliés –, les généraux craignent d’épuiser les armées dans trois guerres simultanées. Ils ne veulent pas être entraînés par les Américains, comme l’ont été les Britanniques en Irak, dans une guerre hors de portée au Moyen-Orient.
Pour eux, les données de l’équation n’ont pas changé. « Au Sahel, la France est devant, au Levant, elle est coéquipière », répète le général Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées. L’opération « Barkhane » voit son efficacité contestée, puisque la situation sécuritaire du Mali reste toujours aussi précaire. Mais elle atteint son but, selon Paris : maintenir le niveau du problème terroriste à un niveau gérable par les pays de la région eux-mêmes, désormais réunis dans un « G5 Sahel » et assistés par les forces onusiennes.
« Montée en puissance peut-être un peu tardive »
En Syrie et en Irak, la France comptait jusqu’à présent pour 5 % des frappes aériennes. Le dispositif repose sur 700 militaires et 12 avions de chasse. C’est au porte-avions, dont le renfort a été décidé par le président de la République, le 14 novembre, qu’il revient, pour l’heure, d’incarner « l’intensification » de la lutte contre EI, pour une mission de quatre mois.
Mais après ? La France réclame de l’aide à ses partenaires pour le Sahel, afin de soulager son effort militaire. « Nous constatons que les Européens sont de plus en plus présents au sein des effectifs de combat et de logistique de la Minusma : aux Néerlandais et aux Suédois vont se joindre des Allemands et des Danois. Cette montée en puissance est peut-être un peu tardive, mais c’est une bonne chose », a précisé M. Le Drian, devant les députés, le 3 novembre.
Après les attentats de Paris, l’appel a été renouvelé en invoquant une clause d’assistance européenne du traité de Lisbonne, une trouvaille du conseiller diplomatique du ministre. Peu d’engagements concrets ont suivi, même si le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy – mais c’était avant l’attaque de Bamako –, appelait à « relever la France dans ses actions de contrôle militaire en Afrique », comme l’a relaté El Pais. Dans son édition de vendredi 20 novembre, le quotidien espagnol rappelle que le pays n’a fourni que 117 militaires au Mali, son aide se portant surtout sur des moyens logistiques. Il n’y a pas vraiment encore de quoi permettre à l’armée française de quitter le front africain.
Nathalie Guibert
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya