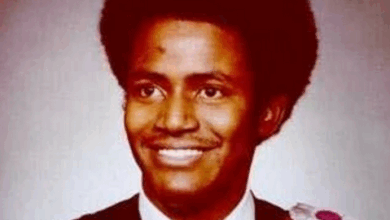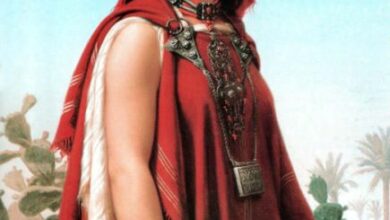Le dispositif judiciaire mauritanien : A l’instar des pays du Maghreb, la Mauritanie s’est doté d’un dispositif judiciaire spécifique en matière de lutte contre le terrorisme.
Le dispositif judiciaire mauritanien : A l’instar des pays du Maghreb, la Mauritanie s’est doté d’un dispositif judiciaire spécifique en matière de lutte contre le terrorisme.
La loi 035/2010, modifiant et remplaçant la loi 47/2005 relative au terrorisme a mis en place une police spécialisée, un pole judiciaire spécialisé composé d’un parquet anti-terroriste et d’un pole d’instruction au niveau du tribunal de Nouakchott, avec une compétence nationale. La compétence de connaitre des crimes terroristes est dévolue à la Cour criminelle de Nouakchott. Cette dernière n’étant pas intégrée au pole judiciaire, comme dans d’autres systèmes.
Ce dispositif maintient le juge au cœur de la lutte antiterroriste, et préserve un certain équilibre entre efficacité de lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux…
L’objet de ce propos est de porter un éclairage sur le traitement des affaires du terrorisme par le juge en charge de ces dossiers.
Le traitement judiciaire devant le juge d’instruction
Le juge d’instruction chargé du terrorisme a la pleine maitrise de ses dossiers. Il prend ses décisions librement sans recevoir d’injonctions de quiconque, en particulier de sa hiérarchie ou du procureur de la république.
Les règles applicables au juge d’instruction s’appliquent aux juges du pole anti-terroriste avec quelques aménagements qui concerne les ordonnances relatives à la détention et la saisie des biens en relation avec une entreprise terroriste.
En matière de terrorisme, les suspects sont gardés à vue pendant une durée de 15 jours renouvelable deux fois. Ce stade échappe au juge d’instruction qui peut, toutefois, être sollicité par voie de commission rogatoire à intervenir pour autoriser la police judiciaire à intercepter les communications du suspect, en cas d’existence d’indice en lien avec une entreprise terroriste.
Une fois l’enquête préliminaire est bouclée, l’intéressé est déféré devant le parquet anti- terroriste qui procède à son audition, qualifie les faits et renvoie l’affaire devant le pole d’instruction avec une demande d’ouverture d’information et le dépôt ou la mise sous contrôle judiciaire de la personne, selon la gravité des faits. C’est là qu’intervient le rôle du juge d’instruction. Ce dernier se met directement en contact avec le bâtonnat, en vue de lui désigner un avocat d’office pour assister le ou les prévenus pendant la première comparution. Il informe en même temps les deux juges, membres du pole. Le prévenu assisté de l’avocat désigné d’office comparait devant le pole d’instruction réuni en audience.
Lors de la première comparution et avant toute inculpation, le juge (coordinateur du pole) prend l’identité de la personne mise en examen et l’informe qu’il a droit de choisir librement un avocat de son choix. IL lui notifie les faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification et l’avertit ensuite, qu’elle est libre de répondre ou de s’abstenir de faire des déclarations.
A ce stade, on s’efforce d’avoir le maximum d’informations sur l’engagement du prévenu en faveur de la cause djihadiste, sur son enrôlement dans les groupements armés, sur l’action terroriste qu’il a commise ou qu’il était sur le point de commettre. Sur ce point, les avocats de la défense nous reprochent parfois de vouloir procéder à un interrogatoire de fond, là ou la loi ne l’autorise pas. Cependant, les dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Pénale n’imposent pas une forme particulière pour la notification des faits reprochés au prévenu. Et donc, elles n’interdisent pas au magistrat de notifier les faits sous forme de question multiforme à laquelle, le prévenu est appelé à répondre par une réponse uniforme.
Une fois la première comparution achevée, le pole délibère collégialement sur les réquisitions du parquet et notifie sa décision au prévenu et son conseil qui peut faire appel de cette décision devant la chambre d’accusation.
Il faut souligner qu’au stade de la première comparution, le juge peut faire un interrogatoire préliminaire, conformément à l’article 102 du CPP. Dans la pratique, nous procédons souvent à des interrogatoires préliminaires, quand il s’agit de faits particulièrement graves, parce que le prévenu, une fois qu’il entre en contact avec ses codétenus ou son conseil, il commence à nier les faits. Ces changements d’attitude mettent en difficulté le juge, et l’obligent à changer de stratégie. Ce qui n’est pas une tache facile.
Au cours de l’interrogatoire de fond, le juge pose à la personne mise en examen toutes les questions utiles. Il l’interpelle au vu des éléments du dossier. Il le met, le cas échéant face à ses contradictions. Compte-tenu du comportement changeant des terroristes présumés, Il est préférable de procéder en plusieurs séances pour parvenir à des résultats.
Le juge doit éviter de reproduire les questions du p.v. de l’enquête préliminaire. Il doit exploiter tous les éléments de l’affaire, auditionner des témoins, ordonner une expertise s’il y’a lieu dans le but de parvenir à la vérité. La recherche de la vérité ne se cantonne pas aux faits. Le juge anti-terroriste se doit aussi d’éclairer la personnalité de l’individu mis en examen, qu’il s’agisse de sa vie, de sa condition et de ses antécédents.
Il doit au départ chercher à établir un contact humain, une relation de confiance avec le prévenu, de telle sorte à lui donner le sentiment qu’il n’a pas d’aprioris contre elle et que son rôle consiste à l’aider à se justifier et à s’expliquer sur les motivations qui l’ont conduit à basculer dans le radicalisme religieux et les raisons de son acte. Le rapport humain favorise la compréhension mutuelle et facilite la tache au juge qu’une relation chargée d’animosité. L’expérience démontre que cette catégorie de personnes est très sensible à cette approche, car il s’agit le plus souvent de personnes fragiles en proie à des difficultés, à des échecs et qui trouvent dans l’extrémise religieux un moyen d’exprimer leur personnalité et de donner un sens à leur vie.
De manière générale, le juge doit procéder graduellement par palier, éviter toute prise de position ou de jugement par rapport au dossier et de respecter les droits du prévenu (présomption d’innocence, droit d’être assisté d’un avocat, droit de répondre ou de s’abstenir de répondre, etc.). Il doit également respecter l’obligation d’instruire à charge et décharge. Le respect de principe est d’autant plus nécessaire, que la tendance en matière de terrorisme est la condamnation d’office du suspect, coupable aux yeux de l’opinion publique et du monde extérieur.
D’où la difficulté pour le juge par fois de faire admettre sa conviction. Mais quelque soit les pesanteurs, le juge d’instruction doit donc, observer un juste équilibre entre l’exigence, de recherche de la vérité et le respect des droits fondamentaux de l’individu et surtout les droits de la défense.
A cet égard, il faut souligner que le rôle du juge d’instruction et de l’avocat ne sont pas toujours les mêmes. Le juge recherche la vérité, alors que l’avocat cherche, le plus souvent, un résultat, la libération ou l’acquittement de son client.
Le juge doit exploiter les créneaux de coopération judiciaire, s’il y’a lieu , en formulant des demandes d’entraide judicaire a l’adresse des autorités judiciaires étrangères sur les questions susceptibles d’éclairer son enquête.
A l’issue de son information, lorsqu’il l’estime achevée, le juge décide de sa clôture. Une fois l’instruction est achevée, le juge d’instruction doit apprécier l’ensemble des éléments en sa possession pour se faire une conviction sur le dossier. S’il constate qu’il y’a des preuves suffisantes (aveux corroborés par des indices, par ex.), il ordonne le renvoi de l’affaire devant la Cour criminelle. Dans le cas contraire, il prononce un non- lieu.
Des obstacles à la mission du juge
Il faut souligner que la tache n’est pas facile et que le juge est confronté à des difficultés dans ces rapports avec les autres organes impliqué ses dans la lutte contre le terrorisme. Ces difficultés peuvent découler de la méfiance, de la méconnaissance des lois ou de l’absence de coordination. L’absence de mécanismes opérationnels de coopération judiciaires entre les Etats peut aussi entraver le travail du juge d’instruction, appelé dans certains cas émettre ou a exécuter des demandes d’entraide judiciaire.
Cependant quelques soient les difficultés, le juge anti -terroriste doit rester serein et imperturbable et user de tous les moyens dont ils disposent pour faire aboutir ses investigation toujours dans le respect des procédures. Parce qu’il est différent du juge ordinaire par son statut, par la nature de sa mission, soumise à des impératifs, à la fois internes et externes.
[ Mohamed Bouya O Nahy, Ex- juge d’instruction chargé du terrorisme]
Source : ANI
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com