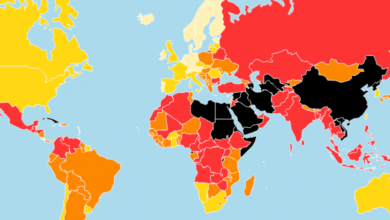À des années-lumière du Brooklyn qui s’embourgeoise, reportage à Brownsville, New York. L’histoire de ce quartier afro-américain ressemble à celle de dizaines d’autres : pauvreté, violence, ségrégation et tensions avec la police, seul service public sur place.
À des années-lumière du Brooklyn qui s’embourgeoise, reportage à Brownsville, New York. L’histoire de ce quartier afro-américain ressemble à celle de dizaines d’autres : pauvreté, violence, ségrégation et tensions avec la police, seul service public sur place.
Les politiques s’en désintéressent, les médias aussi. C’est pourtant d’ici qu’est poussé ce cri du cœur depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, sous la forme du hashtag « Black lives matter » (la vie des Noirs a de l’importance).
De notre correspondante à New York.- Ici, il n’y a que des cités, à perte de vue. Des immeubles aux tons ocre et marron hérités des années 1960. Nous sommes à Brownsville, à l’est de Brooklyn, à 45 minutes en métro de Manhattan, le poumon économique de New York. Un quartier dont on ne parle jamais si ce n’est lorsqu’un fait divers ou une statistique confirme son statut de zone pauvre et dangereuse, ne s’améliorant guère. Ce quartier de cinq kilomètres carrés enregistre le plus haut taux d’homicides de la ville, une moyenne de 70 fusillades et une vingtaine de meurtres par an, depuis six ans. Si la police y constate une baisse constante de la criminalité depuis la fin des années 1990, elle est sans commune mesure avec les progrès que connaît le reste de la ville.
Il a tout du ghetto urbain. En marge, triste, seule la présence policière laisse à penser que les pouvoirs publics n’ont pas totalement abandonné. La police est omniprésente : à pied, en voiture, dans des tours de guet mobiles installées entre les grands ensembles… Ses rapports avec les habitants ne sont pas bons. Tensions, peur et insatisfaction dominent, des deux côtés.
Ainsi Brownsville illustre parfaitement l’ampleur des problèmes qui affectent encore la communauté afro-américaine et qui sont revenus au cœur du débat depuis l'été dernier, plus particulièrement depuis les affaires Mike Brown, dans le Missouri, au sud du pays, et Eric Garner à New York. La mort de ces jeunes hommes (dont nous avons parlé ici, ici et encore ici), tués alors qu’ils n’étaient pas armés, par des officiers de police qui ne seront finalement pas poursuivis par la justice, a suscité l’émoi à travers le pays. Une série de manifestations ont été organisées aux États-Unis, sous la bannière « Black Lives Matter ». Sporadiquement, elles se poursuivent.

D’abord, des affaires de brutalités policières. Elles sont devenues progressivement les symboles d’un problème bien plus vaste, celui des conditions de vie d’Afro-Américains se sentant laissés-pour-compte, exclus du système, discriminés. Ce débat-là ne cesse de s’élargir, au risque de partir un peu dans tous les sens : il y va désormais des rapports entre la police et les communautés de couleur, de la manière dont le système judiciaire traite les Afro-Américains, de discrimination et de racisme, d’écarts de richesse entre Blancs et Noirs, de l’histoire récente de la ségrégation raciale et de ses solides résidus…
Il nous a donc semblé nécessaire de prendre de la distance avec l’actualité, avec ces affaires qui se répètent et se ressemblent, et de se rendre dans l’un de ces quartiers lorsqu’il ne s’y produit rien de « particulier ». Le but étant d’écouter les habitants, mais aussi de prendre du recul avec les déclarations des uns et des autres, du maire progressiste de New York, Bill de Blasio, jusqu’au président Barack Obama. Tous deux promettant depuis leur élection de rétablir les liens de confiance entre la police et les minorités, ou encore de lutter contre la pauvreté qui frappe plus sévèrement les Noirs que les Blancs.
Premier constat : à Brownsville, les habitants ne se soucient pas tellement des affaires Mike Brown ou Eric Garner, des rassemblements sous la bannière « Black Lives Matter », des promesses des élus… La grande majorité de ceux avec qui nous discutons ne sont d’ailleurs pas allés manifester. « Les gens qui vivent à Brownsville ont leur propre bataille à mener », résume Joycelyn Maynard, à la tête de la petite antenne de la bibliothèque municipale nichée au pied des HLM, un havre de paix et de socialisation rare dans le quartier, où l’on trouve des fast-foods mais aucun café.

Aux yeux des habitants, il y a des drames plus immédiats. Près de Pitkin Avenue, l’artère commerçante de Brownsville, chez l’un des barbiers du quartier, on s’empresse ainsi de nous montrer le petit autel dressé en mémoire d’Akai Gurley, « un ami ». Ce jeune homme a été abattu fin novembre dans une HLM du quartier voisin de East New York par un officier débutant qui a pris peur en le voyant apparaître dans la cage d’escalier, et a immédiatement tiré. Si l’affaire a fait scandale à New York, elle n’a pas eu le même retentissement national que les autres puisque le chef du New York Police Department (NYPD), William Bratton, a rapidement reconnu qu’une faute avait été commise. Le 10 février, le policier qui a tiré a été inculpé pour homicide et suspendu de ses fonctions.
Mike, l’un des coiffeurs du salon, s’en satisfait. Il estime que les brutalités policières et la violence diminuent un peu à Brownsville, que la situation s’apaise. Pour son collègue, Jamal, qui vit dans une HLM du quartier avec sa mère, rien ne change au contraire. « La pauvreté et la violence, c’est une spirale infernale ici, et je ne vois pas comment on va interrompre ce cercle vicieux. En priant peut-être… »
Tourner en rond
« Des familles vivent dans ces HLM depuis trois générations, depuis 45 ans ! » insiste la bibliothécaire, Joycelyn Maynard, tenant à nous faire comprendre à quel point le concept de mobilité sociale est abstrait ici, à quel point Brownsville tourne en rond. « Ces cités, vu le prix du logement à New York, c’est tout ce qu’il reste aux gens. Elles sont sacrées », précise-t-elle. Au total, dix-huit grands ensembles ont été érigés à Brownsville, ce qui représente 120 immeubles. On y trouve des tours de 18 étages, comme les 8 qui composent les Tilden Houses, jusqu’aux 27 immeubles de 6 étages des Brownsville Houses. « On a empilé les gens, comme des boîtes de conserve », poursuit Joycelyn Maynard.
Ces tours appartiennent pour la plupart à l’empire « NYCHA », souvent surnommé « Nychaland » (le pays de NYCHA). L’acronyme désigne le célèbre organisme en charge des HLM de New York depuis leur création, dans les années 1930. Cet organisme gère aujourd’hui 334 ensembles d’immeubles à travers New York, à savoir 178 895 appartements logeant quelque 600 000 personnes, où le loyer s’élève en moyenne à 450 dollars par mois.

Les tours de Brownsville datent des années 1950 et 1960, cette dernière décennie marquant un tournant dans l’histoire du quartier : d’abord exclusivement juif, celui-ci se transforma en l’espace de quelques années, sous l’afflux de population afro-américaine arrivant notamment du sud du pays, en quête de travail et de conditions de vie meilleures. C’est l’histoire d’« un ghetto qui a changé de visage », décrit ainsi l’historien Wendell Pritchett dans l’ouvrage qu’il a consacré au quartier.
Il s’est particulièrement appauvri dans les années 1980. L’écrivain Richard Price, l’auteur du roman Clockers, qui a lui-même grandi dans une tour du Bronx, le résume bien dans ce texte : « Les années 1980 furent les pires, cette décennie s’accompagnant des deux fléaux du sida et du crack. Une génération entière fut perdue dans l’addiction, l’incarcération et la mort violente. À partir de la fin des années 1980, plutôt que de quitter les HLM, des générations commencèrent à s’empiler dans le même appartement, chacune s’en tirant encore moins bien que la précédente d’un point de vue économique. »
Cette histoire s’est bien sûr répétée dans d’autres villes, de Chicago à Boston en passant par Baltimore. Y ont été fabriqués des quartiers exclusivement afro-américains où l’on fait du surplace, un processus très bien analysé par le sociologue Patrick Sharkey dans son ouvrage, Stuck in place. À défaut d’investissements publics suffisants, de soutien aux écoles publiques et de programmes y favorisant la mixité, de lutte contre les barrières à la mobilité sociale, le « rêve américain »est devenu selon lui inaccessible aux enfants qui grandissent ici.
Ce sombre constat n’empêche pas les ados de Brownsville de rêver. Nous voilà entourés de trois jeunes de 17 ans, réunis dans l’une des petites pièces du Brownsville Community Justice Center. Ce centre associatif, financé par des fonds publics fédéraux et surtout par des fonds privés, a pour objectif la prise en charge de jeunes hommes du quartier de 16 à 24 ans qui ont déjà eu affaire à la police – ayant écopé d’une amende ou d’une arrestation – afin d’éviter qu’ils ne finissent incarcérés. Car la case prison est fréquente.
Le taux d’incarcération des 16-24 ans y est l’un des plus élevés de la ville, avec une moyenne d’un jeune homme sur 12 y effectuant un séjour. Leur casier judiciaire devient ensuite un frein considérable à l’entrée dans la vie active. Le think tank Fiscal Policy Institute a ainsi calculé qu’à Brownsville et dans le quartier voisin d'Ocean Hill, 36,7 % des 18-24 ans entraient dans la catégorie « out-of-school, out-of-work », ceux qui ne sont ni scolarisés ni employés.
Jean, Ray et M. Marshall (qui ne souhaite pas être identifié par son prénom) ont accepté de discuter avec nous. Ils sont accompagnés d’une assistance sociale, Elizabeth Bernard, 26 ans, qui a également grandi ici. « Ma mère y était enseignante et elle a fait en sorte que je sois inscrite dans une école hors du quartier, ça m’a aidée à être où j’en suis », glisse-t-elle.
Quand on leur demande ce dont ils auraient envie afin d’améliorer leur quotidien à Brownsville, ils hésitent d’abord, puis les idées se mettent à fuser. « Il nous faudrait de meilleures boutiques de vêtements », « des magasins de nourriture biologique », « plus de peintures murales », « plus de lieux comme celui-ci car il n’y a pas grand-chose à faire après l’école », « plus de maîtrise de soi parce que si tu t’assois les jambes grand écartées lors d’un entretien d’embauche, ça ne va pas marcher », « plus de solidarité et de confiance à l’intérieur du quartier ». « On sait tous ce que c’est de vivre dans la pauvreté, mais au lieu de s’aider, de s’unir, les gens ont tendance à se diviser. »

Ils pensent tout particulièrement aux gangs, un problème persistant ici. « Avant, il y avait deux groupes bien distincts », explique Ray, faisant référence aux Bloods et aux Crips, les deux gangs afro-américains nés en Californie dans les années 1970. « Maintenant, il y a une collection de sous-groupes qui ne savent même plus à quel grand groupe ils appartiennent, c’est incompréhensible. C’est la chose la plus ridicule qui soit », poursuit le jeune homme, d’un air las, précisant qu’il est en train de surveiller son petit frère de 14 ans, « très attiré par les gangs ». Mais aucun n’est capable de nous expliquer clairement quels sont les buts concrets des gangs aujourd’hui.
Nous en discutons alors avec James Brodick, à la tête de ce centre ouvert en 2011 et qui fut auparavant en charge d’une initiative similaire dans un autre quartier de Brooklyn, à Red Hook. « L’activité des gangs n’est plus liée à la distribution de la drogue, à l’argent qu’on peut en tirer », analyse-t-il, précisant qu’il y a toujours « un problème d’usage de drogues dans le quartier, mais plus un problème d’addiction comme dans les années 1980-90. » La vitalité des gangs s’explique donc par un sentiment d’appartenance territoriale exploité à l’extrême : « Tu viens d’une autre tour que la mienne donc je te déteste », sans autre argument. « C’est une histoire d’ennui et de désespoir… Ici, les jeunes hommes mesurent leur valeur en fonction du nombre de filles qu’ils ont et de mecs avec qui ils s’embrouillent. »
Le tout avec des armes à feu et en jouant au chat et à la souris avec la police. La lutte contre les gangs et la mise hors circulation des armes à feu sont donc les objectifs principaux du commissariat du quartier, le « 73rd Precinct ». (Nos demandes d’interview auprès du NYPD sont à ce jour restées lettre morte, nous n’avons donc pu discuter avec des officiers locaux.) Parmi les règles en cours pour faire face aux gangs, figure par exemple l’interdiction de se promener dans les rues de Brownsville en groupe de plus de cinq personnes.
« On se retrouve avec des débutants terrorisés »

« Le samedi soir, personne ne sort à Brownsville. Il y a des coups de feu, lâche Ray lors d’une promenade entre les grands ensembles, un samedi après-midi. Au bout du compte, tu ne te sens protégé par personne ici, ni par les gangs ni par la police, c’est absurde. » Ray, Jean, M. Marshall ainsi qu’Elizabeth, leur assistance sociale, expriment tous de la défiance à l’égard de la police, qu’ils voient comme agressive et paranoïaque.
Les deux études réalisées par le Brownsville Community Justice Center en 2010 et 2013 auprès de la population locale révèlent ainsi des relations complexes avec la police. 66 % des sondés ne sont pas d’accord avec l’affirmation, « la plupart des officiers de police traitent les gens avec respect ». Seuls 15 % des sondés estiment qu’une présence policière accrue est une approche prometteuse pour lutter contre la criminalité. Mais ces mêmes études révèlent qu’une majorité des sondés voit « l’importante présence policière » comme l’une des plus grandes forces du quartier…
« Cela illustre bien la nature du débat en cours sur le NYPD. Les gens veulent des policiers, ils ont besoin de la police, mais pas de n’importe quelle police. Ils veulent se sentir en sécurité sans avoir l’impression de vivre dans un État policier. Il reste à savoir comment atteindre cet équilibre », analyse James Brodick, dont le centre travaille main dans la main avec le commissariat local.
Et ce débat sur le NYPD dépasse bien sûr les frontières de Brownsville. Les pratiques de la police new-yorkaise – qui compte le plus gros effectif d’officiers aux États-Unis – sont au cœur d’un débat politique vif à New York. Il y eut d’abord la remise en cause de la méthode dite du stop-and-frisk. Cette méthode autorise un officier, en cas de « suspicion raisonnable », à contrôler, palper ou fouiller n’importe qui. Elle fut progressivement assimilée à de la discrimination au faciès par des associations de défense des droits civiques représentant les minorités afro-américaines et hispaniques, s’estimant harcelées. (Voir une vidéo réalisée par le NewYork Timessur le stop-and-frisk).
La manière dont le NYPD y avait recours avait même fait l’objet d’un procès en 2013, et elle fut jugée discriminante (nous en parlions ici). Au même moment, le candidat Bill de Blasio faisait campagne en promettant d’abolir cette pratique et de réformer le NYPD : il a été élu maire de New York fin 2013 et est entré en fonctions en janvier 2014.
Depuis, le nombre d’arrestations dites « stop-and-frisk » recule. Et c’est désormais un autre aspect du fonctionnement policier new-yorkais qui est mis en cause : la théorie de la vitre cassée. Ou comment les policiers ne doivent laisser passer aucune infraction mineure, puisque celles-ci constituent, selon cette théorie, la porte d’entrée vers des crimes et délits plus graves. La mort d’Eric Garner, en juillet 2014, et la décision d'un grand jury, en décembre dernier, de ne pas inculper le policier impliqué, ont particulièrement alimenté ce débat : l’homme vendait illégalement des cigarettes à l’unité dans une rue de Staten Island, au sud de l’île de Manhattan, quand il a été appréhendé par des policiers, l’un d’entre eux l’attrapant par le cou pour le plaquer à terre, jusqu'à provoquer sa mort par étranglement. Inutile de dire que cette affaire a aussi relancé le débat sur les techniques d’arrestation du NYPD, la formation des officiers ou encore leur niveau de stress.

Dans un quartier comme Brownsville, on s’emporte surtout contre le système des « zones d’impact ». Sont ainsi nommés les quartiers enregistrant les taux de criminalité les plus élevés, dans lesquels se retrouvent systématiquement envoyés les policiers débutants, les « rookies ». « C’est la chose la plus frustrante pour moi ! Ici on a besoin des meilleurs dans tous les domaines, la police, la santé ou l’éducation. Et on se retrouve avec des débutants terrorisés. On cumule les handicaps », s’emporte James Brodick. Il reste tout de même optimiste. « Cela fait un an que William Bratton (le chef du NYPD) promet de réformer ce système des zones d’impact. J’attends de voir, mais le débat est tel que des choses vont forcément changer. »
Rares, toutefois, sont ceux qui partagent cet optimisme… Lors d’une conférence sur la réforme du NYPD, comme il en est organisé quasiment toutes les semaines à New York ces temps-ci, nous rencontrons Norman Siegel, qui a été quinze ans durant à la tête de la New York Civil Liberties Union, l’association new-yorkaise, phare de la lutte pour les droits civiques, et qui reste un avocat très mobilisé sur le sujet. « Il y a tant de pistes qui pourraient être explorées pour réformer le NYPD et qui ne le sont pas… Cela va de l’importance des patrouilles à pied afin de nouer des liens avec la communauté, jusqu’à un meilleur suivi psychologique des officiers tout au long de leur carrière, nous dit-il. Nous en sommes loin. Hier encore, William Bratton parlait de ses “troupes” et de son département en des termes militaires… C’est inquiétant. » Était en effet annoncée, le 29 janvier, la formation d’un nouvelle unité anti-terroriste à l’intérieur du NYPD : 350 officiers qui seront équipés de boucliers et de mitrailleuses et pourront être mobilisés en cas de manifestation.
Norman Siegel ne cache pas sa colère à l’encontre de Bill de Blasio, pour qui il a voté. « Je suis extrêmement déçu. Et je ne suis pas le seul à penser que sa réélection se jouera là-dessus, sur sa capacité à améliorer ou non les relations entre la police et les minorités à New York. » Nous discutons ensuite de Brownsville, « ce genre de quartier où personne n’a l’air de vouloir s’attaquer aux racines des problèmes de criminalité, au délabrement économique et social », analyse-t-il. « Tout passe par le maintien de l’ordre, les services sociaux sont sous-financés, exsangues. »
De petits pansements, à défaut d'une politique urbaine suffisante
Norman Siegel nous rappelle les conclusions de la commission mise en place par le président Lyndon Johnson en 1965 afin d’étudier « le maintien de l’ordre et l’administration de la justice » aux États-Unis. Le président Johnson déclarait alors que la solution à long terme pour combattre le crime résidait dans « le travail, l’éducation, l’espoir ». Pour Norman Siegel, « cela fait donc plus de quarante ans que l’on dit qu’il faut surtout s’attaquer à la pauvreté, qu’il faut des politiques sociales solides. On a tout simplement échoué ».

Difficile de contredire cette analyse en observant Brownsville. « Ce quartier est d’autant plus abandonné que son poids politique est quasi-nul : il n’est pas très organisé, à la différence d’un quartier historiquement afro-américain comme Harlem par exemple, il ne fait pas partie des points de passage obligatoires d’un élu en campagne », poursuit-il. Leurs élus, les habitants de Brownsville disent ne quasiment jamais les voir, de ceux qui siègent au conseil municipal, Darlene Mealy et Inez Barron, jusqu’à Hakeem Jeffries, élu démocrate à la Chambre des représentants, à Washington, où il représente le district dans lequel se situe Brownsville.
« Ils n’ont pas d’argent », tranche Javon Johnson, fondateur d’une petite association locale, Empowering youths toward excellence, qui a pour but d’occuper les écoliers après les cours, notamment en entretenant les squares du quartier, puis d’essayer de les mettre sur le chemin de l’université. « Je les emmène visiter des campus au nord de l’État de New York. Je veux qu’ils comprennent qu’il y a deux types de voyages bien distincts au nord de l’État, à la fac ou à la prison. »
Cette année, il dit avoir reçu « 700 dollars de la part de la conseillère Darlene Mealy ». Ses financements viennent pour le reste de donations d’habitants et d’églises locales. « J’espère toucher des fonds fédéraux dans le cadre de l’initiative d’Obama, My Brother’s Keeper (lancée en février 2014 afin d’aider les jeunes hommes de couleur), j’attends des nouvelles de Hakeem Jeffries pour savoir si on peut en bénéficier… »
Avec Javon Johnson, nous recensons les petites initiatives locales comme la sienne, nous passons devant les locaux de l’Armée du Salut, devant un énième job center, un centre d’aide au retour à l’emploi créé par une fondation privée et inauguré par le maire en novembre dernier. Nous y entrons. Ils nous disent avoir 70 personnes dans leurs fichiers à ce jour, un chiffre qui paraît ridiculement bas quand le taux de chômage du quartier dépasse les 25 % (contre une moyenne de 6,4 % à New York).

Ce tissu associatif donne surtout la mesure des errements de la politique publique. Brownsville ne manque pas d’associations attentionnées et de bonnes volontés, mais sans coordination et sans direction commune, cela donne une collection de petits programmes, des pansements posés sur le quartier, occasionnels et rarement durables. L’argent y semble ainsi saupoudré au hasard… Rien n’illustre mieux cette tendance que la jolie histoire de la Mott Hall Bridges Academy, une école du quartier qui, au moment où nous nous intéressons à Brownsville, se retrouve submergée de dollars et d’attention médiatique.
La Mott Academy est une école de 191 élèves de 11 à 13 ans. Créée en 2011, elle est logée dans un bâtiment de Brownsville, qui abrite trois écoles différentes, toutes publiques mais gérées séparément. Surprenant découpage, résultat du mouvement dit des « petites écoles », né au milieu des années 2000 à New York, qui se veut une tentative de sauvetage des écoles publiques des quartiers pauvres de la ville, aux résultats catastrophiques, fermées puis redécoupées. Une méthode qui n’a pour le moment rien donné de spectaculaire…
À sa tête, on trouve la principale Nadia Lopez, une femme inspirée, déterminée à ouvrir des perspectives aux écoliers du quartier, à leur donner envie d’aller à la fac, et avant tout à leur mettre en tête que leur vie de jeune de couleur a de la valeur. Des petits messages punaisés dans l’école le rappellent : du désormais classique « Yes we can », aux tee-shirts « I matter » (Je compte) fournis aux étudiants, en passant par la célèbre formule de Victor Hugo « Ouvrez une école, vous fermerez une prison », affichée dans son bureau. Tout cela ne l’empêche pas d’avoir des moments de faiblesse, nous confie-t-elle. Par exemple, lorsqu’elle emmène des élèves à Manhattan et se rend compte qu’ils n'y sont jamais venus, qu’ils sont incapables de reconnaître le Madison Square Garden (le temple du basket-ball, discipline qu’ils affectionnent particulièrement). Ou tout simplement quand, à chaque rentrée, elle se rend compte que leur niveau est trop bas.
Eh bien, voilà qu’à la suite d’une succession d’événements qui l'ont menée jusqu’à la Maison Blanche, Nadia Lopez se retrouve en possession de plus d’un million de dollars de dons. Tout commence en janvier, quand l’un de ses élèves, Vidal, est photographié par Brandon Stanton, un courtier devenu photographe et surtout un phénomène des réseaux sociaux. Il a créé Humans of New York : une série de portraits de New-Yorkais choisis au hasard, accompagnés de quelques citations de ses sujets parlant d’eux et de la ville.
Ledit Vidal évoque Nadia Lopez, sa principale, une personne qui l’inspire et le motive. Ni une ni deux, Brandon Stanton vient à sa rencontre, la photographie et propose à ses 1,5 million de followers sur Facebook de lever des fonds pour aider Mme Lopez dans un projet qui lui tient à cœur : emmener les élèves visiter la prestigieuse université de Harvard, afin de « leur montrer qu’ils méritent aussi ce genre de succès ».
L’appel aux dons prend en quelques jours des proportions délirantes (ici). Cela attire l’attention de la Maison Blanche, qui organise, non pas une table ronde sur les immenses besoins des écoles publique de Brownsville et des quartiers similaires, mais une rencontre entre Barack Obama, Vidal, Nadia Lopez et Brandon Stanton. Le résultat ? De jolies photos diffusées sur les réseaux sociaux de la Maison Blanche.
En attendant, « une politique urbaine durable et cohérente du niveau local au niveau fédéral reste à définir », tranche le sociologue Robert Sampson, expert des ghettos urbains rattaché à la faculté de Harvard. Et il est loin d’être le seul à estimer que l’heure est grave. En 2013, dans un texte paru dans le New York Times qui garde toute son actualité, le sociologue Patrick Sharkey s’inquiétait de la faiblesse des politiques en la matière, rappelant par exemple que le Bureau de la politique urbaine créé en 2009 par Barack Obama en était toujours à ses balbutiements, pour ne pas dire totalement inutile. « Nous n’avons plus besoin de nouvelles initiatives lancées en fanfare puis abandonnées quelques années plus tard. Les communautés urbaines et leurs institutions ont besoin d’un investissement soutenu de la part des autorités fédérales (…). » Au risque, le cas échéant, d’aller tout droit vers « un nouvel incendie urbain ».
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com