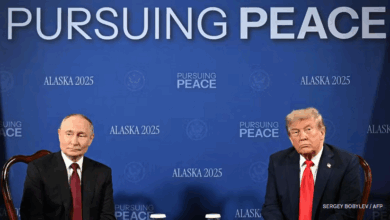Ah ! on les voit déjà s'approchant du malade. Et demandant tout bas, comme chantait si bien Brel dans son Tango funèbre : " Est-ce que la mort s'en vient/Est-ce que la mort s'en va/Est-ce qu'il est encore chaud/Est-ce qu'il est déjà froid ? "A intervalles réguliers, l'Occident s'interroge : la fin serait-elle proche ? Il s'auto-ausculte et, dans un mélange de narcissisme et de masochisme, l'Occident prédit sa déchéance prochaine. C'est très exagéré.
Ah ! on les voit déjà s'approchant du malade. Et demandant tout bas, comme chantait si bien Brel dans son Tango funèbre : " Est-ce que la mort s'en vient/Est-ce que la mort s'en va/Est-ce qu'il est encore chaud/Est-ce qu'il est déjà froid ? "A intervalles réguliers, l'Occident s'interroge : la fin serait-elle proche ? Il s'auto-ausculte et, dans un mélange de narcissisme et de masochisme, l'Occident prédit sa déchéance prochaine. C'est très exagéré.
Le thème du déclin " est aussi américain que l'apple pie – la tarte aux pommes – ", dit l'essayiste Josef Joffe. L'Europe n'est pas en reste, qui cultive aussi le " déclinisme " avec délectation. L'arrivée de puissances nouvelles a relancé le débat. La montée de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de quelques autres a mis fin à la prépondérance absolue de l'Occident – militaire, économique, culturelle. Mais l'émergence de nouveaux " grands " signifie-t-elle, comme dans un jeu à somme nulle, l'effondrement des autres ?
Fresque historique
Le grand mérite de l'historien britannique Niall Ferguson est de reprendre la question sous un autre angle. Dans son dernier livre, Civilisations. L'Occident et le reste du monde (Saint-Simon, 314 p., 21,80 €), Ferguson s'interroge sur les secrets de la réussite occidentale. D'où vient que ce petit bout d'Europe habité de peuplades querelleuses et ravagé par les guerres a fini par donner naissance à cette entité-là : l'Occident, l'" Ouest ", qui allait, un temps, dominer le " Reste ".
Ferguson est un merveilleux conteur. Il a le sens de la fresque historique. Il brasse les faits et embrasse les polémiques. Il n'ignore rien du passé esclavagiste, colonialiste et impérialiste de l'Occident, mais rien non plus de ce qu'il a construit et qui le définit aussi – de la révolution scientifique à l'Etat de droit, en passant par la démocratie représentative. La repentance ne doit pas empêcher la gratitude. Ferguson cède à la démagogie techno-jeune de l'époque et parle de " six applis fatales " (killer apps) pour désigner six des principaux moteurs du succès occidental : la concurrence qui nourrit l'innovation ; la science, associée à la puissance militaire ; le droit de propriété individuelle ; la médecine ; la société de consommation, carburant de l'industrialisation ; l'éthique du travail.
Quelques-unes de ces " applis " assurent aujourd'hui la réussite de certains membres du Reste (du monde). Tant mieux pour eux, dit Ferguson. Il s'en féliciterait plus encore si l'Occident n'était pas aujourd'hui, selon lui, victime d'une crise de confiance qui le mine de l'intérieur. Brève dépression ou pathologie plus lourde ? L'Ecossais s'interroge sur la capacité de l'Occident à maintenir ses performances. Il est pessimiste. Trop.
Sur le sujet, l'un des essais les plus pertinents a été publié par Régis Debray dans la revue Medium (n° 34, janvier-mars 2013, voir aussi Le Monde du 18 juillet). Il le reprend dans un livre d'entretiens croisés avec Renaud Girard, notre confrère du Figaro – Que reste-t-il de l'Occident ? (Grasset, 139 p., 11 €). Debray donne une " géographie concrète à ce concept géopolitique ", l'Occident.
Elle commence, bien sûr, avec le groupe euratlantique (les Etats-Unis, le Canada et l'Europe) et se poursuit dans la zone Pacifique, avec le Japon, Taïwan, la Corée du sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est un ensemble militaire en expansion, pas sur le déclin. C'est même " le seul bloc politico-militaire existant ", écrit Debray : ni la Chine ni la Russie, dont les budgets de défense sont à la hausse, n'ont l'équivalent du système d'alliances occidentales – une machine " capable d'actions de force rapides et coordonnées " d'un point à l'autre du globe.
Elle partage le même corps de doctrine politique – démocratie et économie de marché – et aucun de ses membres ne conteste le leadership des Etats-Unis. A côté, les fameux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du sud) avancent en ordre dispersé : ils forment un bloc multipolaire, sans cohérence stratégique ni idéologique.
Le politologue américain Robert Dujarric dresse le même constat dans la revue The Diplomat (juin 2014). Avec l'extension de l'OTAN aux pays de l'ex-pacte de Varsovie, avec le rapprochement militaire entre l'Inde et les Etats-Unis, par exemple, l'Occident, sur ce plan-là, s'est plus musclé qu'il n'a régressé ces vingt dernières années.
Aptitude inégalée à l'innovation
De toute la littérature économique consacrée à la comparaison entre l'Ouest et le Reste – un monstre –, retenons les chiffres cités par Dujarric : en 1988, l'Occident représente 80 % du produit mondial brut ; aujourd'hui, 61 %. La part des Etats-Unis (18 %) a baissé, celle de l'Europe encore plus, principalement du fait de l'explosion de la croissance chinoise. Mais là encore, l'affaire n'est pas un jeu à somme nulle. Le PIB par habitant des Etats-Unis et des pays européens n'a cessé de grimper au fil de l'accroissement de la richesse mondiale. Debray et Dujarric se rejoignent encore sur la force renouvelée du soft power de l'Occident – de la domination de ses universités à une aptitude inégalée à l'innovation.
Mais Debray pointe aussi, à raison, les faiblesses du modèle : tendance à l'hubris, surtout depuis la chute de l'URSS , méconnaissance de l'Autre, complexe de supériorité, errances d'un capitalisme financier incontrôlé, enfin infidélité à ses propres principes démocratiques. Il n'est pas sûr que l'Occident séduise autant qu'il a pu le faire durant un siècle ou un siècle et demi. Il a perdu de sa prépondérance. Il est concurrencé. Mais décline-t-il pour autant ?
Alain Frachon
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com