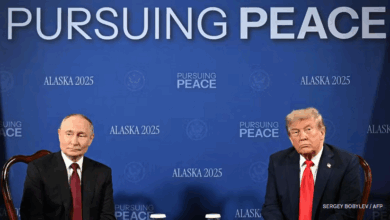Au beau milieu de la guerre froide, un président américain, cynique, menteur et porté sur l'alcool, décide de changer les règles du jeu. Pour affaiblir l'URSS, Richard Nixon fait alliance avec un autre ennemi de l'Amérique, la Chine de Mao. Il se trouve que le Grand Timonier est alors au plus mal avec les camarades du Kremlin. Rien de tel qu'un ennemi commun pour conclure un mariage de raison.
Au beau milieu de la guerre froide, un président américain, cynique, menteur et porté sur l'alcool, décide de changer les règles du jeu. Pour affaiblir l'URSS, Richard Nixon fait alliance avec un autre ennemi de l'Amérique, la Chine de Mao. Il se trouve que le Grand Timonier est alors au plus mal avec les camarades du Kremlin. Rien de tel qu'un ennemi commun pour conclure un mariage de raison.
Gagnant-gagnant : l'URSS fut affaiblie, ce que souhaitait Nixon ; la normalisation Washington-Pékin permit le décollage économique de la Chine, ce que voulaient les successeurs de Mao. On était au début des années 1970.
Aujourd'hui, au Proche-Orient, l'Amérique pourrait de nouveau être tentée de bouleverser la donne. Conjonction d'intérêts inattendue, elle partage avec l'Iran chiite, sa bête noire de plus de trente ans, le même ennemi : le djihadisme sunnite et, particulièrement, son avatar le plus abouti et le plus dangereux, le groupe appelé l'Etat islamique en Irak et au Levant – l'EIIL qui contrôle une partie de l'Irak et un bout de la Syrie.
La lutte contre ce " Djihadistan " pousse la République islamique et le Grand Satan américain l'un vers l'autre. L'Iran est le protecteur du gouvernement de Bagdad et des lieux saints chiites qu'abrite l'Irak, deux cibles de l'EIIL qui considère la branche minoritaire de l'islam comme une sorte de perversion panthéiste. Les Etats-Unis jugent que l'enracinement d'un califat islamiste au cœur du Proche-Orient est une menace pour leur sécurité. Danger commun, cible commune.
Parce que l'EIIL est présent de part et d'autre de la frontière syro-irakienne, les deux guerres civiles en cours, celle de Syrie et celle d'Irak, ne font plus qu'un conflit – le " Syrak ", dit un confrère britannique. Affaiblir l'EIIL d'un côté, c'est l'affaiblir de l'autre. En Syrie, les Etats-Unis souhaitent que le régime de Bachar Al-Assad finisse par tomber. Ils ont besoin de l'Iran qui assure la garde prétorienne et les finances de Damas. Sans Téhéran, pas de solution en vue, du moins à court terme, sur le front syrien.
A Vienne, Américains, Chinois, Européens et Russes négocient avec l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran. Les premiers veulent le dépouiller de tous ses aspects militaires, directs ou indirects. En contrepartie, les Iraniens veulent la levée des sanctions qui étouffent leur économie. Beaucoup dépend des Etats-Unis.
Quelle que soit la manière dont on secoue le cocktail proche-oriental, on aboutit à cette conclusion : le président américain, Barack Obama, et le Guide iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ont besoin l'un de l'autre. Les Etats-Unis ne peuvent demeurer la superpuissance qui compte au Proche-Orient sans entretenir de relations avec un pays qui en reste la dernière vraie puissance régionale. Quelle est l'alternative ? La poursuite du cauchemar en cours ? Pas si simple.
" Nos alliés naturels "
La seule évocation d'un rapprochement Washington-Téhéran donne des boutons aux alliés des Etats-Unis au Proche-Orient. L'Arabie saoudite hurle à la trahison, Israël crie à l'irresponsabilité. La première est la chef de file du monde arabe sunnite, la branche majoritaire de l'islam. Elle est en conflit avec la Ré- publique islamique, que les Arabes soupçonnent de vouloir dominer la région. Israël classe l'Iran parmi ses ennemis les plus farouches : Téhéran voudrait se doter de l'arme nucléaire et nourrit une hostilité radicale à l'adresse d'Israël.
Depuis que des dizaines d'Américains ont été retenus 444 jours en otage à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, de novembre 1979 à janvier 1981, Washington n'a plus de relations avec l'Iran. Entre les deux pays se sont succédé des phases d'hostilité ouverte et de collaboration ponctuelle – contre les talibans afghans, par exemple. Le capital de méfiance accumulé de part et d'autre est énorme.
Il n'empêche, l'heure du rapprochement a sonné, dit Leslie Gelb, le grand sage de la politique étrangère américaine. Ancien du département d'Etat et du Pentagone, président du Council on Foreign Relations, Gelb observe sobrement : en Syrie, il faudra parler avec les Iraniens un jour ou l'autre ; " en Irak, ils sont nos alliés naturels " pour lutter contre l'EIIL et faire évoluer le gouvernement de Bagdad.
Sur l'Irak, Obama a prudemment esquissé la possibilité d'une collaboration avec Téhéran. Aussitôt, le parti anti-iranien à Washington s'est mobilisé. Cette coalition hétéroclite, où se côtoient les groupes de pression pro-israéliens et pro-saoudiens, les néoconservateurs républicains mais aussi des démocrates, n'a qu'une politique : diaboliser la République islamique.
Tout ce que le lobby anti-iranien dit du régime de Téhéran est vrai : théocratie à tendances dictatoriales, n'hésitant pas à recourir au terrorisme, méprisant les droits de l'homme et vouant Israël aux gémonies. Mais la fiche signalétique du grand allié saoudien a encore plus de saveur : théocratie impitoyablement dictatoriale, piétinant les droits de l'homme et essaimant une version de l'islam volontiers antisémite. Celle-ci nourrit le terrorisme djihadiste qui a fait beaucoup plus de morts que celui qu'a pu parrainer Téhéran.
Des deux sociétés, l'iranienne et la saoudienne, la première est la plus proche de l'Occident. Des deux régimes, c'est la République islamique à têtes multiples, pas la monarchie saoudienne, qui est le plus susceptible d'évolution. Washington ne pourra l'ignorer trés longtemps encore.
Alain Frachon
Source : Le Monde
(Photo : Reuters)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com