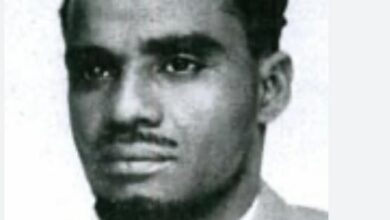Ce contre quoi les (vrais) démocrates, les intellectuels (ceux pour qui la politique n’est pas, nécessairement, celle du ventre) et les militants des droits de l’Homme se sont toujours battus est arrivé :
Ce contre quoi les (vrais) démocrates, les intellectuels (ceux pour qui la politique n’est pas, nécessairement, celle du ventre) et les militants des droits de l’Homme se sont toujours battus est arrivé :
notre pays est, désormais, cité en exemple, presque parfait, de transition ratée et d’intervention militaire dans le jeu politique. Un ministre tunisien démissionnaire n’a pas cessé de répéter, sur tous les tons et dans tous les organes de presse, que la plus grande crainte de la classe politique est que leur pays ne prenne le chemin de la Mauritanie. La nôtre, de classe politique, ainsi que nous, simples citoyens, devrions avoir honte de s’être laisser berner par des militaires et qu’on nous le rappelle de si loin, d’un pays qui ne sait, même pas, ce que démocratie veut dire. Pour une fois, notre armée a servi à quelque chose : elle nous a fait une mauvaise publicité. Nos vaillantes forces armées, incapables de remplir les missions pour lesquelles leurs éléments ont été enrôlés, ont, désormais, un violon d’Ingres: mener le pays à la dérive, en voulant tout régenter, après en avoir fait un contre-exemple. Les hommes en armes ont, en effet, la fâcheuse habitude de s’incruster au pouvoir et de ne le lâcher que contraints et forcés. La Tunisie et l’Egypte l’ont démontré, avant que la Libye et le Yémen ne prennent le train en marche. Le pouvoir militaire est incompatible avec la démocratie et seule la volonté populaire est capable de le déraciner, en un tour de main. Fort de ses démembrements, de ses tentacules, de son armée bien armée, de l’argent qu’il a réussi à amasser, en pillant le pays, de ses soutiens extérieurs et intérieurs, il se révèle, pourtant, plus faible que jamais, devant les coups de boutoir d’une rue armée de sa seule volonté de briser les chaînes.
Où s’arrêtera le tsunami tunisien? Pourquoi n’a-t-il emporté, jusqu’à présent, que des régimes dirigés par des militaires? Les monarchies seraient-elles mieux insérées dans le tissu social, plus auréolées de cet instinct de conservation populaire qui accorde, spontanément, plus de légitimité au plus traditionnel? Sinon, policièrement plus efficaces? Les deux pouvoirs qui résistent, jusqu’à présent, malgré la violence de la contestation, n’ont obtenu de sursis que grâce à l’appui de certaines tribus (Yémen) ou de miliciens (Libye). En Mauritanie, où nous avons les deux, cela nous prémunira-t-il? De moins en moins nombreux, pourtant, ceux qui croient que notre vieux système tribal puisse dompter les multiples contradictions, économiques, sociales et écologiques, générées par notre absorption dans la modernité. Et les plaies, pas vraiment refermées, des années de braise où l’instrumentalisation, négative, de notre diversité aura, surtout, fragilisé notre construction nationale, ne nous incitent guère à parier une seule ouguiya sur le moindre affrontement armé. La flamme de la contestation doit, pourtant, s’allumer et se propager. Est-ce au vent nouveau de la génération Facebook qu’on devra cet indispensable mouvement? La Mauritanie dégénère, croupissant dans des attitudes, surannées, de gazra, s’auto-pillant, elle-même, sous l’égide de dirigeants d’une autre époque. Il faut y mettre un terme définitif. Générations montantes, régénérons, sans violence mais avec hardiesse, notre Nation!
Ahmed Ould Cheikh
Source : Le Calame le 08/03/2011