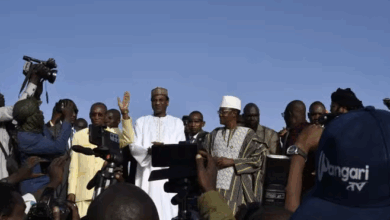L’enlèvement au Niger de sept employés d’Areva et Vinci (cinq Français dont une femme, un Togolais et un Malgache), quels qu’en soient les développements à venir (et ils peuvent bien sûr être dramatiques), constitue un défi lancé au gouvernement français ainsi qu’à l’ensemble des pays des confins sahariens, qui jouent chacun leur jeu dans une partie de billard à plusieurs bandes.
L’enlèvement au Niger de sept employés d’Areva et Vinci (cinq Français dont une femme, un Togolais et un Malgache), quels qu’en soient les développements à venir (et ils peuvent bien sûr être dramatiques), constitue un défi lancé au gouvernement français ainsi qu’à l’ensemble des pays des confins sahariens, qui jouent chacun leur jeu dans une partie de billard à plusieurs bandes.
L’Elysée, qui multiplie les préparatifs à une intervention de type militaire, semi-clandestine, très technique, et finalement lourde – avec les conséquences géopolitiques qui peuvent l’accompagner –, engage la France dans ce qui pourrait être un nouveau bourbier, sur fond d’uranium, de terrorisme, de déstabilisation d’Etats sahéliens, et d’interventionnisme de l’ancienne métropole coloniale. Cela correspondrait bien peu au nouveau cours que le président Sarkozy prétend donner aux relations franco-africaines…
La cible française. Une note des services de renseignement, dont la teneur a été publiée par Le Monde le 21 septembre, resence les raisons d’une « focalisation antifrançaise » dans la région du Sahel, due à une conjonction d’éléments, notamment :
– l’expédition franco-mauritanienne contre un camp d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) le 22 juillet dernier ;
– la présence militaire française qui se poursuit en Afghanistan ;
– le vote récent de la loi interdisant le port du voile intégral dans les lieux publics ;
– une diplomatie jugée pro-israélienne.
Les autorités à Paris ne cessent d’évoquer un niveau élevé de menace sur le territoire et sur les intérêts français, au risque de développer un climat de peur dans l’opinion (et de susciter des interrogations quant à des arrière-pensées politiciennes). Bien qu’on ne puisse reprocher au gouvernement de tenter de faire libérer les otages d’Arlit, il est évident qu’un coup de pied militaire dans la fourmilière comme il s’en prépare un, risque de rendre ce risque encore plus réel.
Le profil retenu pour l’opération semble celui d’une intervention coup de poing, brutale, rapide, relativement « invisible » : d’où le choix du Commandement français des opérations spéciales (COS) qui a, parmi ses spécialités, la détection, le renseignement, l’action en profondeur, l’élimination ciblée, l’extraction, etc. – le tout en milieu extrême et hostile, et sous une forme quasi-clandestine. Dans la pratique, les actions du COS sont le plus souvent connues après coup, ou jamais. Le ministre français de l’intérieur Brice Hortefeux, qui représente son gouvernement à la célébration ce mercredi du 50e anniversaire de l’indépendance du Mali, en répondu à une question sur ces préparatifs, a nié toute intervention, mais ajouté : « A ce stade, s’il y avait un projet d’opération militaire, je ne vous dirais rien. »
Il y a au moins deux conditions, souligne un ancien attaché militaire français au Niger, l’ex-colonel Gilles Denamur [1], à la réussite d’une opération de ce type :
– disposer de renseignements sûrs à 100 % (ce qui est d’autant pkus difficile que les otages ont sans doute été séparés) ;
– s’assurer du soutien des gouvernements de la région (ce qui n’est pas gagné, eux-mêmes n’ayant jamais réussi à développer une coopération efficace à leurs frontières, en matière de sécurité, et étant peu désireux de mobiliser troupes et crédits dans ces espaces désertiques et rebelles).
AQMI a mis en garde les autorités françaises mardi soir contre « toute autre stupidité » (par « autre », entendez : après l’attaque du 22 juillet). Dans l’immédiat, les éléments français déployés au Niger, en Mauritanie, ainsi semble-t-il qu’au Burkina, se contentent de tenter de localiser les preneurs d’otages, grâce aux :
– interceptions de signaux électroniques (les émissions des balises, GPS, téléphones satellite, radars, scan) à l’aide d’aéronefs, de stations d’écoute, etc. ;
– images recueillies par les avions d’observation (les Atlantic et Mirage basés pour l’occasion à Niamey), et par les satellites (des demandes auraient été faites aux Américains) ;
– renseignements humains (envoi de commandos, interrogatoires de villageois ou voyageurs, etc.).
Face voilée
Attention aux opérations glissantes ! Elles sont une spécialité française : on commence par de l’humanitaire, de l’échange d’informations, de la coopération douçe, du sauvetage de ressortissants… Et on se retrouve, quelques jours ou semaines plus tard, avec une intervention en bonne et due forme, doublée d’une face voilée, et de tout un tas de conséquences à gérer, pas toutes très positives. Le tout sans avoir raconté grand-chose à l’opinion, sinon d’aimables mensonges, au minimum par omission…
Une intervention pour libérer les otages détenus dans les sanctuaires d’AQMI serait périlleuse, et de toute façon hors de portée des armées locales, dans une région décrite ainsi par l’explorateur français Régis Belleville, qui sillonne le secteur depuis plus de dix ans : « Si ce n’est pas l’Afghanistan, ce sont des régions isolées, montagneuses, escarpées, où les clans locaux, depuis toujours rétifs à toute autorité, assistent les hommes d’Al-Qaida, par intérêt ou à cause de relations familiales.
« Ces régions, et notamment le massif de Timerine, à 450 km au nord-est de Tombouctou, sont des escarpements rocheux, des blocs de rochers délités, très découpés, traversés d’Est en Ouest par une grande bande sableuse qui sert de lieu de passage à tous les trafics. Il y a des puits ancestraux, des micro-climats locaux pour les troupeaux, comme de petits jardins préservés pour les tribus berabiches, avec lesquelles les gars d’AQMI ont noué des liens familiaux. Là, ils sont tranquilles. Si quoi que ce soit bouge, ils sont prévenus [2]. »
Il y a risque – en cas de « dommages collatéraux » au cours d’une attaque – de transformer autant de civils en nouveaux combattants AQMI. Il est de toute façon difficile, comme en Afghanistan, de distinguer les rebelles de la population, et de détecter d’éventuels suspects (surtout s’ils s’abritent sous des filets, ou utilisent des dromadaires plutôt que les 4×4, etc),
« Porte de l’enfer »
Le cycle de la vengeance. La prise d’otages a été revendiquée par le groupe d’Abdelhamid Abou Zeid, une des « katibas » (phalanges armées) d’AQMI, qui est considérée comme responsable de l’assassinat en 2009 de l’otage britannique Edwin Dyer, et de la mort de l’otage français Michel Germaneau en juillet dernier. La prise d’otages actuelle semble une action de représailles après l’attaque, le 22 juillet, par des soldats des forces spéciales mauritaniennes formés et soutenus sur le terrain par des éléments du COS, d’un camp d’AQMI en territoire malien. Abdelmalek Droukel, un des hommes forts d’AQMI, avait alors affirmé que « Sarkozy [avait] ouvert une porte de l’enfer à son peuple » ; il aurait alors ordonné d’exécuter le vieil otage.
La stratégie d’AQMI. Défaite en Afghanistan et en Irak, pourchassée jusqu’à un certain point au Pakistan, en Arabie saoudite et jusqu’en Tchétchénie, la mouvance Al-Qaida a refait surface au Yémen (où elle est combattue par le gouvernement local, avec le soutien technique de l’armée américaine), en Somalie (où elle joue sur l’anarchie et les divisions régnant dans ce pays, mais reste sous la menace des soldats américains déployés à Djibouti), et surtout dans le Sahel ouest-africain : l’allégeance de l’ex-Groupe pour la prédication et le combat (GSPC [3]), avec sa demi-douzaine de « katibas » autonomes, son encadrement en majorité algérien, et ses quelque quatre cents combattants d’origine mauritanienne ou touarègue (du Mali ou du Niger), font de cette zone des confins sahariens, au moins aussi étendue que le territoire français, et très peu habitée et administrée, un refuge commode pour les rebelles.
Des « moudjahidins » d’AQMI semblent avoir, ces dernières années, noué des liens étroits avec les tribus nomades, en majorité touarègues, grâce aux échanges commerciaux, à des complicités dans les trafics illégaux (cigarettes, drogues, armes), voire à la polygamie – qui permettrait à certains de ces combattants ultra-mobiles de se sentir presque partout « chez eux ». Après la destruction d’un de ses camps et la perte de sept de ses combattants, le 22 juillet, AQMI éprouvait la nécessité de montrer sa force, pour décourager toute nouvelle intrusion dans ce qu’elle considère à la fois comme son terrain de chasse et son « émirat ».
Zones grises
Le Mali dans l’œil du cyclone… entre Mauritanie et Niger. Le pays dirigé par le président Amani Toumani Touré, ex-général, est tout occupé à la célébration, ce mercredi, du 50e anniversaire de son accession à l’indépendance. Le nord du pays, où se seraient réfugiés les preneurs d’otages, est une « zone grise », où l’administration et l’armée malienne sont peu présentes, ou pas du tout.
Le pouvoir malien ne souhaite pas s’engager dans une escalade militaire avec AQMI. Il a d’ailleurs souvent été sollicité par les gouvernements étrangers soucieux d’épargner leurs ressortissants pris en otages. Il aurait refusé ces derniers jours l’utilisation par l’armée française de l’aéroport de Kidal, au nord du pays, contraignant Paris à organiser un dispositif à partir de bases plus lointaines, au Niger, en Mauritanie et au Burkina. Des instructeurs du COS français ont déjà contribué à former plus de deux cents de ses soldats d’élite [4].
L’affaire commence à susciter des critiques au sein de la classe politique malienne : « On a laissé AQMI s’installer, et aujourd’hui notre pays est le théâtre d’une guerre entre forces étrangères », constate sous couvert d’anonymat un ancien ministre « scandalisé » – dans un reportage à Bamako de Philippe Bernard [5]. Le journaliste cite également Aminata Traoré : « Nous sommes en guerre, mais nous ne le savons pas ! », assure cette figure malienne de l’altermondialisme qui considère la « guerre contre le terrorisme » comme une injonction faite par les Occidentaux aux pays pauvres, au même titre que la privatisation des entreprises. « Nous prétendons être maîtres de notre destin, mais la Mauritanie poursuit AQMI sur notre territoire. »
Le Burkina Faso, plaque tournante. Ce pays toujours géré par l’ex-militaire Blaise Compaoré, le successeur (l’assassin ?) de Thomas Sankara, est un spécialiste des médiations régionales (Côte d’Ivoire, Guinée [6]), mais aussi des trafics d’armes ou de diamants (Liberia, Sierra Leone). Le mauritanien Moustapha Chafi, « émissaire du président burkinabé dans toutes les échauffourées africaines depuis quinze ans » [7], a été l’artisan par exemple de la libération de deux otages espagnols en août dernier . C’est également au Burkina, un des derniers « bons alliés » (traduisez : sans problèmes) de la France en Afrique francophone, qu’une base arrière du COS aurait été discrètement établie ces derniers jours, selon certaines sources, en vue d’une éventuelle intervention.
Conseil de crise
C’est à l’EPEE, une société de conseil, pas très éloignée du monde des « sociétés militaires privées » (bien qu’elle paraisse s’en défendre), qu’Areva, échaudée par une première attaque de rebelles touaregs dès 2007, avait confié la sécurité rapprochée de ses personnels au nord du Niger. EPEE est dirigée par le colonel Jacques Hogard, issu d’une famille de militaires, ancien cadre du 2e régiment étranger parachutiste (2e REP), et impliqué dans une polémique à propos du rôle de ses hommes lors de l’opération Turquoise, au Rwanda, en juillet 1994.
EPEE avait déployé à Arlit six anciens du 2e REP, encadrés par un ancien officier méhariste, pour faire la liaison avec les militaires nigériens, chargés de la sécurité armée du site minier d’Areva. Elle affirme avoir manifesté ses inquiétudes ces derniers mois à propos de l’insuffisance du dispositif de sécurité au nord-Niger, mais n’avait pu obtenir la couverture militaire française « officielle » et permanente qui – selon l’EPEE – aurait pu prévenir des attaques.
Sur son site, EPEE se présente comme une spécialiste de l’organisation et l’animation d’exercices de crise, qui « conseille et assiste ses clients dans :
– la définition des objectifs et la rédaction des scénarios (technique, politique, social, médiatique…)
– la conduite et l’animation de l’exercice incluant la pression médiatique,
– la rédaction des rapports de retour d’expérience
– la définition et mise en place des outils de prévention (sites, blogs…)
– l’appui opérationnel à la gestion de la crise
– le choix des supports de diffusion, choix des cibles
– la sensibilisation et la formation des dirigeants et des communicants. »
Mais la société affirme « ne pas être assimilable aux différents acteurs existants », et « ne pas être :
– une société d’investigation
– une société de veille
– une officine conduisant des opérations “opaques”
– une “courroie de transmission” de quiconque.
Elle n’accepte pas :
– des missions pour le compte d’un Etat étranger
– des “opérations spéciales” nécessitant l’emploi de procédés illégaux
– des “missions impossibles” où ses chances de succès sont a priori inexistantes. »
Philippe Leymarie
Notes
[1] Cité par l’AFP, 21 septembre 2010. [2] AFP, 21 septembre 2010. [3] Lire Mathieu Guidère, « Une filiale algérienne pour Al-Qaida », Le Monde diplomatique, novembre 2006. [4] La coopération militaire américaine avec le Mali est également une des plus avancées du continent. [5] Envoyé spécial du Monde, 21 septembre 2010. [6] Lire Bruno Jaffré, « Le Burkina Faso, pilier de la “Françafrique” », Le Monde diplomatique, janvier 2010. [7] Voir sa biographie dans Jeune Afrique, 12 septembre 2010.Source : blog.mondediplo.net le 23/09/2010