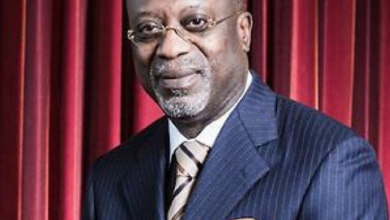Va-t-on encore déballer un autre «scandale » financier en remontant le montage de la prise d’actions à Mauritel, la veille de sa privatisation en 2001. Une enquête serait en cours pour «révéler» des pratiques «anormales » sur la prise d’action d’un privé mauritanien à travers la Banque centrale de Mauritanie (encore elle!). Cette dernière se serait subrogée à un opérateur mauritanien pour verser sa participation à l’opération, sans jamais se faire rembourser.
Va-t-on encore déballer un autre «scandale » financier en remontant le montage de la prise d’actions à Mauritel, la veille de sa privatisation en 2001. Une enquête serait en cours pour «révéler» des pratiques «anormales » sur la prise d’action d’un privé mauritanien à travers la Banque centrale de Mauritanie (encore elle!). Cette dernière se serait subrogée à un opérateur mauritanien pour verser sa participation à l’opération, sans jamais se faire rembourser.
Il semble que la Banque centrale de Mauritanie ait servi de tire-lire, sous le président Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya (à son insu?), à des hommes d’affaires dont certains auraient, parfois, usé du trafic d’influence pour se rendre coupable de concussion ouverte par la subvention de leurs propres affaires privées. L’Etat diligenterait aujourd’hui une nouvelle enquête sur le paiement par la Banque centrale de Mauritanie (BCM) d’actions au profit d’un promoteur privé à l’occasion de la privatisation, en 2001, de Mauritel.
Remonter le temps
En Juin 2000, la Société Mauritano-Tunisienne de télécommunication MATTEL, attributaire de la première licence de téléphonie cellulaire de norme GSM en Mauritanie, inaugurait par le paiement d’un chèque de 6.731.706.000 UM libellé au nom du trésorier général de la RIM, le secteur de la téléphonie cellulaire dans notre pays. Un nouveau secteur d’activités économiques rentable dont l’Etat a assuré la mise en place par une avalanche de réformes entamées dès 1999 et portant sur le changement de statut de l’OPT et la révision de loi régissant le secteur des télécommunications naissant. C’est dans ce cadre que la séparation de l’Office des Postes et Télécommunications en deux entités autonomes, Mauritel et Mauripost, sera consacrée. Après donc la première licence Gsm accordée à Mattel, la Mauritel née des décombres de la scission de l’OPT héritait de ses équipements et du marché de téléphonie fixe contre 48 millions Usd, représentant 54% d’actions de Maroc Télécom. Mais c’est surtout l’attribution en sa faveur d’une seconde licence de type Gsm qui suscitera des interrogations après que l’Etat ait convenu de «lui accorder une avance d’actionnaires couvrant la totalité du prix de la deuxième licence de téléphonie cellulaire de norme GSM qui lui est réservée dans le cadre du processus de reforme du secteur des télécommunications engagé». L’Autorité de régulation, à l’époque, s’empressera de réagir aux tumultes qui suivront l’attribution de la seconde licence relativement aux conditions d’attribution et au règlement du prix de la deuxième licence. Or, il semble que l’actuelle enquête porte justement sur les conditions de règlement au profit de Maroc-Télécom (Vivendi) de la participation du privé mauritanien dans la transaction qui a permis cette opération de privatisation.
L’enquête diligentée aujourd’hui porterait donc sur le versement par la BCM de la participation de l’opérateur mauritanien. On indique que l’Etat aurait découvert que les fonds de garantie versés n’auraient jamais été reversés à la Banque centrale. Il semble même que l’affaire concerne l’enquête opérée par la Police de la brigade chargée des crimes économiques au sujet des « transferts illicites » de la Banque centrale de Mauritanie (Bcm) entre 2001 et 2002 et dans laquelle trois hommes d’affaires avaient été mis en examen en 2010 avant d’être relaxés.
Des tractations seraient en cours pour convaincre l’opérateur en question, soit de restituer l’argent versé, il y a dix ans, en plus des dividendes d’exploitation, soit son expropriation alors que la licence d’établissement et d’exploitation du réseau ouvert au public, selon les termes du cahier des charges, est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur (2001). Elle toucherait donc à sa fin, prévue normalement en 2011.
S’achemine-t-on alors vers un autre bras de fer entre l’Etat et le promoteur en question ? A moins que des conciliabules ne soient trouvés rapidement pour un règlement à l’amiable.
La CMC vue par Maroc-Télécom
Mauritel SA est l’opérateur historique mauritanien, né de la scission en 1999 de l’Office des Postes et Télécommunications. En 2000, Mauritel SA crée Mauritel Mobiles, détenue à 100%, qui obtient la seconde licence d’exploitation d’un réseau de téléphonie Mobile de type GSM.
Le 12 avril 2001, suite à un appel d’offres international lancé par le Gouvernement mauritanien, Maroc Telecomacquiert 54% du capital de Mauritel SA. En janvier 2002, le groupe Maroc Telecom a créé la Compagnie Mauritanienne de Communication (CMC), à laquelle elle a apporté les titres qu’elle détient dans Mauritel SA. Puis, Maroc Telecom a cédé le 6 juin 2002, 20% de CMC à des investisseurs mauritaniens. Au cours de l’exercice 2003, CMC a cédé 3% de Mauritel SA au personnel de cette dernière pour 17 millions de dirhams conformément aux engagements souscrits lors de la privatisation en 2001. A partir du 1er juillet 2004, la fin des droits de veto de l’Etat Mauritanien dans la société, Mauritel SA confère à Maroc Telecom le contrôle exclusif sur cette filiale conduisant à sa consolidation par intégration globale. En 2006, le groupe CMC a acheté de la Socipam, société civile constituée par le personnel des filiales mauritaniennes, la fraction du capital de Mauritel SA, soit 0,527%.
Suite à cette opération, la CMC détient 51,527% du capital de Mauritel SA. Suite à l’abrogation en septembre 2007 (loi 2007-049 du 3 septembre 2007) de l’article 73 de la loi 99-019 sur les télécommunications, qui obligeait nominativement Mauritel SA à filialiser toutes ses activités soumises à la concurrence, en l’occurrence son activité Mobile, les Assemblées Générales Extraordinaires de Mauritel SA et Mauritel Mobiles du 27 novembre 2007 ont approuvé le projet de fusion des deux sociétés. Depuis cette date, Mauritel SA est devenue un opérateur global bénéficiant ainsi de la mutualisation entre l’ensemble de ses activités Fixe, Mobile et Internet.
Source Maroc-Télécom Via Le Quotidien de Nouakchott