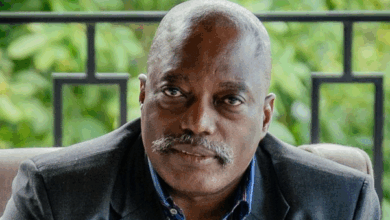Dans les pays en voie de développement l’exode rural participe autant, sinon plus, que la natalité à l’augmentation de la population des grandes capitales.
Dans les pays en voie de développement l’exode rural participe autant, sinon plus, que la natalité à l’augmentation de la population des grandes capitales.
En terme de développement urbain c’est un véritable défi, on a beau construire des écoles, des centres de santé, des routes… ça ne suffit jamais.
Une ville comme Bamako a vu sa population pratiquement doubler en 10 ans, soit grosso modo 90.000 habitants de plus tous les ans. Le déficit en eau de la capitale est important, de l’ordre de 30.000 m3 par jour (chiffre probablement près de la vérité mais qui n’engage que moi). S’il faut, en plus de combler ce déficit, prendre en compte les nouveaux arrivants on a un peu l’impression que l’on ne va jamais y arriver.
Programmer des points d’eau potable, ou n’importe quel type d’infrastructure sociale ou sanitaire (école, électricité, assainissement…) est donc un véritable casse-tête pour les directions techniques au Mali. Il faut le dire, d’énormes efforts sont fait depuis quelques années pour rattraper le retard, ne serait-ce que donner un minimum d’eau potable aux populations. Aujourd’hui on estime qu’au Mali le taux de couverture en points d’eau potable est proche de 71%. C’est pas mal, pas trop loin des Objectifs du Millénaire (OMD), mais encore insuffisant pour les 25% ou 30% de la population qui sont dans la m…. et qui boivent l’eau du marigot.
Principal problème donc à résoudre, combler effectivement le déficit en point d’eau potable, tenant compte du taux de natalité et du déplacement des populations vers les centres urbains. Je vois déjà les commentaires classiques du genre « faites moins de gosses et tout ira mieux ». J’espère simplement que vous me foutrez la paix avec ça aujourd’hui. Mais le problème est là. Pendant quelques années la majorité des investissements servaient tout juste à maintenir le cap, à couvrir les besoins créés par l’augmentation naturelle de la population. Aujourd’hui il faut aller de l’avant sinon on risque l’explosion sociale dans les capitales.
Toutes les capitales africaines ont ce même genre de problème, avec des solutions différentes suivant le contexte géographique. Nouakchott en Mauritanie par exemple avec 800.000 habitants a longtemps dû aller chercher son eau potable à Idini (45km) à l’aide d’une série de forages captant l’eau souterraine et l’acheminant par écoulement gravitaire via une conduite vers la capitale. La nappe de plus en plus tend à devenir salée, et les mauritaniens se tournent vers l’eau du fleuve Sénégal distant de plus de 200km au sud! Montant de l’opération si j’ai bien calculé, plus de 230 milliards de FCFA (ou 360 millions d’euros). Pour Ouagadougou (Burkina Faso), avec une population de 1,2 millions d’habitants, pas de forages à gros débits (on est sur du socle cristallin, donc peu d’eau), ni de fleuve non plus. La solution: le barrage de Ziga à 50km (rien que pour le barrage, 150 milliards de FCFA soit 230 millions d’euros).
La ville de Bamako semble privilégiée puisque le fleuve Niger la traverse avec un débit rarement en dessous de 70m3/secondes. Mais il faut traiter cette eau. Au total donc pour Bamako un projet de l’ordre de 130 milliards de FCFA (200 millions d’euros) pour sécuriser l’alimentation en eau potable pour les 25 prochaines années avec une station de traitement, les conduites et les réservoirs.
Conclusion? Des projets qui dépassent la centaine de milliards de FCFA, voire les deux cents milliards, pour alimenter les populations des capitales et d’énormes problèmes pour convaincre les bailleurs de fonds à subventionner et/ou prêter des fonds. Pour Ouagadougou ça a pris plus de dix ans. Pour Bamako, on y est depuis le début du millénaire… avec un très grand pas en avant normalement pour les prochains mois. C’est vrai que comparé au budget de l’Etat malien le montant est élevé (le budget de l’Etat est de l’ordre de 1000 milliards de FCFA), mais en réfléchissant bien, pour un ensemble de bailleurs de fonds qui regrouperait l’Union Européenne, les bailleurs de fonds traditionnels du secteur (France, Allemagne, Danemark…) les banques islamiques et Africaines (BAD, BOAD, BID, BADEA…) et la banque mondiale, on devrait pouvoir y arriver. La France se place aujourd’hui comme locomotive sur ce dossier avec une volonté forte de travailler sur le développement urbain au Mali, réponse dans quelques mois avec de gros espoirs.
(La population malienne était en 1998 de 9,98 millions d’habitants (dont 1 million à Bamako). Aujourd’hui elle serait de 14,5 millions dont 1,9 millions à Bamako. A ce rythme de croissance naturelle (à ajouter à la migration vers les centres urbains), la population de la capitale devrait augmenter au cours des prochaines années quelque chose comme 5% (100.000 habitants) de plus tous les ans pour arriver à 3,2 millions d’habitants en 2020).
Thierry Helsens ( Hydrogéologue installé au Mali depuis 2002)
Source : Toubabou à Bamako via http://mali.blogs.liberation.fr/ le 18/01/2010