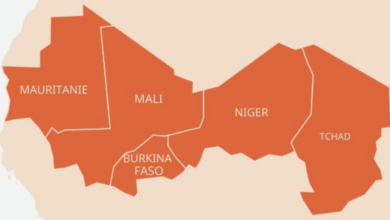Seneplus – La volonté du chef de l’État de mettre en œuvre une véritable politique patrimoniale enthousiasme ceux qui s’inquiètent à juste titre de la détérioration progressive, de la dispersion et de l’insuffisante valorisation du patrimoine archivistique et documentaire sénégalais.
A quelques jours du rapatriement de la bibliothèque de Senghor acquise par l’État en mai dernier se pose aussi la question de la création et du renforcement des institutions de conservation du patrimoine sénégalais ainsi que de leurs missions. L’enjeu n’est pas des moindres, il s’agit de renouveler, repenser et d’enrichir les collections patrimoniales pour constituer une bibliothèque qui reflète la diversité des voix, des langues et des savoirs d’ici. Et de les mettre à disposition des chercheurs mais aussi du public.
Le Sénégal dispose d’anciens et riches fonds d’archives historiques, culturelles, administratives, de manuscrits anciens, journaux, ouvrages imprimés conservés principalement aux Archives nationales, à l’Ifan-Ucad, au Crds (Ex Ifan) de Saint-Louis, dans certaines préfectures, mairies et dans les familles, etc. Ils constituent en outre ensemble un support de l’histoire et de la mémoire historique sénégalaise et ouest-africaine ainsi qu’un moyen de transmission et de pérennisation de celles-ci.
Mais au-delà de ce qui est d’ores et déjà conservé dans les institutions plus haut citées, les chercheurs le savent bien, les archives du Sénégal indépendant, dont le rôle dans la construction d’un État moderne est fondamental, restent encore à constituer. Faute peut être d’espaces et de ressources humaines et matérielles suffisantes, la Direction des archives nationales du Sénégal n’a pas depuis longtemps assurer sa mission première, celle de collecte et de classement d’archives publiques. Encore moins d’archives privées. Pour écrire l’Histoire du Sénégal indépendant, le chercheur doit dès lors se rendre à l’étranger, le plus souvent en France, où sont conservées les archives diplomatiques et consulaires et à la Bibliothèque nationale de France (BNF) à Paris pour les archives de l’Institut National d’Audiovisuel notamment. Cette situation rend les chercheurs, en partie, tributaires du récit élaboré par l’ex-colonisateur dans la production de notre « roman » national.
Le débat posé récemment par la vente des objets d’arts, décorations militaires, cadeaux diplomatiques et de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor traduit avec éloquence cette préoccupation. Les archives du président Senghor ainsi que l’une de ses plus importantes bibliothèques sont pour la plupart d’entre elles restées en France, dans sa maison de Verson en Normandie et, concernant ses archives littéraires, elles ont été léguées par l’académicien lui-même à la BNF en 1979. Ces fonds d’archives mêlent documents officiels liés à ses différentes fonctions politiques et personnels (manuscrits, correspondances, discours, notes, rapports….) qui concernent au premier chef le Sénégal. L’inventaire et la relocalisation de ces fonds doivent dès lors être sérieusement et rapidement envisagés.
Plusieurs initiatives politiques ou scientifiques, portées par des projets et des instituts de recherche à l’étranger et au Sénégal, ont d’ores et déjà procédé à des rapatriements d’archives, au moins de leur copie numérisée et à leur relocalisation au Sénégal. C’est le cas des archives de Thiaroye remises le 1er décembre 2014, par le président français François Hollande au président Sénégalais Macky Sall, qui ne sont pourtant pas, dix ans après, accessibles aux chercheurs. Plus récemment l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a réceptionné un « important trésor de l’histoire » (Dircom de l’UCAD), une « collection d’archives sonores des tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale » issue des Archives du Centre pour la Technologie Culturelle de l’Université de Berlin confiée à l’IFAN.
La Bibliothèque Universitaire vient quant à elle, grâce à l’entremise du groupe international de recherche Senghor (ENS/UCAD), de recevoir les enregistrements des entretiens du président poète Léopold Sédar Senghor » avec l’historienne américaine Janet G. Vaillant, réalisés dans le cadre de ses travaux de recherches sur la Négritude menés dans les années 1970. 17 enregistrements avec des amis (Léon Gontran Damas), des membres de la famille (Hélène) ou encore des responsables politiques (Mamadou Dia) sont déjà consultables.
Du fait de la dispersion, du non-classement et de la non-accessibilité de nombreux fonds d’archives postcoloniales, il en coûte parfois des heures, voire des jours de recherche pour repérer un document et le succès n’est pas toujours garanti. Cet état de fait rend souvent impossible de tirer pleinement parti de la documentation existante et, n’est pas sans incidence sur la recherche en histoire. Il n’en reste pas moins important de sortir d’une vision positiviste de l’histoire qui impose l’archive écrite comme source unique d’écriture de l’histoire, particulièrement dans des espaces où l’oralité prime le plus souvent. Il existe bien sûr un patrimoine immatériel très riche fait de traditions orales, de pratiques culturelles, de chants, de contes, de sons, de jeux…joolas, serer, soninke, wolof, mourides, chrétiens, sénégalais qui n’étant pas systématiquement collectés risquent de se perdre, en partie.
La création par le président Senghor en 1968 des archives culturelles avait permis en son temps la collecte d’une partie de ce riche patrimoine immatériel qui a vocation à renaître. Le « Dyâli», qui parle en « Nous » aux historiens disait qu’il « faut que nous refassions, nous repensions l’histoire africaine en négro-africaine, (…) dans une confrontation constante avec les historiens européens » (Fonds vaillant, enregistrement n°14, BU-UCAD). Senghor avait pensé à mettre à la disposition des chercheurs de la matière, tout comme il le faisait avec ses poèmes. Dans cette perspective, les chercheurs en histoire africaine, disons en sciences humaines et sociales, ont toute une réflexion méthodologique et épistémologique à approfondir.
Céline Labrune Badiane est historienne, ITEM/CNRS (France).
Pape Chérif Bertrand Bassène, Akandijack est historien/Ucad.
Mouhamadou Moustapha Sow, « Foyre » est historien/Ucad.
Source : Seneplus (Sénégal) – Le 21 juin 2024
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com