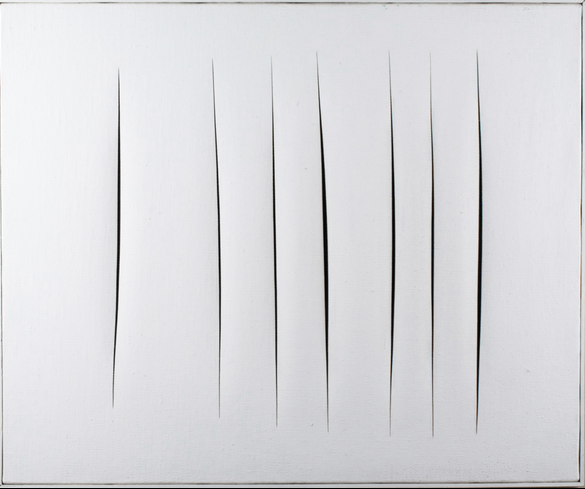Orient XXI – « Nous sommes assez bons pour produire nos armes nous-mêmes », déclare Benyamin Nétanyahou le 15 septembre 2025 en réponse à l’interdiction prise par l’Espagne de livrer des armes à Israël via ses ports et son espace aérien. Le pays, dit-il, devra être autosuffisant en armement. Le premier ministre israélien reconnaît ainsi pour la première fois l’impact des sanctions. Et ambitionne de faire d’Israël « la nouvelle Sparte1 ».
Ses propos déclenchent le lendemain la chute de la Bourse de Tel-Aviv. Car la nervosité a gagné tous les secteurs en Israël. La politique menée par le gouvernement Nétanyahou « conduit l’État d’Israël vers un abîme économique et diplomatique dangereux et sans précédent », déclare le Forum des entreprises israéliennes.
Ancien ambassadeur d’Israël à Bruxelles, qui fut en charge des relations internationales des universités israéliennes, Emmanuel Nahshon s’inquiète devant la Knesset le 10 septembre de la multiplication des dénonciations de partenariats universitaires et de recherche. Elles sont, dit-il, une « menace stratégique » pour l’État israélien.
Suspension des partenariats universitaires
Lancé en 2024 en Europe et aux États-Unis après plusieurs mois de guerre à Gaza, le mouvement de boycott financier, commercial, sportif, mais aussi des milieux culturels et universitaires israéliens a gagné en vigueur durant l’année 2025, notamment après la rupture par Tel-Aviv de l’accord de cessez-le-feu en mars 2025. Les images de la guerre à Gaza témoignant de la famine organisée par l’armée israélienne et de la destruction systématique du territoire, ainsi que le nombre effarant de civils tués ont déclenché de vives réactions dans la société civile, auxquelles les États ne peuvent rester insensibles.
Des établissements d’enseignement supérieur aux États-Unis et partout en Europe — Espagne, Irlande, Écosse, Pays-Bas, Norvège, etc. — suspendent leurs partenariats avec Israël : financements, projets de recherche, échange d’étudiants, invitations à des séminaires ou colloques…
Ces structures communiquent rarement sur leurs actions ; à cet égard, l’université belge de Gand fait figure d’exception et a même été précurseur. Son recteur a déclaré dès le 17 mai 2024 que l’université mettait fin à trois partenariats avec des institutions israéliennes pour non-respect des droits humains.
En France, le mouvement reste timide. Sciences-Po Strasbourg, au grand dam du ministère des affaires étrangères, suspend, le 25 juin, ses partenariats avec l’université Reichman de Tel-Aviv en raison de son « engagement actif » dans la guerre à Gaza, regrettant ses positions « profondément bellicistes ». C’est à ce jour le seul.
Mais des pétitions circulent parmi les scientifiques français. Les autorités israéliennes s’alarment particulièrement de celle de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). En septembre 2025, ils sont plus de mille scientifiques de ce centre international, à la pointe de la recherche sur les particules, à demander que la collaboration avec Israël, un des 25 États membres, soit réévaluée. Cela concerne, en Israël, plus d’une centaine de scientifiques, qui mènent des recherches dans cette spécialité.
« Si nous quittons ce domaine, l’impact sera dramatique, les dommages scientifiques seront très graves », dit Emmanuel Nahshon, toujours lors de son audition devant la Knesset. Après deux ans de guerre, Israël déplore environ mille boycotts académiques venant d’institutions américaines ou européennes. « Nous sommes dans la pire des situations, s’alarme le professeur Ariel Porat, président de l’université de Tel-Aviv. Nous espérons que la situation va s’arranger avec l’accord de cessez-le-feu, mais l’hostilité envers Israël demeure. »
La question embarrasse les universités partenaires : dans quelle mesure leur collaboration avec Israël trouve-t-elle une application militaire dans la guerre en cours ? En Israël, les secteurs universitaire et militaire sont imbriqués. Selon l’anthropologue israélienne Maya Wind2 : « Les universités sont impliquées dans le développement des armes et des technologies utilisées à Gaza. » Certaines disposent même de complexes militaires intégrés, dit-elle.
Source : Orient XXI
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com