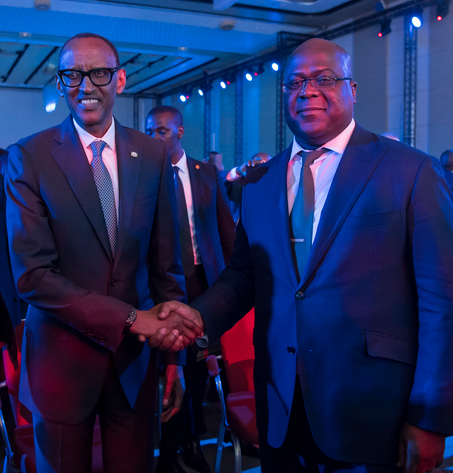Afrique XXI – Analyse · Malgré les annonces et les réunions de médiation, aucune avancée n’est visible dans l’est de la RD Congo, où le groupe M23/AFC étend son emprise militaire et administrative. De son côté, le régime congolais se durcit.
Blessé à la tête, les mains et les genoux bandés, le journaliste congolais Claude Pero Luwara n’a toujours pas récupéré après avoir été victime d’une agression dans la paisible ville flamande de Tirlemont, en Belgique. Au-delà du choc physique, il se demande comment, au cœur de l’ancienne métropole, un commando de six à sept personnes a pu le guetter alors qu’il regagnait son domicile. La plainte aurait été classée sans suite si le bourgmestre (maire) de la ville n’avait pas été présent sur les lieux. Témoin du passage à tabac de ce journaliste qui croyait avoir trouvé la sécurité en Belgique, l’élu local a mobilisé la police et les services de renseignements afin que cette agression soit prise au sérieux.
Pero Luwara, qui avait obtenu l’asile en Belgique, est sonné mais pas surpris : « À Kinshasa, l’atmosphère se tend : ceux qui critiquent le régime de Félix Tshisekedi sont accusés de faire le jeu des rebelles, voire soupçonnés d’être complices du mouvement M23, soutenu par le Rwanda. Ils craignent que leur tête soit mise à prix. » Un autre cas défraie à nouveau la chronique : celui de l’expert belgo-congolais Jean-Jacques Wondo, qui, arrêté à Kinshasa, a fini par être renvoyé dans sa patrie d’adoption, où il vient de recevoir des menaces de mort qui ont amené Bruxelles à protester auprès de Kinshasa.
Il est évident que le climat se durcit dangereusement. Plusieurs fidèles de l’ex-président Joseph Kabila, qui avait quitté le pouvoir en 2018 en donnant les rênes à un Félix Tshisekedi n’ayant pourtant pas gagné les élections, ont été expropriés, poussés à quitter le pays. Kabila lui-même, actuellement réfugié dans un pays d’Afrique australe, sans doute le Zimbabwe, a été accusé de haute trahison et condamné à mort par contumace tandis que ses biens étaient confisqués. La nationalité congolaise de cet homme qui a dirigé le pays pendant dix-huit ans a été remise en question, et des témoins à charge ont même assuré qu’il n’était pas le fils de Laurent-Désiré Kabila…
La démission de Vital Kamerhe, le président du Parlement, originaire de Bukavu, et le bannissement de Joseph Kabila, lui aussi enraciné dans l’est du pays, risquent d’aliéner les provinces orientales alors que, dans les régions occupées, les rebelles du M23 consolident leur emprise, mettent en place des administrations parallèles et forment de nouvelles recrues.
Constant Mutamba condamné
Il y a aussi le cas de Constant Mutamba : le jeune ministre de la Justice a été accusé d’avoir détourné 19 des 325 millions de dollars que l’Ouganda avait été contraint de verser à la RD Congo à la suite d’un jugement de la Cour pénale internationale. Il s’agissait d’un dédommagement pour la « guerre des six jours ». Mené en 2000, ce conflit avait mis aux prises les armées du Rwanda et de l’Ouganda et dévasté Kisangani, la capitale de la Province-Orientale. Ne reconnaissant pas la CPI, le Rwanda n’a rien déboursé.
Constant Mutamba avait affirmé que cet argent devait servir à construire une prison à Kisangani. Les victimes congolaises n’ont jamais été dédommagées et, soupçonnant des irrégularités, elles se demandent toujours pourquoi l’ancien ministre de la Justice avait, en son temps, donné priorité à la construction d’un établissement pénitentiaire.
Tribun populaire au sein de la jeunesse de Kinshasa, Constant Mutamba a cependant été traité avec ménagements : condamné à trois ans de travaux forcés, il a été conduit dans une résidence de luxe. Plus que son usage controversé des fonds publics, la fougue et les qualités d’orateur de ce leader qui se réclame de Patrice Lumumba avaient été ressenties comme une menace pour Félix Tshisekedi. La condamnation du jeune ministre devrait l’empêcher de se représenter au prochain scrutin présidentiel, prévu pour 2028.
Durcissement à Kinshasa, où le régime rêve d’un troisième mandat non prévu par la Constitution, emprise croissante des rebelles du M23 sur les populations des zones occupées au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, et surtout renforcement des effectifs militaires sur la ligne de front du Sud-Kivu : les espoirs suscités par la diplomatie états-unienne ont fait long feu.
La montée de la haine
Sur le terrain, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), arrivées en RD Congo au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, en 1994, et aujourd’hui trop âgées pour combattre, ont été rejointes par de jeunes recrues, parmi lesquelles des Hutus de nationalité congolaise. Quant aux troupes rwandaises présentes dans l’est du Congo, l’estimation de leur nombre a varié au fil des semaines : le dernier rapport des experts de l’ONU1, daté du 3 juillet, affirmait que « leur nombre, en janvier et février, pouvait être estimé à 6 000 soldats y compris des forces spéciales. S’y seraient ajoutés des combattants des FDLR récemment démobilisés, engagés dans des opérations de reconnaissance, de renseignement et de combat. »
Les experts précisent cependant qu’« après la prise de Goma, l’empreinte de la RDF [Rwanda Defence Force, NDLR] a été réduite au minimum nécessaire afin de maintenir la discrétion sur l’implication du Rwanda ». Au moment de la publication du rapport, on estimait que 1 000 à 1 500 éléments de la RDF étaient encore actifs dans les territoires contrôlés par l’AFC/M23, y compris dans les centres urbains.
Les experts ajoutent que « les engagements successifs de la RDF n’avaient pas pour objectif premier de neutraliser les FDLR ou de mettre fin à une prétendue menace pour l’existence du Rwanda, mais de conquérir de nouveaux territoires ». Selon eux, « le contrôle de l’est de la République démocratique du Congo par l’AFC/M23 a permis au Rwanda d’accéder à des territoires riches en minéraux et à des terres fertiles, de décimer les rangs des FDLR et de s’assurer une influence politique en République démocratique du Congo ».
L’hostilité des wazalendo envers les Tutsis
L’engagement militaire du Rwanda a cependant eu un coût : Human Rights Watch, sur la base de photos aériennes du cimetière militaire de Kanombe, a révélé2 l’existence de plusieurs centaines de tombes fraîchement creusées. Autrement dit, des soldats rwandais trouvent la mort dans un conflit auquel, officiellement, ils ne participent pas.
Alors que le traumatisme de la débâcle essuyée à Goma en février n’est pas dissipé, les Forces armées de la RD Congo (FARDC), dotées de nouveaux équipements, se battent désormais sur le front sud : elles tentent d’enrayer la progression des rebelles du M23 dans les hautes montagnes qui surplombent le lac Tanganyika. Seul le soutien de l’armée burundaise, qui a dépêché 10 000 hommes sur le terrain, empêche encore la chute de la ville frontalière d’Uvira, qui ouvrirait la voie du Maniéma et du riche Katanga.
Davantage encore que les armées régulières, ce sont les combattants « wazalendo » (« enfants du pays ») qui incarnent la résistance : parmi eux se trouvent des jeunes gens désireux de défendre leur territoire mais aussi des groupes irréguliers qui rançonnent les populations civiles ou ont fait alliance avec des combattants hutus rwandais issus des anciens camps de réfugiés après le génocide de 1994. Les wazalendo et leurs alliés développent une hostilité virulente à l’encontre des Tutsis congolais, qu’il s’agisse d’éleveurs chassés de leurs territoires ou d’officiers de l’armée congolaise dont l’appartenance3 est violemment contestée. Cette montée de la haine réveille de terribles souvenirs, et les militaires burundais, parmi lesquels de nombreux officiers tutsis, craignent de se voir entraîner dans un engrenage fatal.
Reporter au service International du quotidien belge le « Soir », Colette Braeckman est spécialiste de l’Afrique centrale et des Grands lacs, en particulier du Rwanda, du Burundi et de la RD Congo
Source : Afrique XXI
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com