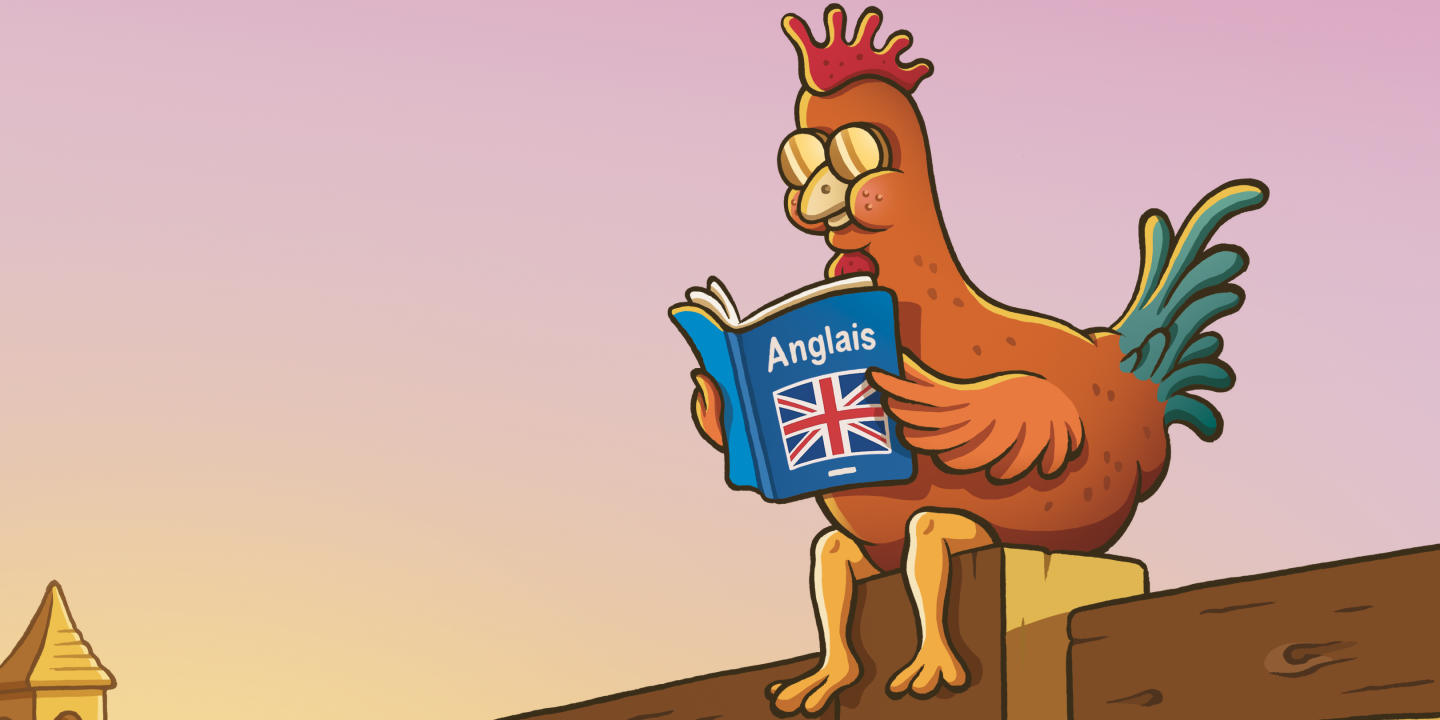
Tout comme la plupart des Européens de ma génération, j’ai appris le français à l’école – c’est-à-dire pas bien. Quand je me suis installé à Paris, certains professeurs de français vantaient les mérites de se trouver une petite amie locale pour progresser rapidement. L’idée semblait bonne, mais mon amoureuse, venue, elle, des Etats-Unis, aurait sans doute été moins enthousiaste.
Après quelque temps en France, j’ai réussi à glaner çà et là les connaissances nécessaires pour me débrouiller au quotidien, face à l’administration, et même avec des amis. Mais, malgré vingt ans d’efforts, parler en français me fait toujours paraître encore plus stupide et ennuyeux que je ne le suis en anglais. L’instant supplémentaire dont j’ai besoin pour comprendre une phrase me prive de toute spontanéité. Et quand un Français hasarde une blague, je panique.
J’admire la France et sa langue. Alors ne prenez pas l’interrogation suivante pour une sentence arrogante proférée par un affreux Anglo-Saxon : ne suis-je pas l’un des tout derniers étrangers disposés à faire un tel effort linguistique ? Car se lancer dans la longue aventure qu’est l’apprentissage du français – langue de seconde zone à vrai dire – semble un investissement de moins en moins utile, à l’heure de l’anglais généralisé et de la traduction assistée par ordinateur. Je prédis plutôt une accélération du processus d’allégeance à l’anglais dans lequel s’est timidement engagée la société française. Car, en vérité, même si c’est difficile à entendre, sauvegarder le rayonnement de la France et des Français à l’échelle de la planète passe nécessairement par ma langue maternelle.
Aujourd’hui, l’anglais est « parlé et écrit plus largement qu’aucune autre langue ne l’a jamais été », selon Robert McCrum et ses coauteurs dans The Story of English (Faber & Faber, 2011). Dans les pays de l’Union européenne, près de 98 % des élèves à l’école élémentaire et au collège apprennent l’anglais. D’autres langues telles que le français, l’allemand ou l’italien ne peuvent que se disputer la seconde place, encore faut-il qu’une seconde langue étrangère soit au programme…
Tout cela fait décroître l’intérêt pratique d’apprendre une autre langue, quelle qu’elle soit. En ce qui me concerne, j’ai consacré une décennie de ma jeunesse à apprendre l’allemand. Mais les Allemands que je rencontre aujourd’hui insistent systématiquement pour converser en anglais avec moi : ils sont presque parfaitement bilingues. Il est appréciable de pouvoir lire un journal allemand dans le texte, mais rien ne m’empêche à présent de lire un journal finlandais : il me suffit de le copier-coller dans Google Traduction. Traducteurs et interprètes m’affirment qu’un logiciel est faillible, que l’on y perd en nuance – mais combien d’années d’immersion en Finlande me faudrait-il pour rivaliser avec ce service ?
Chaque pays a encore besoin d’experts étrangers maîtrisant parfaitement sa langue : universitaires, diplomates, correspondants de médias étrangers, etc. J’ai rencontré des représentants de cette petite caste d’Occidentaux lors d’un voyage en Chine : ils ont réussi à gravir la montagne qu’est le mandarin, et décroché en récompense le droit de mener toute leur carrière à Pékin. Dans le cas de la France, cette tribu de spécialistes reste surnuméraire : il y a tant d’étrangers qui tombent amoureux de l’Hexagone que ce pays regorge d’ambassadeurs à la retraite, d’auteurs venus des Etats-Unis pour écrire des essais que personne ne lira sur le fromage au XVIIIe siècle et autres sujets français. A l’échelle du globe, l’offre de spécialistes et amateurs de la France est disproportionnée par rapport à son statut actuel. C’est le contraire pour la Chine.
La plupart des gens n’ont pas vocation à rejoindre une telle caste ou à passer leur vie auprès d’un conjoint – ou d’une belle-mère – francophone. Pour l’immense majorité, s’embarquer dans l’apprentissage du français mérite réflexion. Car, après tout, si l’on veut simplement savoir où se trouvent les toilettes, pratiquer un français approximatif n’est plus nécessaire.
Les anglophones sont rois
Dans les rencontres internationales auxquelles j’ai récemment assisté, j’ai constaté que deux langues dominent, à l’exclusion de toutes les autres : l’anglais et le globish, version simplifiée et dégradée de la langue anglaise (dépourvue d’images ou de mots compliqués). Lors d’un sommet européen à Bruxelles, peu après le Brexit, je n’ai compté qu’une seule oratrice livrant son discours en français.
Les « globishophones » sont capables de se faire comprendre. Mais ne pouvant recourir à leur langue maternelle, ils font l’expérience du sentiment que j’éprouve lorsque je parle le français : leur QI semble baisser drastiquement. Et lorsqu’un anglophone-né ouvre la bouche, on a soudainement l’impression que le niveau des débats monte. Parler dans sa propre langue permet d’être fluide et divertissant, d’ajouter de l’humour ou de la nuance à son propos. Les anglophones captent l’attention, voire suscitent une adhésion accrue à ce qu’ils disent. Ces exemples probants relèvent d’un phénomène bien plus large : dans la hiérarchie internationale qui se fait jour, les anglophones sont rois. Leur aisance leur permet de décrocher des promotions, des contrats, voire l’amour.
Dans la plupart des situations professionnelles transnationales, les anglophones de naissance ont la haute main sur la conversation, à grand renfort d’expressions telles que let me just jump in here… (« si je peux intervenir… ajouter quelque chose… ») ou so what we’re saying is… (« autrement dit… pour résumer… »). Pendant ce temps-là, les étrangers restent souvent mutiques, concentrés pour suivre la discussion. Et lorsqu’un compte rendu doit être établi ou qu’un porte-parole doit être désigné, la tâche échoit souvent à un anglophone de naissance, renforçant d’autant plus son pouvoir.
Autre cas de figure : le networking ou « réseautage ». Les Français aiment développer leurs relations professionnelles au déjeuner, tandis que les Britanniques préfèrent descendre des bières à la sortie des bureaux. Mais le principe reste le même : saisir l’occasion pour, l’air de rien, créer des relations de confiance et échanger de nombreuses informations. Ces échanges informels, cependant, ne prennent place que lorsque tout le monde se sent à l’aise dans la même langue. C’est flagrant lors d’événements internationaux : pendant les sessions de la journée, chacun regarde ses courriels sur son téléphone, puis les francophones vont dîner ensemble, en parlant le français, tandis que les Britanniques, Américains et Européens du Nord vont manger ensemble de leur côté – souvent en disant du mal des Français. A 23 heures, les Américains vont se coucher et les Britanniques poursuivent le networking au bar avec les Européens du Nord. Bref, dans cette nouvelle ère, le côté pratique du français décline, mais le globish ne suffit plus. Le défi, en particulier pour les jeunes Français pleins d’ambition, est de réussir le saut qualitatif du globish au véritable English.
La France peut se résigner au même destin qu’un autre pays du sud de l’Europe qu’on ne nommera pas, à savoir devenir une sorte de musée grandiose, agrémenté d’innombrables cafétérias. La France peut aussi tenir son rang au niveau mondial et continuer à peser dans l’actualité : mais les Français doivent progresser en anglais.
A Paris, les parents anglophones sont maintenant avantagés pour obtenir une place en crèche, tant les Parisiens s’échinent à exposer leurs bambins à l’anglais. A la naissance de ma fille, j’ai découvert l’existence d’une lettre-type que les anglophones se refilent de génération en génération : un beau jour, quelqu’un a pris sa plus belle plume pour exposer, dans un excellent français, tout l’avantage qu’apporterait à la crèche du quartier la présence en son sein d’un enfant anglophone. La manœuvre a fonctionné pour ma fille.
Autodestruction
Je pense que la France va suivre la voie déjà empruntée par de petits pays comme les Pays-Bas ou l’Irlande, et voir se constituer deux élites : l’une reste au pays et le dirige, tandis que l’autre, généralement plus dégourdie et plus ambitieuse, cherche le succès en s’expatriant partout dans le monde. Les Français qui réussissent hors de leurs frontières maîtrisent l’anglais et non le globish – par exemple, Christine Lagarde, qui étudia un temps dans une école privée du Maryland, aux Etats-Unis. En cela, la France succombe avec retard à une tendance globale déjà ancienne. Comme le note l’historien britannique Eric Hobsbawm, « dans les anciennes colonies britanniques de l’Afrique ou de l’océan Pacifique, le chemin vers l’éducation, la richesse et le pouvoir » passe traditionnellement par l’apprentissage de l’anglais.
L’usage du français pourrait
bientôt se cantonner à la cuisine
ou au cadre administratif
Ainsi, les jeunes Français ambitieux vont de plus en plus faire l’impasse sur la khâgne et suivre un cursus universitaire en anglais ici ou là. J’ai pour ma part grandi à Leyde, petite ville néerlandaise où mon père enseignait l’anthropologie à l’université. C’est la plus ancienne faculté du pays, mais, à l’époque, elle occupait une place insignifiante au niveau international, et mon père donnait ses cours dans un néerlandais assez rudimentaire. Aujourd’hui, dans la majorité des cursus qui y sont proposés, les enseignements sont dispensés en anglais.
L’usage du français pourrait bientôt se cantonner à la cuisine ou au cadre administratif – un futur qui peut sembler dystopique. Mais cette généralisation quasi universelle de l’anglais pourrait résoudre un problème qui dérange depuis des décennies l’élite française : la domination qu’exercent les idées anglo-saxonnes. De fait, les revues scientifiques de premier plan et les médias influents sont presque tous anglophones à l’échelle du globe. Nombre d’organes de presse importants émanent toujours de mon pays natal, aux frontières pourtant étroites et au dynamisme pour le moins chancelant. L’actualité internationale est ainsi encore régie, de manière disproportionnée, par des médias britanniques tels que la BBC, The Guardian, The Economist ou encore mon employeur, le Financial Times. J’interprète la France dans la langue mondiale en tant que journaliste « anglo-saxon ». Mes lecteurs français m’accusent souvent de French bashing – même si je n’arriverai jamais à la cheville des champions de la discipline, les Français eux-mêmes.
Simon Kuper
Le journaliste et écrivain chroniqueur au « Financial Times » et installé à Paris
Traduit de l’anglais par Lucas Faugère.
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com