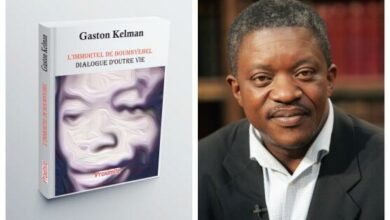Un patrimoine exceptionnel à l’abandon.
Le mois de novembre a marqué les cinquante ans du passage à l’Olympia d’Oum Kalthoum, concerts mythiques d’une chanteuse que Bruno Coquatrix, le directeur, pensait être « une danseuse du ventre ». Mais ces concerts — parmi les seuls que la chanteuse égyptienne ait jamais donnés hors du monde arabe —, auréolés de multiples légendes (une durée de 5 h chacun, la supposée conversion à l’islam de Gérard Depardieu à l’issue du concert, etc.), inutile d’en chercher une réédition. En réalité, vous ne pourrez en acheter la moindre version audio ou vidéo. Pour les écouter, et seulement partiellement, le seul moyen est de passer… par YouTube.
Depuis quelques années en effet, le patrimoine de la musique arabe réémerge par ce biais inattendu. Les réseaux sociaux, et YouTube en particulier, occupent une place importante dans le monde des pratiques culturelles (musicales ou autres) arabes aujourd’hui. Régulièrement en émergent des buzzs qui arrivent parfois jusqu’à l’Europe et l’industrie des clips musicaux autrefois centrée sur la télévision a largement investi ce nouveau média. Mais ces sites ne servent pas qu’au nouveaux artistes à la mode, ils se sont aussi transformés de manière inattendue en outils d’archivage et de diffusion. La patrimonialisation sauvage d’une culture arabe autrement inaccessible.
« Al-Atlal » (les ruines)
Que ce soit pour les plus grandes stars comme Oum Kalthoum ou, a fortiori, pour d’autres moins connues, la musique arabe dont on célèbre ces derniers temps la redécouverte est difficile à trouver, les rééditions n’existent pas ou sont de mauvaise qualité. Pour ceux qui voudraient simplement découvrir Oum Kalthoum avec un best-of, difficile de s’y retrouver, que ce soit en arabe ou dans une autre langue : on dénombre pas moins de 31 manières de retranscrire son nom depuis l’arabe1, et chacune d’entre elle ou presque renvoie à de multiples maisons de disques — et autant de versions d’une même chanson. S’il y a certes une intégrale, disponible dans le monde arabe mais pas en Europe, celle-ci a un prix prohibitif (1 500 dollars, soit 1268 euros), et s’avère être en réalité une simple boite luxueuse avec l’intégralité des CD sortis dans les années 1990.
Alors même que les majors européennes n’ont de cesse de travailler leur back catalogue dans des versions de plus en plus luxueuses (long boxes, son remastérisé, inédits et faces B, livrets qui détaillent le personnel, le lieu et le jour de chaque piste, etc.) depuis Maria Callas jusqu’aux Rolling Stones, difficile d’en trouver l’équivalent pour la musique arabe, où pourtant l’aura d’une Oum Koulthoum est sans commune mesure.
La raison est d’abord économique. Au niveau européen et américain, difficile de vendre cette musique. Et dans le marché du monde arabe, l’effet de rente de la musique n’existe tout simplement pas : le marché est aujourd’hui miné par le piratage, les querelles entre ayant-droits, la disparition de nombreux labels, l’absence de collecte des droits d’auteurs… Sans compter le spectre politique : c’est seulement en octobre dernier que l’Arabie saoudite a diffusé un concert d’Oum Kalthoum pour la première fois sur une chaîne publique. Dans ce même pays, le droit d’auteur n’existait tout simplement pas avant 20032, et il n’est pas ou peu (seulement au Liban) collecté dans les autres, au point que selon un acteur du marché, Abed Agha interviewé par Wamda.com, « l’avantage d’opérer dans le monde arabe, c’est que l’on part de zéro, réussir à s’assurer du moindre revenu est déjà une grande chose ». Rares sont ceux qui tentent de faire de la réédition dans de telles conditions. La fondation Arab Music Archiving and Research (AMAR) en a fait l’expérience mitigée avec sa long box autour d’un chanteur du début du XXe siècle, Youssouf Al-Manialaoui. Largement piratée, « elle s’est bien plus vendue en Europe que dans le monde arabe », souligne Moustafa Saïd, le directeur d’AMAR. Et surtout pas assez pour que l’association se lance à nouveau dans un tel projet.
Les petites mains de la nostalgie
Cette absence de marché de la réédition n’empêche cependant pas Oum Kalthoum et d’autres de rester très écoutés, car si la nostalgie ne se vend pas elle est omniprésente dans le monde arabe, et depuis dix ans une foule d’anonymes la font vivre par le web. Des petites mains, à travers toute la région, ont partagé clips, chansons, créé des dizaines de pages en l’honneur des artistes, mieux qu’aucune maison de disques ne l’avait fait jusqu’ici, en profitant de la levée d’une limitation technique : difficile jusque-là de faire une compilation d’Oum Kalthoum, dont les chansons d’une heure et plus nécessitaient des dizaines de CD3. Sur le web, plus de limites, et même la possibilité pour chacun de sélectionner et partager ses passages préférés. Chacun a pu s’approprier ces artistes légendaires librement, sans que leurs maisons de disques interviennent. C’est à peine si celles-ci se sont lancées à contretemps dans cet exercice dont elles ne perçoivent pas vraiment l’intérêt. Mazzika, la compagnie qui gère les droits de plusieurs « légendes », vient à peine de lancer une chaîne YouTube, mais n’en attend pas grand-chose de lucratif : aucune vidéo n’est monétisée ou ne ramène à une possibilité d’achat du titre écouté.
Contrairement à un contexte européen où les maisons de disques font la chasse à tous ceux qui mettent à disposition des titres et les font disparaître en un rien de temps, rien de tel n’existe pour ces artistes arabes. Au point d’inverser les hiérarchies : chaînes YouTube, forums ou groupes Facebook constituent aujourd’hui les principaux moyens de les écouter, et plus encore proposent des titres et des vidéos qui ne sont pas vendus. Les fans ont pris le pouvoir et cette patrimonialisation sauvage a fait réémerger des bouts de patrimoine oubliés, voire inédits, à travers la numérisation de cassettes audio ou vidéo de simples amateurs, tout comme celle de collections privées plus structurées de riches connaisseurs. Dans ce mouvement, musiques populaires comme musiques savantes sont ramenées à la vie, et les uns et les autres réinventent les contours de la « musique arabe ».
Avec d’autres projets, comme le forum Sama3y (2005), AMAR, créé en 2009 à partir du fond du collectionneur Kamal Kassar en association avec un oudiste réputé, Moustafa Saïd, est ainsi l’un des projets les plus emblématiques de ce nouvel intérêt pour les musiques arabes, où s’ouvrent des collections privées jusque-là jalousement gardées. Centré sur la musique de la Nahda (fin XIXe-années 1930), époque où les premiers cylindres et 78 tours émergent dans la région, ce projet vise à faire redécouvrir « l’avant » Oum Koulthoum, une chanteuse finalement très moderne dans son utilisation de l’orchestre symphonique d’inspiration européenne. L’association exhume et numérise des enregistrements rendus rares par les bouleversements des deux guerres mondiales, comme pour des raisons plus politiques, « pendant dix ou quinze ans ils ont été interdits sous Nasser, parce qu’ils rappelaient les temps d’avant son arrivée au pouvoir », souligne Moustafa Saïd. Dans les hauteurs de Beyrouth où se situent leurs locaux, on numérise aussi les bandes magnétiques inédites de soirées privées dans l’Arabie saoudite des années 1930, jamais commercialisées. Une musique savante, mais qui n’a pas vocation non plus à être laissée aux seuls universitaires et collectionneurs. Pour Monzer Al-Hachem, qui travaille depuis peu dans l’association, cette musique avec laquelle il n’était pas familier a fini par lui parler « comme on pourrait écouter un vieux blues ».
La mémoire des Arabes d’ailleurs
C’est par un biais différent qu’à Marseille Damien Taillard de l’association Phocéephone s’est intéressé à une autre musique arabe, celle des immigrés maghrébins des Trente Glorieuses. Musique délaissée par les collectionneurs de 78 tours, plus intéressés par la « vraie » musique arabe, ce que relève le musicologue Jean Lambert : « Les musiques populaires sont souvent le parent pauvre de toutes les études et les efforts d’archivage ».
Lorsque Damien Taillard lance son blog, c’est d’abord au hasard de la curiosité pour une musique qui n’intéresse alors pas grand monde : « En 2006-2007 je suis tombé sur un bac de disques au marché, des 45 tours, d’un gars dont ce n’était pas du tout l’activité principale. Les vendeurs itinérants des années 1970 vendaient des disques en même temps que les chaussures ou l’électro ménager. » Depuis il a amassé plusieurs centaines de disques, devenant l’un des meilleurs spécialistes de cette musique. Au cœur de la démarche, il y a aussi une fibre militante. Quand il mixe ce dimanche 12 novembre, c’est dans un bar historique au cœur de Belsunce, le quartier emblématique de cette immigration à Marseille. Là-bas, les clients racontent volontiers que Ya Rayah, eux avaient entendu Dahmane El-Harrachi la jouer dans les anciens cabarets et bars du quartier. À travers la musique, son projet soulève un pan de la mémoire de l’immigration. Dans cette logique, il ne s’agit pas de trouver la pépite qui fera danser d’autres bars plus branchés ni de garder les titres et leurs noms pour lui mais de restituer aussi les informations patiemment accumulées sur ce patrimoine disséminé entre le Maghreb et la France : « il faut archiver, mais aussi transmettre ».
Cette démarche de transmission croise aussi une envie de réappropriation de la part des enfants de l’immigration, comme Nabil Djedouani, qui a lancé il y a peu « Raï and Folk », où il numérise et met à disposition des titres algériens des années 1960 à 1990. Pour lui la question dépasse le domaine musical et touche aussi au cinéma, sa passion originale, tout autant redécouvert ces dernières années. Difficile en effet de différencier les uns et les autres. D’abord parce qu’acteurs privés comme publics faisaient souvent dans l’audiovisuel en général ; l’ONG libanaise Umam (spécialisée dans les archives et la patrimonalisation) qui a récupéré les archives du Studio Baalbeck au Liban y a ainsi découvert autant de films que de musique. Et l’usage central de YouTube comme « instrument » de patrimoine a bien sûr mis en valeur clips et extraits de films. De fait Nabil Djedouani s’est d’abord « intéressé à la musique en tombant sur un clip, posté par un gars en Italie, qui numérisait des cassettes, des archives de la TV algérienne », et son chemin a plusieurs fois croisé celui de diggers intéressés par des musiques de film, par exemple celles d’Ahmad Malek, récemment réédité.
Les archives, faute de mieux
Mais pour eux, il n’y a pas d’euphorie à avoir. Derrière ce phénomène web, les « vraies » archives disparaissent. Comme le racontait en 2006 Kamal Kassar à Elisabeth Cestor, « il y a de très grands chanteurs et chanteuses qui ont travaillé toute leur vie pour la radio. Ces bandes sont en complète décomposition ; or la plupart de ces chanteurs ne peuvent plus être entendus, car souvent ils sont morts et la radio n’avait jamais pris des initiatives d’édition musicale »4. Rien n’a tellement changé depuis. Si l’on ne sait pas vraiment ce que deviennent les archives des maisons de disques privées, il reste toutefois un trésor inexploité des archives publiques, inaccessibles sans que l’on sache s’il s’agit encore de cacher quelque chose de précis (les coupes de la censure par exemple), ou bien à force de masquer l’état de décrépitude d’archives laissées à l’abandon. Dans la majorité des pays de la région, une grande partie des archives musicales se trouvent ainsi dans les radios et télévisions d’État, qui n’ont pas mis ce patrimoine en valeur, laissant les archives disparaître ou bien être discrètement accaparées et revendues.
Et le problème n’est pas moins épineux avec des films ou des musiques récents. Pour le raï par exemple, produit d’une époque où l’État n’avait plus le monopole de l’audiovisuel, toutes les maisons de disques de l’époque ont déjà disparu ou presque, leurs producteurs jetant parfois l’ensemble du stock et passant à autre chose. Comme le souligne Damien Taillard, à Belsunce, anciens producteurs et magasins de musique sont aujourd’hui reconvertis dans le prêt-à-porter. Déjà le support — les cassettes — vieillit mal. D’autant plus qu’elles étaient surtout produites à la demande, c’est-à-dire piratées par n’importe quel revendeur.
Un avenir incertain
Derrière l’effervescence apparente autour de la musique ou du cinéma arabe il y a, chez chacun de ces acteurs, lassitude et inquiétude. Leur volonté de transmission se heurte à un problème financier. « Ce que j’aimerais c’est créer un centre de ressources numériques. Régulièrement je suis contacté par des étudiants algériens. Mais il faut l’argent pour payer un site… », souligne Nabil Djedouani, à l’unisson avec tous les autres acteurs de ce patrimoine, qui prennent surtout sur leur temps et leur argent personnel. Difficile de vendre des disques à perte, ou encore de se payer le matériel adéquat : chez Damien Taillard, la numérisation passe ainsi par une « simple platine dans le salon, une carte son, branchée sur l’ordi ». La question de l’argent est d’ailleurs devenue de plus en plus importante ces dernières années, car riches collectionneurs du Golfe comme diggers occidentaux ont fait monter les prix et attiré l’attention les uns sur les 78 tours, les autres sur la pop arabe. Et pour certains parmi eux, il ne s’agit pas tant de redécouvrir et partager que d’acquérir et garder pour soi les pièces rares ou uniques.
Dans ce cadre, aucune autorité n’est aujourd’hui en mesure d’exercer un « droit de préemption » au nom du patrimoine arabe, pas plus qu’il n’y a d’institution qui aurait le budget pour acheter à un meilleur prix sur ce marché. D’AMAR à Raï and Folk, on regrette ainsi le manque d’action des pouvoirs publics autant qu’on se méfie du risque des projets « d’affichage », ponctuels, qui ne débouchent pas sur une action à long terme. La situation est compliquée : lorsque les financements existent, notamment ceux de l’Union européenne ou de l’Unicef, ils se font au coup par coup et sur une durée limitée, alors même que l’archivage nécessite du long terme et la tutelle d’acteurs pérennes. La rareté de ces financements oblige ensuite à choisir entre tous ces projets pourtant largement complémentaires. Et si les États arabes ont laissé cette question en friche, de l’autre côté de la Méditerranée ont est parfois bloqué pour des raisons politiques (difficile de numériser en France le cinéma algérien d’après l’indépendance…), ou bien plus simplement juridiques : au Liban l’Institut national de l’audiovisuel (INA) n’a pas pu mener à bien la numérisation des bandes du studio Baalbeck à cause de l’impossibilité de retrouver les ayant-droits.
De fait, alors que ce mouvement a maintenant quelques années, certaines organisations sont déjà en sourdine, à l’image de l’association IRAB, ou bien, dans un autre domaine, de la Lebanese Photo Bank du collectionneur Naïm Farhat. Et même la fortune personnelle du fondateur d’AMAR n’a pas suffi à numériser plus que 20 % de sa collection depuis 2009. Le risque est grand aujourd’hui qu’à force le mouvement s’essouffle, que les collections retournent au privé, que les numérisations ne soient pas terminées ou ne donnent jamais lieu à des publications, ou encore que les vidéos et musiques finissent par disparaître du web, là où l’archivage à long terme est plus qu’incertain.
1Umm/Um/Oum/Om Kulthum, Kalthoum, Koulthoum, Koultoum, Katloum, Kalsoum… Dans la presse c’est Oum Kalthoum qui est le plus utilisé, tandis que la translittération conventionnelle chez les arabisants et dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France (BNF) est Umm Kulṯūm.
2Lire Carole Bremeersch, La propriété intellectuelle en Arabie saoudite, INPI, 28 septembre 2016.
3Les chansons d’Oum Kalthoum s’apparentent par leur durée à une symphonie de musique classique. Certaines ne tiennent même pas sur un CD. Elles sont de plus rarement découpées en mouvements plus courts comme peut l’être la musique classique. La raison est simple : ces chansons étaient diffusées à la radio, contrairement à d’autres musiques d’emblée pensées pour rentrer dans la durée standard d’un disque.
4Élisabeth Cestor, L’enseignement et la pratique de la musique proche-orientale au Liban : évolutions, débats et révisions en cours In : Itinéraires esthétiques et scènes culturelles au Proche-Orient, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2007.
Source : Orientxxi.info
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com