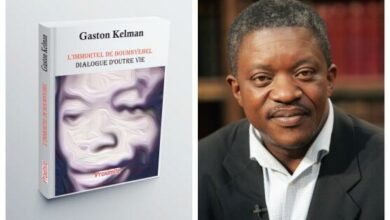[« Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans le demander. Dire je (…) Cela a pu commencer ainsi (…) Peu importe comment cela s’est produit. Cela, dire cela, sans savoir quoi. Peut-être n’ai-je fait qu’entériner un vieil état de fait. Mais je n’ai rien fait (…) Comment faire, comment vais-je faire, que dois-je faire, dans la situation où je suis, comment procéder ? », Samuel Beckett, L’innommable (Roman), Paris, Les Éditions de Minuit, 1953, p. 7].
[« Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans le demander. Dire je (…) Cela a pu commencer ainsi (…) Peu importe comment cela s’est produit. Cela, dire cela, sans savoir quoi. Peut-être n’ai-je fait qu’entériner un vieil état de fait. Mais je n’ai rien fait (…) Comment faire, comment vais-je faire, que dois-je faire, dans la situation où je suis, comment procéder ? », Samuel Beckett, L’innommable (Roman), Paris, Les Éditions de Minuit, 1953, p. 7].
Si Alioune Diop, l’intellectuel commun, dénomination par laquelle l’a désigné le philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga, revenait parmi nous, il aurait peut être prononcé ces mots en nous apostrophant : « La structure de notre personnalité changerait (…) si nous savions nos œuvres, nos pensées susceptibles d’agir sur tous, si nous nous sentions écoutés, et nous éprouvions solidaires du destin de tous. Il est urgent non pas d’éduquer mais d’équiper, en la respectant, la vitalité de l’Africain. Équiper sa vie économique…. Équiper du même coup sa vie sociale… Équiper la vie politique africaine d’institutions nées des besoins propres de l’Africain mis en face de ses responsabilités dans le monde, et chez lui-même. » [Cf. A. Diop « L’artiste n’est pas seul au monde », In L’art nègre, Présence Africaine, 2010 (1951, 1966), p. 13].
Ces trois équipements sont non seulement nécessaires, mais vitaux pour changer en profondeur la structure de notre personnalité, et réviser nos rapports avec nos artistes. Parce qu’il est convenu que « l’homme est plus précieux que son œuvre » [Alioune Diop, note 1, p. 12]. C’est à ce moment que nous pourrons prétendre faire le tour des galeries, des musées ou d’une exposition d’œuvres d’art ou de quelque autre objet que ce soit – non seulement pour son esthétique, mais pour les valeurs symboliques et imaginaires ajoutées qu’il recèle – livrés aux regards internes comme externes.
Dès lors, les objets se voient revêtus de la dignité de signifier, d’élever et de représenter matériellement une part de l’esprit philosophique ou religieux qui a présidé à leur conception [ce versant immatériel qui nous subjugue en se riant de nous !].
Conception qui condense en eux des traits de caractères, voire une partie du souffle vital de la communauté qui les a engendrés. Souffle que ses artistes insufflent aux objets, aux toiles ou toute autre composition entrée aujourd’hui, dans le domaine complexe de l’art, et qu’ils confectionnent selon des canons et des postures bien déterminés. C’est ce labeur qui rehausse toute œuvre et qui valide le sens profond de cet-éteint-sel de vie qui se loge dans son intérieur. Cette réalité implacable, la présence fatale du concepteur à côté de la « force » représentée, qui doit pouvoir garantir l’impensabilité de son « industrialisation ». Processus de reproduction qui dévalorise sa divinité symbolique primordiale. Celle qui a besoin d’être jalousement gardée, permanemment entretenue, périodiquement restaurée.
La Jaconde, devenue icône de la peinture, volée en 1911 par un vitrier italien considéré comme un patriote parce qu’ayant rapatrié une œuvre qui, si elle n’est pas italienne, est l’œuvre d’un italien représentant « une » italienne du XVIe, ne voyage plus. Elle poursuit son aventure, recluse dans une salle à l’intérieur d’un caisson blindé et micro-climatisé. Avant cette réclusion, elle a vécu deux « affronts ».
- Le premier : un déséquilibré mental a pu l’atteindre en lui projetant une pierre qui brisa la vitre au point que les éclats de verre l’égratignèrent.
- Le second : un touriste, capturé certainement par le sourire adressé au peintre et surtout ce regard qui vous poursuit du fond de son XVIe siècle, lui jeta sa tasse de café sans l’endommager cette fois-ci.
Cette petite histoire accessible sur Wikipédia permet de saisir comment une œuvre singulière, dont le « vrai » commanditaire n’en voulait plus parce que jugeant que son épouse est mal représentée, est devenue un fétiche. Elle suscite les discussions les plus osées jusqu’à la remise en cause de l’identité féminine de la supposée représentée, Mona Lisa. Donc toute chose qui rehausse une civilisation mérite amour, soins et surveillance. Comme on ferait d’un Autel détruit ou d’un tombeau hissé au rang de repère, de source et de ressources de revitalisation d’un projet de société.
Les objets doivent savoir parler d’eux-mêmes. Ils doivent pouvoir prononcer, à l’unisson, cette phrase : « J’ai l’air de parler, ce n’est pas moi, de moi, ce n’est pas de moi » [Samuel Beckett, L’innommable, Paris, Les Éditions de minuit, 1953, p. 7]. C’est dans ce sens qu’il est indispensable d’éviter de tomber dans le piège du Musée historico-touristique qui montre sous la dictature des « tic-tacs » d’une vieille montre, d’un jaune dégradé et aux aiguilles bleues, accrochée à une colonne à la surface « carreaux cassés ». Et travailler pour un Musée historien qui garantit une certaine transversalité et une meilleure mise en perspective du récit qu’il représente à travers les objets qu’il offre à lire comme des manuscrits ouverts à la page ou des couches archéologiques dont il faut saisir le principe de continuité. Parce qu’il est impossible de ne pas prendre en compte la part de subjectivité qui commande la disposition et la succession des objets à montrer, l’angle du flux de lumière qui participe à les rehausser et à saisir les contours [regards en 3D] de cette totalité qu’ils expriment.
Un musée doit certainement avoir l’allure d'un Temple où règne un certain ordre [un rituel et pas un cérémoniel] et surtout où, un silence lourd pèse non seulement sur les lieux, mais aussi sur ceux qui l’administrent et ceux qui sont sa raison d’être : les visiteurs. Véritables pèlerins en visite, avec tout ce que la visite d’un lieu consacré exige comme solennité à vouloir ressembler à une véritable initiation. En réalité toute visite, d’un quelconque lieu, dans n’importe quelle circonstance, épouse toujours les contours qui préfigurent une initiation [les salutations, la façon de parler, de s’assoir et toutes les autres petites manières, jusqu’au petit cadeau final, comme une offrande… pour resserrer les liens] pour que le respect qu’on doit et qu’on nous doit s’accordent et coproduisent de la sociabilité. Une œuvre d’art porte son histoire propre tout rendant compte de l’Histoire de son histoire.
La vocation d’un Musée historien à devenir un lieu de dépôt actif et instructif de nos sensibilités tire l’une de ses substances dans ce silence méditatif qu’irrigue le regard réflexif qu’on pose sur ces « vieilles choses » et ses « fétiches ». Toutes choses que nous désignons et de manière malpropre – comme un « rejet d’une importante part de nous-mêmes – aada et bidaa. Deux concepts empruntés à la langue arabe, qui disqualifient « us et coutumes » antérieurs à son arrivée. Admettons qu’ils puissent signifier l’un l’art figuratif et abstrait [aada] et l’autre la sculpture et ses dérivés [bidaa].
Le regard réflexif a pour finalité d’exciter nos émotions les plus profondes. Celles qui brouillent toute possibilité de situer la source de ce frémissement interne. Ce petit rien qui « titille » et réveille en nous une part de notre humanité à la rencontre non seulement de la culture représentée, mais aussi de l’âme de l’artiste. Cette source insaisissable doit alimenter toutes les ressources mobilisées pour rehausser un élément quelconque de la culture, et lui assigner une posture respectable dans le processus qui accompagne toute transition vers une nouvelle société plus critique.
Nous sommes dans un monde où le discours philosophique et spirituel est « brouillé » par les avancées notées dans les découvertes scientifiques et les inquiétudes qu’elles entretiennent à travers toute la planète. Bientôt Mars ! Comme l’écrivait déjà Alioune Diop, en 1951, l’homme est devenu « plus inquiet » à cause des conquêtes technologiques. Même si par ailleurs cette avancée a permis, pour lui, de rendre l’homme « plus transparent à l’homme », elle l’a installé dans l’antichambre de ce qu’il appelle une « ambiance de lucidité multipliée ». [A. Diop, note 1, p. 11].
Et notre époque, ère de la biotechnologie jusqu’à la nano-techno-biologie, nous a plongés dans une ambiance de simultanéités multi-situées, rendant l’homme de plus en plus opaque à l’homme. Paradoxes d’une lucidité [dé] multipliée, rapide et furtive dont la cimaise vacille ! En effet, toutes ces technologies qui manipulent nos gènes ont pour volonté de nous bio-maîtriser, et de nous assigner dans les limites de nos frontières nationales et donc dans nos cultures. Parce que chaque culture doit finalement porter son propre cadre qu’elle se fabrique elle-même, et malgré la virtualité admise du cadre de la globalisation. Ce processus de limitation des flux humains –sous la dictature d’une économie désocialisée – a pour conséquence la réapparition de vieilles théories enfouies dans les mémoires et à la résurgence des clôtures nationales. L’art et sa suite ont pour vocation de déterritorialiser nos mémoires, même si le rêve d’un monde sans frontières [toutes les frontières possibles et imaginables] peut paraître comme une pure illusion pour la grande majorité des humains.
Un Musée historien aura donc pour vocation de permettre, au public auquel il est destiné, de ne pas se mirer comme au temps des verroteries et du porta-laid, mais de se voir, en soi comme un soi ouvert, à travers son propre süwer. Il ne s’agit donc pas de combat ou de gloire et ni d’une tentative permanente de « restauration » d’une personnalité monolithique dont le poids dans la fabrique du discours du monde pose et posera toujours problème. Il s’agit de se regarder les yeux dans les yeux pour ne pas confondre fétiches et vieilles choses, à brouiller le langage qui exprime et explicite leur pertinence pour que les contemporains amorcent un nouveau départ explicatif.
En termes clairs, il s’agit d’expliquer, aux générations actuelles et à venir, comment supprimer les effets de l’historicité des « maux » dont nous sommes les héritiers depuis que le monde est monde, alors que les causes semblent avoir été vaincues : colonialisme, esclavage, etc.
Le visiteur suit un « chemin » pré-tracé, c’est le « sens de la visite » dont le temps est nécessairement [dé] compté. Dans un musée historien, il ne s’agit pas de temps à passer, mais de saisir un temps du passé dans le présent, et qui est constitutif du récit d’une « prise de conscience de soi » et de l’appréhension « que le génie créateur de chaque peuple puise dans un fonds intellectuel, esthétique, spirituel commun qui reste la propriété de [l’espèce] humaine » [Cf. Alexandre Adandé, « L’impérieuse nécessité des musées africains », In L’art nègre, Présence Africaine, Paris, 2010, p. 163].
Donc il s’agit bien d’écouter se dérouler le début d’un récit historique constitutif [et pas re-constitutif] pour que chaque fragment de aada-bidaa, exposé/représenté, devienne un véritable chapitre dont le contenu, tout différent qu’il est de celui qui l’a précédé et de celui qui le suit, les continue malgré eux, en les tissant ensemble, dans sa discontinuité physique et esthétique, mais pas historique. Il les complète en se retissant à eux, et fondent ensemble l’historicité de leur caractère de patrimoine commun à une « singularité » civilisationnelle consciente que sa dispersion constitue l’âme de la poétique de la relation, comme dirait Edouard Glissant. Il faut donc éviter la glissade et rendre à l’artiste et du coup à l’art son mot, comme à chaque mot il faut attribuer un son.
L’art a une forte résonnance spirituelle. Et pour unir une diversité fragmentée de l’intérieur et dispersée à travers tous les coins de la planète, il faut nécessairement avoir foi en quelque chose. Parce qu’il ne s’agit pas d’un musée « anthropologique », « ethnographique », « chromatique » ni de « la copie d’un modèle de Musée déjà existant », mais aussi ni de celui qui aura pour ambition de reconstruire une lignée imaginaire, tissant d’un fil blanc l’histoire des Civilisations Noires « d’Abel à Obama » [comme s’il s’agissait de suivre une métamorphose de l’Aventure des Noirs de la dimension mythique à la dimension politique dans la liturgie du monde. Ambition d’inspiration trop exogène !]. Mais d’un musée qui doit nous permettre d’articuler son contenu à une revendication légitime, elle-même adossée aux réalités des générations actuelles et futures. L’une des voies pour redonner à l’art de soi sa place dans notre univers imaginaire, et du même coup lui permettre de participer à la revalorisation de nos rapports avec toutes ces choses qui font que nous pouvons prétendre être « nous-mêmes ». Et éviter ainsi de prolonger un débat qui a alimenté la « phase juvénile » du combat des Noirs. Il faut accompagner les générations à penser leurs mondes en fonction des contextes et non de prétextes qui anesthésient toute pensée constructive.
Les « Noirs » forment-ils une civilisation ou des civilisations [comme l’expression aujourd’hui admises en sciences sociales et humaines les « Afriques »] ? Quelle serait la place de la diaspora noire du monde arabo-musulman ? Elle est à peine évoquée dans tous les discours, comme si elle était insignifiante, voire inexistante. Cette sélectivité de notre mémoire est intrigante alors que des « Noirs » conservent encore, par devers eux dans beaucoup de pays arabo-musulmans [et bien d’autres en Turquie et en Iran] des éléments enfouis des cultures africaines. Les Gnawas du Maroc et les Haratins de Mauritanie, qui plongent leurs racines dans le magma historico-spirituel Ouest africain, l’illustrent.
Fort de cette vision « éparpillée » des choses (véritable fresque), le musée gagnerait à être le plus kréyòl possible. Car c’est sa créolité qui lui garantira son identité [valoriser ses différences créatrices et expliciter ses indifférences instituées], sa représentativité [éclairer son caractère, et surtout ses facultés à susciter des émotions intelligibles] et son discours [condenser son apport pratique dans la construction et la consolidation d’une personnalité civile plus inventive, donc plus ouverte]. Parce qu’il ne s’agit pas d’une simple monstration, mais d’une dés-objetisation des « vieilleries » et des « fétiches » en les objectivant, les faisant ainsi entrer dans le processus d’explication des rapports à un « soi collectif », non pas pour justifier son existence parmi le vaste cercle des sois, mais de décliner ses multiples apports [son « chemin de croix »] dans la construction de la pensée spirituelle du monde. Parce que la substance de tout art se situe au cœur de l’élan qui s’empare de l’artiste, et qui lui permet de reposer la question permanente de notre être là dans une autre forme de langage : un verbe désactivé. Il faut donc rendre au verbe sa capabilité d’exprimer, en le réanimant. Car c’est lui qui imprime cette parcelle de contemporanéité qui permet à toute chose valorisée de défier le temps et de devenir une histoire. Pour que l’Humain reste toujours plus important que l’œuvre démontée, re-montée et montrée.
Donc, il s’agit de rendre compte d’un instant de conception, de maturation, de création et finalement de rendre plus explicite ce lieu de dépôt de nos émotions les plus intelligibles. Celles qui ont pour mission de réveiller la sensibilité émotive des Autres-nous-mêmes.
La Culture ne peut fonctionner que dans une sphère où les émotions sont maîtrisées, canalisées et transformées, selon les critères de l’actualité, en éléments qui viennent consolider les différents segments qui forment et assurent la motricité de l’espace social. Car de cette maîtrise, résultent les fondements qui valident les choix pour désigner, dans la multiplicité des objets, ceux qui peuvent représenter une partie significative d’un patrimoine ayant comme vocation de rassembler, « imaginairement » mais aussi et surtout concrètement, une vérité pulvérisée de l’intérieur par la multiplicité de ses références.
Il m’a toujours semblé, comme tant d’autres, que notre accommodation spirituelle a scellé notre déclassement artistique et sanctionné, comme à jamais, nos rapports distants avec notre propre esthétique, même corporelle. Il faut bien rappeler qu’avant de devenir art les premiers objets, qui ont fait leur entrée dans la panoplie des courants artistiques du monde, étaient d’abord des « objets sacrés » jouant des fonctions religieuses bien déterminées. Ils appartenaient au monde des divinités et incarnaient leur in-visibilité. Ils figuraient la représentation du visible de l’invisible dans le champ visible. Leur destination première n’était ni l’exhibition de leur beauté ni de celle de leur laideur. Mais le caractère central de leurs capacités à représenter quelque chose qui transcende les esprits de ceux-là même qui les ont institué comme référents d’une force vers laquelle ils se tournent ou se détournent.
Dès lors, on ne pouvait les voir tout en les re-gardant. Parce qu’ils nous possèdent, et qu’ils sont communément admis non comme de simples relais, mais comme dépositaires de cette force condensée dans des « totems » [« pour valoir ce que de droit »]. Ce sont ces totems qui ont été subjectivisés [devenus tabous], et qui ont été éliminés de notre univers mental par les religions dites du Livre. Nous avons donc, et depuis longtemps, rompu avec cette « affectivité » qui nous liait à nos propres objets divins ou pas, des couleurs qui les accompagnent et de tout ce qui les rehausse.
En entamant leur entrée dans l’univers des « Arts premiers » [leur mondialisation], ils deviennent forcément de « vieilles choses » emportées comme des trophées puisés du fonds cultuel de cultures considérées comme des sauvageries civilisationnelles. Et pourtant dès qu’ils arrivent à destination, une autre histoire commence pour les objets en question et pour ceux qui les ont déplacés en les déclassant. Parce qu’ils deviennent représentatifs [comme des justificatifs, des certificats signés et conformes] de leur propre histoire d’exploration, d’expédition ou d’aventure.
Hors de leur univers de naissance, les vieilleries ne se perdent pas, elles bifurquent pour prendre l’aspect de l’un de ses multiples nœuds qui tissent une toile en la consolidant. Parce que le caractère de l’art est de s’insurger contre toute forme d’assignation identitaire. Les éléments qui entrent dans sa composition ne prennent sens que dans la diversité qu’ils engendrent par le biais des regards croisés et des discours parallèles qu’ils inter-fécondent.
Aussi, paradoxalement que cela puisse paraître, ils se diffusent parce que suscitant des curiosités feintes et des naïvetés systémiques qui président à toute première découverte d’une « bizarrerie » culturelle. Dès lors, ils se métamorphosent positivement entre les mains de ceux qui les dévalorisent. Parce que ne se rendant pas compte que les vieilles choses assignées à un autre rôle participent désormais de leur décor en le rehaussant par leur « être » et leur « être-ainsi ». Comme s’il leur fallait être dans un autre contexte, en attente d’un excellent prétexte, pour dérouler leur histoire, celle qui est enfouie en elles depuis leur conception jusqu’à leur exposition permanente ou temporaire.
Faut-il le rappeler que ce ne sont pas tous les objets produits par une société qui sont dotés de capacités de s’exprimer et d’exprimer [hors du champ de de leurs maternités linguistique et philosophique] ce qu’ils portent en eux sans le signifier réellement. Il s’agit de choisir ceux d’entre eux qui retrouvent le chemin de leur polysémie primaire, car c’est cette dernière qui garantit leur entrée dans le domaine dit du patrimoine. Ils deviennent anonymes, et donc communs à tous parce que chacun ayant un « fragment » du récit qu’ils aident à reconstituer dans ses détails [spirituel et esthétique] dans un cadre qui rehausse une mémoire célébrée et transmise avec esprit.
Dès lors il faut susciter le désir en chacun d’entre nous et en nous tous pour revaloriser toutes ces choses que nous croyons s’éloigner de nous alors qu’elles condensent une partie importante de nos propres mutations. C’est par ce biais que nous arriverons à saisir que « Sujet et objet naissent d’un même acte, logiquement, dans la mesure où la teneur factuelle purement abstraite, idéelle, est donnée tantôt comme contenu de la représentation, tantôt comme celui de la réalité objective, et psychologiquement dans la mesure où la représentation encore dépourvue d’un moi, incluant personne et chose dans l’état d’indifférence, se clive et laisse se créer une distance entre le moi et son objet, de par laquelle chacun des deux acquiert son essence détachée de l’autre » [Cf. Goerg Simmel, Philosophie de l’argent, Paris, PUF, 2014, p. 29]. Seul un Musée historien peut nous permettre de transmettre toutes ces ligatures qui maintenaient les « Civilisations Noires » dans les limites exiguës du cadre des objets spirituels déclassés, et mieux montrer le Sujet qu’elles représentent au XXIe siècle, analysé à l’aune des effets collatéraux générés par son caractère diasporique.
Finalement, un Musée historien doit, me semble-t-il, pouvoir rendre compte du processus qui conduit des « objets hétéroclites » considérés comme simples, voire « insignifiants » pour les gens, à perpétuer leur identité tout en connaissant, dans leur propre trajectoire et celle qu’on peut leur imposer, de multiples influences qui commandent les mutations qui garantissent leur entrée dans l’univers des objets culturels communs.
Pour ouvrir : l’art, avec la poétique qui l’accompagne, serait le site idéal pour penser et tracer de nouvelles perspectives historiques, et du coup réveiller l’inventivité en l’homme.
Abdarahmane Ngaïdé, Enseignant-chercheur au Dpt d’histoire (UCAD)
Dakar, le 08/08/2016
(Reçu à Kassataya le 01 février 2014)
Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com